Glossaire
A
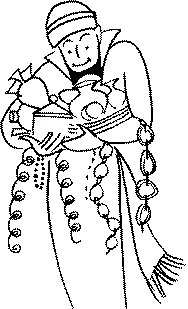 Jésus n’avait rien contre l’argent. Mais il remet l’argent à sa place. Lui et sa petite bande de disciples avaient une réserve d’argent pour aider des pauvres 1 et c’est grâce au soutien financier de personnes riches que Jésus a pu accomplir sa mission de Christ tout en ayant arrêté son premier métier de charpentier2 .
Jésus n’avait rien contre l’argent. Mais il remet l’argent à sa place. Lui et sa petite bande de disciples avaient une réserve d’argent pour aider des pauvres 1 et c’est grâce au soutien financier de personnes riches que Jésus a pu accomplir sa mission de Christ tout en ayant arrêté son premier métier de charpentier2 .
Le problème avec l’argent, c’est qu’il peut facilement devenir pour nous comme un redoutable tyran, un dieu féroce qui mange ses adorateurs3 . Si nous adorons l’argent comme si c’était un dieu, Jésus nous dit que nous avons alors un vrai problème. Alors que si c’est vraiment Dieu qui est le Seigneur de notre vie, l’argent devient un moyen de faire le bien, de libérer et de faire vivre. C’est vrai pour l’argent, et l’on peut remarquer le même phénomène avec le pouvoir, la santé, les plaisirs… qui sont bons quand ils sont à une juste place dans notre cœur.
Et puis il y a le trésor véritable qu’est la présence de Dieu en nous 4 .
Marc Pernot
1 Jean 13:29
2 Luc 8:3
3 Luc 16:13
4 Matthieu 13:44, 2 Corinthiens 4:7
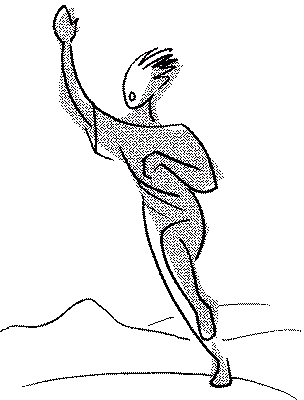 Apôtre est un mot grec qui veut dire “ envoyé ”. C’est comme cela que Jésus appelait ses proches disciples1 , cela leur rappelait leur mission principale qui est d’aller vers les autres pour leur offrir la bonne nouvelle du Christ.
Apôtre est un mot grec qui veut dire “ envoyé ”. C’est comme cela que Jésus appelait ses proches disciples1 , cela leur rappelait leur mission principale qui est d’aller vers les autres pour leur offrir la bonne nouvelle du Christ.
Les écrits du Nouveau Testament appliquent ce titre d’envoyé à de nombreuses personnes en plus des douze disciples les plus proches de Jésus. Paul est appelé apôtre, lui qui n’a jamais rencontré Jésus mais qui est devenu apôtre après sa conversion. D’autres hommes et des femmes sont également appelés apôtres dans la Bible, comme Barnabé, Sylvain, Timothée, Andronicus et Junia2 .
Par le Christ, nous sommes tous des apôtres, homme ou femme, savant ou illettré, riche ou pauvre. Avec notre personnalité propre, à la place qui est la nôtre aujourd’hui, Dieu nous envoie pour agir et parler afin d’aider les autres à avancer dans la vie, et être unis comme le sont les différents membres d’un seul corps 3.
Marc Pernot
1 Luc 6:13-16
2 Actes 14:14, Romains 16:7
3 1 Corinthiens 12
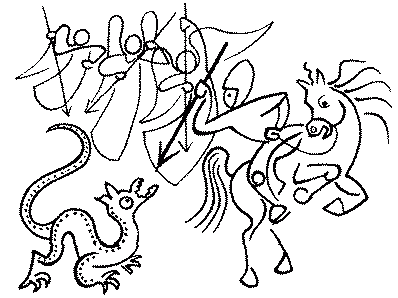 C’est un mot qui fait peur, un synonyme de catastrophe. Le livre de l’Apocalypse (le dernier livre de la Bible) voulait pourtant nous donner de l’espérance en témoignant de l’Évangile. C’est pour cela qu’il s’appelle Apocalypse, ce qui veut dire en grec révélation. Ce qu’il révèle c’est qu’au-delà de la souffrance qui peut nous frapper en ce monde, au-delà de la haine et de la faiblesse de notre corps il y a une réalité spirituelle qui triomphe et qui nous donne la vie.
C’est un mot qui fait peur, un synonyme de catastrophe. Le livre de l’Apocalypse (le dernier livre de la Bible) voulait pourtant nous donner de l’espérance en témoignant de l’Évangile. C’est pour cela qu’il s’appelle Apocalypse, ce qui veut dire en grec révélation. Ce qu’il révèle c’est qu’au-delà de la souffrance qui peut nous frapper en ce monde, au-delà de la haine et de la faiblesse de notre corps il y a une réalité spirituelle qui triomphe et qui nous donne la vie.
Ce livre ne parle pas d’un futur lointain mais du présent de toute personne. Il parle de la victoire formidable que Dieu accomplit aujourd’hui dans notre vie pour nous sauver en éliminant le mal qui est source de mort.
Mais ce qui est particulier par rapport aux autres livres du Nouveau Testament, c’est que l’Apocalypse présente la bonne nouvelle du salut de Dieu sous une forme fantastique digne d’un roman de science fantasy avec tout un jeu de symboles pas toujours faciles à démêler pour un lecteur du XXIe siècle. L’avantage de cette forme imagée est qu’elle permet une foule d’interprétations possibles . Mais il y a quand même des lectures qui ne sont pas justes, en particulier, si l’on y trouve des raisons d’avoir peur de Dieu c’est que l’on se trompe, car le Christ nous a montré que devant Dieu nous ne sommes plus dans la peur mais dans l’amour1 . Et son message est appelé Évangile, c’est-à-dire » bonne nouvelle » et non pas » terrible menace « . Malheureusement, les sectes raffolent de l’Apocalypse qu’elles utilisent pour faire peur à leurs adeptes et ainsi mieux les prendre dans leur piège.
1 Romains 8:15, 1 Jean 4:16-18
Marc Pernot
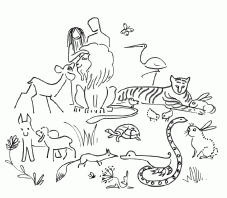 Oui, l’homme est un animal, mais il n’est pas que ça. Nous avons une foule de choses en commun avec les animaux, de sorte que du point de vue scientifique il n’est pas facile de dire ce qui nous distingue d’eux. C’est ce que l’on voit dans la première page de la Bible, car les animaux et les êtres humains sont créés le même jour, le 6e. Nous aurions donc tort de faire les malins, ou de considérer les animaux comme des choses sans valeur. Au contraire, cela nous invite à réfléchir sur la place importante dans l’univers qu’ont, ensemble, tous les êtres vivants.
Oui, l’homme est un animal, mais il n’est pas que ça. Nous avons une foule de choses en commun avec les animaux, de sorte que du point de vue scientifique il n’est pas facile de dire ce qui nous distingue d’eux. C’est ce que l’on voit dans la première page de la Bible, car les animaux et les êtres humains sont créés le même jour, le 6e. Nous aurions donc tort de faire les malins, ou de considérer les animaux comme des choses sans valeur. Au contraire, cela nous invite à réfléchir sur la place importante dans l’univers qu’ont, ensemble, tous les êtres vivants.
La Bible ajoute que l’être humain a quelque chose de plus qu’un animal :
Dieu bénit l’être humain 1. Ce qui fait de nous un être humain c’est que Dieu nous reconnaît comme tel en nous bénissant. Ce titre n’est pas à mériter en étant intelligent ou sage, Dieu nous reconnaît comme humain, nous le sommes donc. Il nous adopte comme son enfant, nous le sommes donc2 .
De plus, Dieu donne à l’être humain son Esprit 3. L’être humain est ainsi une créature comme n’importe quel animal, mais il est aussi bien plus que cela, car Dieu lui donne d’être à son image, sous certains aspects. Nous sommes alors une créature, mais aussi, à notre mesure, nous sommes un créateur, un peu comme Dieu. Nous sommes bénis par Dieu, et nous pouvons aussi être source de bénédiction…
Nous recevons ainsi une distinction extraordinaire de ce Père qui nous veut du bien, et cela nous donne des possibilités et une mission particulières dans la création.
Après avoir créé et béni l’homme, Dieu le place dans sa création » pour la cultiver et la garder « 4, nous donnant la responsabilité de soigner notre planète et de perfectionner ce qui ne va pas dans la nature (par de la médecine, de l’irrigation, des constructions intelligentes et bonnes, mais aussi par l’art et la bonté). Dieu propose enfin à l’homme de nommer les animaux5 , l’homme a ainsi une place à part, mais il est appelé aussi à reconnaître l’importance des animaux dans l’ordre de la création.
Marc Pernot
1 Genèse 1:28
2 Romains 8:17
3 Genèse 2:7
4 Genèse 2:15
5 Genèse 2:20
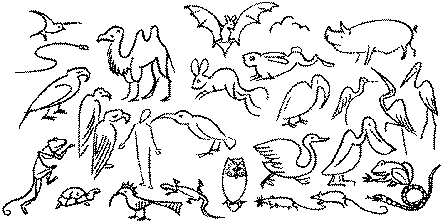
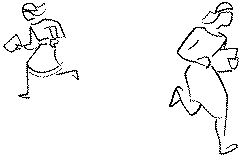 Dans la Bible, on parle seulement de messagers, on dirait aujourd’hui des facteurs ou des émissaires. Ce sont les traducteurs de la Bible qui ont inventé le mot » ange » sur la base du mot grec angeloV qui veut dire » messager « . Cela change tout, car on a alors pensé que les anges ne sont que des sortes de bêtes à plumes que Dieu envoie pour nous parler. En réalité, il nous arrive de recevoir une Parole de Dieu directement dans la prière ou grâce à une personne comme vous et moi qui a eu un geste ou un mot qui nous a fait avancer.
Dans la Bible, on parle seulement de messagers, on dirait aujourd’hui des facteurs ou des émissaires. Ce sont les traducteurs de la Bible qui ont inventé le mot » ange » sur la base du mot grec angeloV qui veut dire » messager « . Cela change tout, car on a alors pensé que les anges ne sont que des sortes de bêtes à plumes que Dieu envoie pour nous parler. En réalité, il nous arrive de recevoir une Parole de Dieu directement dans la prière ou grâce à une personne comme vous et moi qui a eu un geste ou un mot qui nous a fait avancer.
L’ombre était nuptiale, auguste et solennelle ;
Les anges y volaient sans doute obscurément,
Car on voyait passer dans la nuit, par moment,
Quelque chose de bleu qui paraissait une aile…
Dans ce texte de Booz endormi, Victor Hugo exprime la réalité de l’action de Dieu comme quelque chose d’accessible à nos sens. Mais qu’est-ce qu’une photo prise à cet instant aurait conservé de l’événement dont il parle ? Probablement pas grand-chose qui ressemble à l’image d’un ange dans la peinture ou la sculpture classique. L’ange qui est passé à cet instant n’a pas non plus laissé tomber une plume de son aile. Mais faut-il pour autant dire que les anges n’existent pas, qu’ils ne sont que des symboles, ou des personnages mythiques comme les trolls ou les sphinx ? Ce serait vraiment dommage d’écarter ainsi les anges avec un ricanement, car ils sont importants dans la Bible. L’ange est même présent à chaque moment clef de la vie de Jésus selon les évangiles. Un ange annonce à Marie et Joseph la conception de Jésus, un ange est présent à sa naissance et invite les bergers à reconnaître en lui le salut de Dieu, un ange aide Jésus face à la tentation, un ange le fortifie encore dans l’angoisse de la nuit précédant sa mort, et au tombeau deux anges annoncent sa résurrection.
Comment se fait-il, alors, que les prédications chrétiennes évitent la plupart du temps de faire référence aux anges, même pour s’intéresser à ce qu’ils évoquent sur le plan théologique ? C’est qu’il y a un danger dans cette notion d’ange. Si l’on considère l’ange comme un être sur-humain mais inférieur à Dieu, c’est vrai que l’on n’est pas loin du polythéisme. L’ange compris comme un messager surnaturel n’est pas très différent du dieu Hermès des grecs, un être intermédiaire entre le grand dieu Zeus et les hommes. Cette idée d’êtres intermédiaires entre Dieu et les hommes est gênante en théologie chrétienne. Nous croyons, nous annonçons que le Christ est la Parole de Dieu faite chair et que Dieu se manifeste directement par son Esprit à l’être humain, que viendraient faire ces sortes de chauves-souris surnaturelles dans notre relation à Dieu ?
Je pense qu’il est donc bon de ne pas en rester à la représentation naïve des anges que nous donne la peinture, et de ne pas garder cette idée d’une catégorie de créatures intermédiaires entre Dieu et l’être humain. Mais il serait dommage de rejeter l’existence des anges, ou d’oublier leur place importante dans la Bible.
Oui, les anges existent.
En grec comme en hébreu, le mot ange ne désigne pas un être particulier, mais une fonction, celle de messager entre Dieu et l’homme, ou entre l’homme et Dieu. Cette fonction nous rappelle à la fois que Dieu est dans une autre dimension que nous, et que la relation est possible, concrètement, réellement, comme les anges se voient et s’entendent. Une manifestation de Dieu est bien plus qu’une simple émotion religieuse, bien plus qu’un simple réconfort moral, bien plus qu’un idéal d’amour et de fidélité. Dieu est cela, mais il est bien plus que cela. C’est ce que rappelle la figure de l’ange. L’ange se manifeste à nos sens, il est vu et entendu, il marche parfois avec les humains et mange à leur table. Cela nous rappelle le caractère concret des gestes que Dieu accomplit pour nous faire passer du néant à l’existence. Dieu n’est pas seulement une idée, mais il effectue un travail. Il crée la vie et il l’augmente en donnant un supplément d’être et de relations. C’est ce que font les anges dans la vie de Jésus, ils sont toujours là au moment clef, ils sont la présence réelle de Dieu qui agit pour donner la vie, le réconfort, la force.
Parfois, nous dit la Bible, Dieu agit par l’intermédiaire d’une personne humaine qu’il motive pour agir en son nom. Cette personne est alors au sens propre un ange, et c’est comme cela que l’appelle la Bible. Mais plus largement nous avons reçu la visite d’un ange de Dieu chaque fois que Dieu nous donne un souffle que nous n’avions pas avant.
La notion d’ange nous invite à nous préparer à accueillir le geste de Dieu pour nous. Bienvenue aux anges de l’Éternel.
Marc Pernot

Pour parler de l’amour de Dieu pour l’humanité, la Bible compare souvent Dieu à un fiancé amoureux de sa fiancée1 . Cela nous montre d’abord comment Dieu nous juge : quand on est amoureux, même les défauts de son amoureuse ne sont pas vraiment gênants.
Mais cette comparaison nous montre aussi que le sentiment amoureux est digne d’illustrer les sentiments de Dieu pour nous, c’est donc une chose excellente selon la Bible.
L’idéal est que nous vivions aussi bien notre vie de couple que notre vie de foi en étant mutuellement amoureux et fidèles à l’autre.
Dieu, lui, est ainsi amoureux de l’être humain, vraiment et éternellement. Mais l’être humain est mi-animal (il est une créature) mi-Dieu (par l’Esprit qui lui est donné). Le sentiment amoureux est chez l’homme quelque chose d’extrêmement beau, intense et riche, et il est à multiples facettes, spirituelle, intellectuelle, sociale, psychologique, biologique… c’est normal puisque nous sommes ainsi faits. Le sentiment amoureux peut être inspiré par Dieu, il est également inspiré par le désir physique, le plaisir de discuter, le besoin de n’être pas seul, et des sentiments inexplicables ou bien d’autres raisons. Tout cela fait la force et la fragilité de l’amour des amoureux.
Un des problèmes de cet amour est que l’humain est particulièrement sensible à des changements d’humeur qui influent sur ses sentiments. Le sentiment amoureux n’y échappe pas, et il peut donc connaître des hauts et des bas. Un autre problème est que nos instincts nous font ressentir du désir comme n’importe quel animal en ressent à la période du rut, mais que le désir physique ne suffit pas pour être véritablement amoureux. La passion de discuter ensemble et de rigoler est plus stable, ainsi que l’admiration de certaines qualités et la reconnaissance de ce que l’autre nous a apporté pour nous faire progresser.
Dans un couple, l’idéal est de conjuguer la passion amoureuse et aussi l’amour au sens où on l’entend dans l’article précédent, l’amour qui est fait de respect et de service de l’autre. Le couple humain est alors une vraiment belle image de la relation que Dieu essaye d’avoir avec chaque être humain.
Il y a des gens qui ne sont pas amoureux ou qui ne le sont que tard dans leur vie. On n’est pas obligé de se forcer à vivre en couple pour » faire comme tout le monde « , surtout pas dans ce domaine où l’on risque de se rendre particulièrement malheureux et où l’on peut blesser une autre personne. Tant mieux si l’on trouve l’homme ou la femme de sa vie, mais il est possible aussi d’avoir une belle vie en étant célibataire.
1 Cantique des cantiques, Ésaïe 54:5, Osée 2:19, 2 Corinthiens 11:2
Marc Pernot
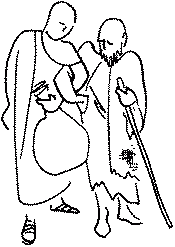 Dans une de ses lettres, l’apôtre Paul donne une bonne définition de ce que l’on entend par » amour » dans la Bible : » L’amour est patient, il est plein de bonté. L’amour n’est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s’enfle pas d’orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s’irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l’injustice, mais au contraire l’amour se réjouit de la fidélité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L’amour ne meurt jamais. « 1 .
Dans une de ses lettres, l’apôtre Paul donne une bonne définition de ce que l’on entend par » amour » dans la Bible : » L’amour est patient, il est plein de bonté. L’amour n’est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s’enfle pas d’orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s’irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l’injustice, mais au contraire l’amour se réjouit de la fidélité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L’amour ne meurt jamais. « 1 .
Il est clair que le mot traduit par amour dans la Bible ne signifie pas avoir de la sympathie ou de l’affection pour quelqu’un. On peut trouver quelqu’un sympathique, on peut même être amoureux de lui (ou d’elle), il s’agit alors d’une attirance particulière pour telle ou telle personne, et la joie que nous procure sa présence. C’est très bien mais c’est autre chose dont Paul parle ici.
Par exemple, la première qualité de l’amour citée ici par Paul est : » L’amour est patient « , on peut être amoureux et pas patient du tout, on peut donc être amoureux et ne pas aimer au sens où Paul l’indique. À l’inverse, on peut trouver son voisin peu sympathique, et être, malgré cela, patient envers lui après avoir appris que s’il met toujours sa télé trop fort, c’est parce qu’il est à moitié sourd…
Ce que Paul nous propose ici, c’est de voir le bien qui est dans une personne, de lui souhaiter du bien, et d’agir pour son bien, dans la mesure du possible.
Cet amour-là est fondamental dans l’existence. Jésus et ses disciples nous proposent d’aimer ainsi, car il s’agit d’une qualité de relation qui embellit tout : nos rapports avec ceux qui sont chers à notre cœur comme nos amis ou notre amoureux par exemple, mais aussi avec ceux qui ne nous sont pas sympathiques, avec ceux que nous croisons par hasard ou même ceux qui nous font du mal. C’est ce que nous propose Jésus 2.
Bien sûr, ce n’est pas facile, pour personne et pas même pour Jésus, mais on peut choisir de s’exercer à aimer plus. En écoutant les autres, en les connaissant mieux, en essayant de voir les choses de leur point de vue, avec leurs faiblesses, leurs forces, leur histoire et leur personnalité, on arrive à aimer un peu mieux. Mais c’est vrai que les progrès sont difficiles.
En nous donnant une si belle définition de l’amour et de la vie chrétienne, l’Évangile ne risque pourtant pas de nous désespérer de ne pas y arriver parfaitement, la réponse à cette crainte est le point fondamental de l’Évangile : Dieu est amour, il est même le seul à aimer ainsi parfaitement. C’est lui, lui seul, qui donne de progresser sur ce chemin. Dieu est l’amour, et c’est parce que nous sommes ses enfants que nous sommes déjà un peu capables d’aimer. C’est en s’ouvrant à l’Esprit dans une sincère recherche de Dieu qu’il pourra développer notre capacité à aimer mieux.
Il n’est pas facile d’aimer les autres véritablement, il n’est pas facile non plus de s’aimer soi-même véritablement, ces deux choses sont pourtant essentielles. Aimer Dieu, au moins un petit peu, et s’ouvrir à sa présence est ainsi la clef de tout ce qui est important et éternel dans notre vie.
Marc Pernot
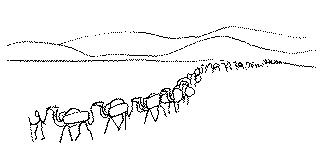 C’est un deuxième mot hébreu bien connu, avec Alléluia.
C’est un deuxième mot hébreu bien connu, avec Alléluia.
À l’origine, l’amen était la corde qui relie les chameaux dans une caravane. Chaque chameau est lié par cette ficelle à celui qui le précède dans la file, cela lui garantit d’être sur la piste de l’oasis, même s’il ne voit pas le caravanier. Du coup, le mot Amen évoque les notions de confiance, de vérité et de fidélité.
Quand Jésus veut insister sur quelque chose de vraiment important, il commence souvent sa phrase par « Amen, Amen, je vous le dis… »1, ce que les Bibles traduisent parfois par « En Vérité, en Vérité, je vous le dis… ». Cet Amen exprime la confiance que nous pouvons avoir en Christ pour nous faire cheminer vers Dieu. Le Christ est l’amen, la corde qui nous relie à Dieu même si nous ne le voyons pas.
Ce mot Amen était tellement aimé par les gens qui avaient entendu Jésus parler qu’ils ont voulu garder ce mot hébreu dans leur propre langue pour évoquer ce lien solide qui existe entre Dieu et nous à cause de sa fidélité solide comme le roc. Par exemple, quand nous disons Amen à la fin d’une prière, c’est une façon de résumer notre prière en remettant tout entre les mains de Dieu avec confiance. C’est peut-être même la plus profonde des prières, la plus fidèle des prières.
Le mot Foi est directement tiré du mot Amen en hébreu, cela nous éclaire déjà sur ce que l’on entend par la foi dans la Bible, une confiance en Dieu, le fait de tenir à lui.
Marc Pernot
1 par exemple Jean 6:47
 Aujourd’hui on dirait plutôt une association qu’une alliance pour parler du lien entre des personnes qui veulent travailler ensemble. Dans la Bible, Dieu passe son temps à vouloir faire alliance avec l’homme, il s’associe avec Adam & Ève (c’est-à-dire avec l’humanité, avec vous et moi1), avec Noé (après le déluge2), avec Abraham3, avec Moïse4… En Jésus-Christ, nous voyons que Dieu veut faire alliance avec chaque individu de l’humanité entière, car Dieu regarde chaque personne comme faisant partie de sa famille. Cette nouvelle alliance en Jésus-Christ est profondément intime car elle est plus une façon d’aimer qu’un contrat.
Aujourd’hui on dirait plutôt une association qu’une alliance pour parler du lien entre des personnes qui veulent travailler ensemble. Dans la Bible, Dieu passe son temps à vouloir faire alliance avec l’homme, il s’associe avec Adam & Ève (c’est-à-dire avec l’humanité, avec vous et moi1), avec Noé (après le déluge2), avec Abraham3, avec Moïse4… En Jésus-Christ, nous voyons que Dieu veut faire alliance avec chaque individu de l’humanité entière, car Dieu regarde chaque personne comme faisant partie de sa famille. Cette nouvelle alliance en Jésus-Christ est profondément intime car elle est plus une façon d’aimer qu’un contrat.
Une association demande deux personnes.
Dieu est la première personne et rien ne peut briser son alliance avec nous (c’est ce que l’on appelle » la grâce « ). Et, comme un amour vrai ne se marchande pas, rien ne peut diminuer l’amour que Dieu a pour nous.5 Même quand nous ne sommes pas fidèles à notre Dieu, lui, il reste fidèle dans sa façon de nous respecter et de nous vouloir du bien.
La question délicate est plutôt celle de la réponse de la personne à cette grâce, car chacun a la liberté d’entrer ou non dans cette alliance, ou d’y entrer qu’à moitié, ou pas comme Dieu l’espère, ou d’y entrer d’abord et de ne pas y être trop fidèle par la suite… Dieu espère, et cet amour qu’il nous propose de vivre, c’est ce que l’on appelle la foi.
pasteur Marc Pernot
1 Genèse 1 et 2
2 Genèse 9
3 Genèse 17
4 Voir le livre de l’Exode, et Deutéronome 30
5 Romains 8:31-39
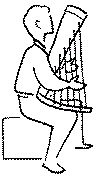 Vous connaissez probablement un peu l’hébreu. Vous connaissez le mot Amen (qui exprime la confiance en Dieu), vous connaissez peut-être aussi le mot Alléluia, c’est un cri de joie qui nous invite à célébrer Dieu, à chanter pour lui, et à lui dire notre enthousiasme pour ce qu’il a fait et pour ce qu’il nous offre.
Vous connaissez probablement un peu l’hébreu. Vous connaissez le mot Amen (qui exprime la confiance en Dieu), vous connaissez peut-être aussi le mot Alléluia, c’est un cri de joie qui nous invite à célébrer Dieu, à chanter pour lui, et à lui dire notre enthousiasme pour ce qu’il a fait et pour ce qu’il nous offre.
Alléluia est peut-être le plus connu des mots hébreux car il est présent dans des dizaines de paroles de musiciens bien connues : bien sûr Bach, Hændel et autres musiciens classiques, mais aussi dans les Beatles, Bob Marley, U2, Leonard Cohen, Jeff Buckley, Brassens… Et, dans la variété avec Nougaro, Mylène Farmer, Geri Halliwell, Damien Saez…
Alléluia peut se traduire par « Chantez les louanges de l’Éternel. » C’est une bonne idée de le faire afin de remercier Dieu pour ce qui est beau dans notre vie, mais aussi pour s’ouvrir à ce qu’il désire nous offrir comme forces nouvelles et comme bonnes idées.
Mais si l’on doute de l’existence de Dieu, allez-vous me dire ? Et bien, on peut quand même vivre l’Alléluia en chantant les louanges de l’origine de la vie, de ce qui existe de bon et de beau dans l’univers. C’est déjà une bonne pensée, cela nous aide à nous réjouir et à nous recentrer sur ce qui est déjà bon. C’est même déjà une vraie et bonne prière qui nous oriente vers la source de ce qui est bon. En vivant ainsi, il est bien possible que l’on ait même le bonheur de rencontrer l’Éternel, l’origine de tout ce qui est bon.
Mais Alléluia n’est pas seulement une prière adressée à Dieu, c’est un cri, un appel lancé vers les autres personnes pour leur proposer de chanter les louanges de Dieu, l’Alléluia n’est donc pas une louange solitaire, mais un bonheur que l’on a envie d’offrir.
pasteur Marc Pernot
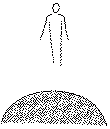 Pourquoi est-ce que ces deux mots sont dans un dictionnaire de mots théologiques ? On s’attend plutôt à les trouver dans un dictionnaire des noms propres aux côtés des hommes et des femmes importants de l’histoire de l’humanité. Mais en réalité, Adam et Ève ne sont pas seulement des noms propres mais aussi des noms communs. Adam, en hébreu, veut dire tout simplement l’humain. La Bible nous dit que “Lorsque Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l’homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d’Adam, lorsqu’ils furent créés.”1. Dans ce passage, on voit bien que ce nom d’Adam, d’humain, est donné à l’homme et à la femme, à tout homme et à toute femme, dès sa création. C’est fondamental. Cela veut dire que chacun de nous est, par principe, considéré par Dieu comme humain, sans condition, sans distinction de sexe, de croyance, de conduite, de santé… Cela veut dire que nous n’avons pas à mériter notre dignité ou notre place sur terre, cela nous est reconnu par Dieu, qui aurait le droit de nous le refuser ?
Pourquoi est-ce que ces deux mots sont dans un dictionnaire de mots théologiques ? On s’attend plutôt à les trouver dans un dictionnaire des noms propres aux côtés des hommes et des femmes importants de l’histoire de l’humanité. Mais en réalité, Adam et Ève ne sont pas seulement des noms propres mais aussi des noms communs. Adam, en hébreu, veut dire tout simplement l’humain. La Bible nous dit que “Lorsque Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l’homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d’Adam, lorsqu’ils furent créés.”1. Dans ce passage, on voit bien que ce nom d’Adam, d’humain, est donné à l’homme et à la femme, à tout homme et à toute femme, dès sa création. C’est fondamental. Cela veut dire que chacun de nous est, par principe, considéré par Dieu comme humain, sans condition, sans distinction de sexe, de croyance, de conduite, de santé… Cela veut dire que nous n’avons pas à mériter notre dignité ou notre place sur terre, cela nous est reconnu par Dieu, qui aurait le droit de nous le refuser ?
En hébreu, le mot Adam vient du mot adamah, « la terre » et Ève veut dire « la vie ». Cela nous dit que l’être humain est issu à la fois de la terre et de la vie, il est fait de la poussière du sol et de cette chose incroyable qu’est la vie… plus quelque chose de spécial qui vient de Dieu (l’Esprit).
Adam et Ève existent, ils sont chacun de nous. Ils sont à notre origine puisque c’est à une personne comme cela que Dieu pense quand il crée l’humanité, à la fois les pieds sur terre et pleine de vie, pleine de sa vie à lui, Dieu. Adam et Ève sont aussi notre avenir, puisque Dieu ne désespère jamais de nous faire progresser dans ce sens en continuant à nous faire évoluer. L’Adam véritable existe, c’est le Christ, il est l’Humain au sens propre, l’espérance de tout homme et de toute femme. C’est pourquoi le Christ est appelé aussi l’alpha et l’oméga, le A et le Z (voir Z).
Grâce à ces deux premiers mots, Adam et Ève, nous voyons un petit peu de quoi parle la Bible et pourquoi elle est si intéressante. Elle parle de nous, de notre infinie valeur et du sens de notre vie. Le but de la Bible n’est pas de nous raconter le passé, mais l’actualité. Nous avons de la chance parce que les théologiens qui ont écrit la Bible aimaient raconter de belles histoires. Ils nous ont ainsi offert, pour commencer, l’histoire d’Adam et Ève pour nous parler de l’espérance de Dieu pour nous.
1 Genèse 5:1-2
pasteur Marc Pernot
B
 Encore un mot grec qui se retrouve tel quel, non traduit, dans le texte de nos Bibles. » Blasphémer » c’est démolir injustement la réputation de quelqu’un, ce qui n’est pas très sympathique car cela peut vraiment blesser ou tuer quelque chose dans la personne ainsi agressée.
Encore un mot grec qui se retrouve tel quel, non traduit, dans le texte de nos Bibles. » Blasphémer » c’est démolir injustement la réputation de quelqu’un, ce qui n’est pas très sympathique car cela peut vraiment blesser ou tuer quelque chose dans la personne ainsi agressée.
On peut calomnier Dieu, on peut dire des horreurs sur lui et sur le Christ… Ce n’est pas très positif, mais Dieu en a vu d’autres et il ne se fâche pas contre nous pour autant. Mais il arrive malheureusement que par nos paroles ou par nos actes nous fassions penser à d’autres personnes que Dieu ne serait pas bon. On fait alors un grand tort à ces personnes, en blessant ou en tuant leur foi.
Il y a quand même un passage curieux où il est dit que même Dieu ne peut nous sauver du blasphème contre l’Esprit Saint 1. Jésus nous mettrait-il ainsi en garde contre une phrase qu’il ne faudrait surtout pas dire parce qu’elle pourrait complètement fâcher Dieu contre nous ? C’est impossible car l’Évangile annonce le pardon de Dieu de façon radicale. Mais Jésus nous met en garde contre un danger mortel : en méprisant l’Esprit nous privons notre être de la dynamique d’évolution du créateur de l’univers. Cela veut dire cesser d’espérer, cesser de regarder vers le haut, et être coupé de la source de vie. Alors, malgré la bonne volonté de Dieu et malgré tout son amour pour nous, nous risquons de régresser et de mourir.
Marc Pernot
1 Matthieu 12:31
 Comme j’ai mis un article sur la traditionnelle question de l’existence du mal et de la souffrance dans le monde, il m’a semblé important de mettre quelque chose sur la question de l’existence du bien.
Comme j’ai mis un article sur la traditionnelle question de l’existence du mal et de la souffrance dans le monde, il m’a semblé important de mettre quelque chose sur la question de l’existence du bien.
L’existence du bien dans l’univers est beaucoup plus extraordinaire que l’existence du mal. En effet, les choses ne sont pas du tout symétriques :
- Pour créer un être humain un petit peu libre et capable d’aimer, il faut des dizaines d’années de travail et des centaines de participants actifs dans son développement.
- Pour tuer un être humain, il suffit d’une tuile qui tombe d’un toit, ou d’une défaillance d’un des organes vitaux pendant quelques instants, ou d’un misérable doigt qui tire sur une gâchette.
L’existence du bien est ainsi une réalité infiniment plus extraordinaire que l’existence du mal. L’existence du bien est un miracle.
Par définition, Dieu est la source première du bien, et le bien est ce qui va dans le sens de Dieu. Le bien, c’est la vie, c’est la bienveillance, la fidélité, et tout ce qui va dans ce sens. C’est vraiment une bonne nouvelle que nous puissions nous-mêmes être source de bien.
Marc Pernot
 La Bible est une bibliothèque de 66 livres. Les 39 premiers forment la Bible hébraïque (ou Ancien Testament), les 27 suivants ont été rédigés par les premiers disciples de Jésus-Christ et forment le Nouveau Testament. Pour lire la Bible, il est bon, à mon avis, de commencer par lire un des 4 évangiles, car ce sont pour nous les paroles et la vie du Christ qui nous aident à comprendre le sens de toute la Bible.
La Bible est une bibliothèque de 66 livres. Les 39 premiers forment la Bible hébraïque (ou Ancien Testament), les 27 suivants ont été rédigés par les premiers disciples de Jésus-Christ et forment le Nouveau Testament. Pour lire la Bible, il est bon, à mon avis, de commencer par lire un des 4 évangiles, car ce sont pour nous les paroles et la vie du Christ qui nous aident à comprendre le sens de toute la Bible.
La Bible Hébraïque a été rédigée en hébreu entre 1000 et 500 avant Jésus-Christ environ. Elle comprend :
- les 5 livres de la Loi (Torah). On lira principalement la Genèse et l’Exode.
- Les prophètes (lire en particulier le livre d’Ésaïe, et celui de Jonas).
- Les écrits (dont les 150 Psaumes qui peuvent être lus et relus tout au long d’une vie).
Le Nouveau Testament est centré sur la vie et le message donnés par Jésus-Christ (l’Évangile). Il comprend :
- Les 4 évangiles, 4 témoignages relativement différents sur la vie de Jésus (Matthieu, Marc, Luc, Jean). La lecture d’un évangile ne prend que quelques heures.
- Les Actes des apôtres, et quelques lettres de Paul, Pierre, Jean… montrent la vie et la pensée dans la première génération après Jésus.
- L’Apocalypse est un livre curieux qui a inspiré beaucoup de livres et de films fantastiques avec ses histoires de dragons.
Chaque page de la Bible est le témoignage d’une personne qui a été en relation intime avec Dieu. Dans le texte biblique, il y a donc à la fois quelque chose qui vient de Dieu et quelque chose qui vient de la personne humaine. Cela explique pourquoi ces témoignages sont si divers d’un livre à l’autre. Et cela explique comment la Bible peut nous être utile. La Bible ne sera source d’une Parole de Dieu pour quelqu’un que s’il la lit (bien entendu), et s’il la lit dans un esprit de prière (c’est-à-dire en acceptant que Dieu lui apporte quelque chose)
La diversité des points de vue qui se trouvent dans la Bible invite à réfléchir par soi-même, elle invite à discuter avec les autres avec tolérance. Cette diversité est une chance car elle lutte contre notre tendance naturelle à croire que notre point de vue personnel est le seul bon. C’est pourquoi un lecteur de la Bible ne peut pas être intégriste, à moins d’avoir vraiment l’intention de l’être.
La lecture de la Bible devrait même nous ouvrir l’esprit car elle nous aide à nous poser plein de questions, de bonnes et même d’excellentes questions sur notre propre façon de vivre et de penser.
Marc Pernot
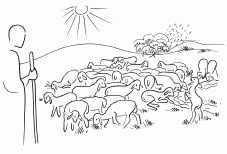 Selon une image très courante dans la Bible, le Bon Berger c’est le Christ, ou c’est Dieu 1. Cela veut dire que Dieu a pour chaque être humain l’attention, l’affection même, que le berger a pour un agneau. Il le guide là où il y a un pâturage et de l’eau, il le met à l’abri la nuit dans une bergerie pour qu’il ne soit ni dévoré par le loup ni volé par un brigand, il le soigne quand il est blessé et le recherche quand il est perdu et le porte quand il est fatigué2 … La théologie chrétienne au cours des premiers siècles a même largement représenté le Christ comme un berger portant un agneau perdu. Cela était pour eux un bon résumé de son rôle et de l’Évangile.
Selon une image très courante dans la Bible, le Bon Berger c’est le Christ, ou c’est Dieu 1. Cela veut dire que Dieu a pour chaque être humain l’attention, l’affection même, que le berger a pour un agneau. Il le guide là où il y a un pâturage et de l’eau, il le met à l’abri la nuit dans une bergerie pour qu’il ne soit ni dévoré par le loup ni volé par un brigand, il le soigne quand il est blessé et le recherche quand il est perdu et le porte quand il est fatigué2 … La théologie chrétienne au cours des premiers siècles a même largement représenté le Christ comme un berger portant un agneau perdu. Cela était pour eux un bon résumé de son rôle et de l’Évangile.
À l’époque de Jésus, les bergers étaient assez mal vus par les intégristes, car il est difficile d’appliquer à la lettre les commandements de la Loi religieuse quand on est dans la nature, et il est difficile de rejoindre la communauté pour lire la Bible si, à cause de son troupeau, l’on est un peu loin de la synagogue. Mais les bergers étaient par ailleurs réputés être proches de Dieu par la prière (la nature rend humble et admiratif de la création), et par le chant (comme David). Tout cela ressemble assez à ce que nous savons de Jésus, assez souple pour ce qui concerne la pratique religieuse, mais infiniment proche de Dieu et proche de chacun.
Il n’est donc pas très étonnant que l’Évangile nous dise que ce sont des bergers qui ont découvert les premiers que Jésus est le Christ 3. Nous sommes tous appelés ainsi à être à notre mesure des bergers.
Marc Pernot
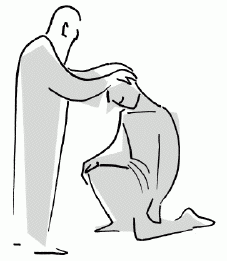 En français comme en grec, bénir signifie » dire du bien « . C’est déjà formidable que Dieu pense du bien de nous, c’est même encore plus qu’il nous bénisse en disant du bien de nous. Ça fait un bien fou. Il nous le dit au plus profond de quand nous nous ouvrons à lui par la prière, il nous le dit par le promesses contenues dans la Bible, par les paroles du culte… C’est une bonne idée de nous même bénir, en ce sens, les personnes de notre entourage (même si ce n’est pas dit sur un ton ni avec le nom de Dieu, c’est parfois opportun de le faire ainsi, parfois non). Et c’est une bonne idée de bénir son Dieu par une prière de louange et en témoignant du bien qu’il nous fait.
En français comme en grec, bénir signifie » dire du bien « . C’est déjà formidable que Dieu pense du bien de nous, c’est même encore plus qu’il nous bénisse en disant du bien de nous. Ça fait un bien fou. Il nous le dit au plus profond de quand nous nous ouvrons à lui par la prière, il nous le dit par le promesses contenues dans la Bible, par les paroles du culte… C’est une bonne idée de nous même bénir, en ce sens, les personnes de notre entourage (même si ce n’est pas dit sur un ton ni avec le nom de Dieu, c’est parfois opportun de le faire ainsi, parfois non). Et c’est une bonne idée de bénir son Dieu par une prière de louange et en témoignant du bien qu’il nous fait.
En hébreu, la langue de la première partie de la Bible, bénir signifie plus encore que dire du bien. La bénédiction de Dieu c’est le don de la vie, du bonheur et de la paix. Bénir c’est donner la vie, et un sens à la vie. Bénir Dieu c’est lui laisser de la place dans notre existence, c’est le laisser s’exprimer en nous, créer en nous ces dimensions nouvelles que sont la foi, l’espérance et l’amour. Bénir une personne c’est lui souhaiter que Dieu l’aide à se développer et à s’épanouir pleinement.
Quand on dit la bénédiction de Dieu sur une personne ou sur un groupe de personnes, on accompagne souvent les paroles de bénédictions tirées de la Bible par un geste de la main comme ouverte en direction de la personne. Ce geste très ancien d’imposition des mains rappelle bien que par sa bénédiction, Dieu est en train de créer la personne.
Ce qui est amusant, c’est que le mot bénir en hébreu se dit « baraq », mot que nous connaissons en français pour dire l’agenouillement du chameau (en fait le mot français bien de l’arabe, mais qui a la même racine que l’hébreu). Effectivement, la bénédiction vise à donner la paix à la personne, lui permettre de se reposer enfin comme à l’étape, se reposer car elle a enfin atteint le but. La bénédiction vise cela : souhaiter à la personne d’atteindre la pleine réalisation de son être. Pour filer encore la métaphore que permet cette étymologie, la bénédiction est comme ce genou qui plie pour se reposer, la bénédiction est une souple articulation entre nous, entre des personnes qui se bénissent mutuellement.
Vous pourriez voir aussi cette prédication « Vous bénirez ainsi »
Marc Pernot
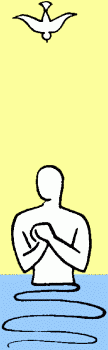
C’est un des deux sacrements pour les chrétiens protestants (l’autre est la communion), pour d’autres chrétiens comme les catholiques ou les orthodoxes, ce sont les deux sacrements principaux. Le geste du baptême est étroitement associé à l’entrée dans la communauté des chrétiens.
Il y a deux façons de comprendre le baptême :
- Pour ceux qui reconnaissent le baptême des bébés, le point essentiel qui fait de nous des enfants de Dieu, c’est la grâce de Dieu, c’est-à-dire le fait que Dieu nous considère a priori, sans condition, comme son enfant bien-aimé. Le baptême est un geste qui annonce cette grâce, dans l’espérance que la personne répondra un jour à cette grâce par la foi. Lors du baptême, un peu d’eau est déposée sur la tête du baptisé, en signe de la bénédiction de Dieu qui est source de vie.
- Pour ceux qui préfèrent réserver le baptême aux adultes, la foi personnelle est indispensable pour être reconnu comme faisant partie de la communauté chrétienne. Après avoir proclamé publiquement sa foi, le baptisé est plongé dans l’eau, comme s’il était lavé de sa vie ancienne pour renaître à une vie nouvelle.
Dans la vie de tous les jours, l’eau sert principalement à deux choses : pour se laver, et pour boire. Les deux façons de comprendre le baptême reprennent ces deux sens symboliques de l’eau :
- Dans le cas du baptême avant la profession de foi, l’eau est comme la pluie bienfaisante qui fait germer la vie, comme la source que trouve celui qui est dans le désert.
- Dans le cas du baptême après la profession de foi, l’eau est plutôt signe du pardon de Dieu qui vient laver notre impureté.
Le baptême d’un bébé lui laisse la liberté de plus tard faire une profession de foi ou de ne pas en faire, puisque la grâce de Dieu signifiée par ce baptême supprime toute idée de chantage de la part de Dieu. Il a choisi de nous aimer, il nous aimera de toute façon même quand nous lui tournons le dos.
Le baptême est donné une fois pour toute, puisqu’il est le signe de l’amour de Dieu (que rien ne peut diminuer), et c’est le signe que cette personne sera toujours considérée par les chrétiens comme ayant sa place dans notre famille. Mais l’autre sacrement, la communion, peut être renouvelée régulièrement, pour nous aider à sans cesse approfondir notre foi.
Marc Pernot
C
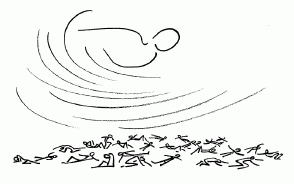
En français, le verbe « ressusciter » appartient au patois théologique, alors que les mots grecs de la Bible appartiennent au langage courant, ἐγείρω, egeiro ou ἀνίστημι, anistemi veulent dire se lever, comme on se lève de table ou on se lève le matin. C’est bien dommage car cela ne nous aide pas à comprendre ce que l’Évangile nous dit sur la notion de résurrection, la rendant particulièrement mystérieuse alors qu’elle nous est plutôt présentée dans la Bible comme une expérience qui est à vivre durant notre vie en ce monde, voire une expérience que nous avons déjà vécue, comme nous le dit Paul « vous avez été ressuscités avec Christ »1.
La Vie éternelle ce n’est pas, ou pas seulement, une vie future (après la mort de notre corps), mais une vie présente qui est éternelle par certains aspects, une vie qui est plus forte que la mort. Cette qualité est offerte par Dieu, c’est lui qui nous ressuscite ou qui ressuscite le Christ. C’est déjà une bonne nouvelle, nous n’avons pas à arriver tout seul à entrer dans la vie éternelle en construisant des pyramides ou en nous élevant à une telle qualité par la seule force de notre sagesse. La question semblerait plutôt de s’ouvrir à cette action de Dieu.
Dans l’Évangile selon Matthieu l’enseignement de Jésus commence par cette affirmation qui est le résumé ou la clef de tout l’Évangile : « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. »2 La vie éternelle est promise pour le présent, il suffit pour cela d’être « pauvre en Esprit », c’est-à-dire à mon avis de demander à Dieu son Esprit comme un mendiant demande du pain parce qu’il sait qu’il va mourir demain s’il n’a pas de pain aujourd’hui. C’est la même démarche qui nous est proposée, mais en d’autres termes, dans l’Évangile selon Jean il dit « Celui qui croit Fils a la vie éternelle »3 là encore nous avons un présent, et la question clef est celle de la foi (et non pas celle de la croyance, comme peut le laisser penser le verbe croire). Résurrection est conversion sont ainsi deux mouvements qui sont profondément liés, mais que l’on ne peut confondre, la conversion ayant l’homme pour sujet, alors que la résurrection a, elle, Dieu pour sujet.
« Le Christ est ressuscité » 4. est une annonce fondamentale de l’Église chrétienne qui ne peut être contournée quand on se pose des questions sur notre résurrection. Dans les évangiles, le Christ ressuscité a un mode de présence qui fait qu’il passe à travers les portes fermées, apparaissant et disparaissant en un clin d’œil5 . et se prolongeant, selon la célèbre conclusion de l’Évangile selon Matthieu6, « pour nous tous, tous les jours jusqu’à la fin du monde« . La présence du Christ ressuscité est ainsi plutôt une expérience de foi de ses disciples qu’une présence matérielle sur terre. Cette résurrection du Christ est importante pour nous car, nous dit l’Évangile, nous vivons véritablement si le Christ ressuscite en nous, s’il vit en nous7. Ces expressions sont un peu surréalistes, mais il s’agit d’une réalité très concrète qui est peut-être plus facilement compréhensible si l’on remplace le mot Christ par ce qu’il incarne, par exemple la foi, l’espérance ou l’amour. Vivre avec cette qualité d’être qu’est la vie éternelle, c’est quand l’amour vit en nous, est source d’une espérance vivante et d’une vraie fidélité à Dieu…
La question de la résurrection n’est donc pas tellement de savoir qu’est-ce qu’il y a après la mort du corps d’une personne. La question est plutôt de savoir si notre existence se limite aujourd’hui à cette vie biologique. Le mot de résurrection en français est là aussi trompeur car son préfixe « re » laisse penser à un retour en arrière. Or, il ne s’agit pas de cela, mais de la naissance d’une dimension supplémentaire dans cette vie présente, comme si notre corps pouvait enfin se lever, avancer, vivre vraiment, et aimer.
Certains se demandent s’il y a une vie après la mort. Ce n’est pas inintéressant, mais la question la plus urgente et la plus essentielle est plutôt de commencer déjà à vivre sans attendre cette mort. Mais quand même, la possibilité de la vie après la mort nous pose des questions, questions qui ne sont pas sans importance car ce que nous serons est aussi ce qui a une extrême importance maintenant. Une antique formule dit que nous croyons « en la résurrection de la chair« . Cela ne veut pas dire que nous croyons à la recomposition des protéines de notre corps de chair. L’apôtre Paul discute de cette question8, il dit que nous ne ressuscitons évidemment pas avec un corps de viande et de sang comme maintenant, mais avec un corps « glorieux » ou » spirituel « . Cela veut dire que même au-delà de la vie de notre corps de chair, nous resterons en vie avec certaines caractéristiques essentielles de notre corps :
- Notre corps est l’espace qui nous est réservé dans l’univers : dans l’au-delà nous resterons un individu, un être personnel. Et ce qui a une ultime valeur ici-bas, c’est chaque personne individuelle.
- Notre corps porte les traces de notre histoire, ce que nous avons vécu a contribué à nous construire. Nous resterons nous-mêmes dans l’au-delà, mais purifié par Dieu. Et aujourd’hui même, Christ nous propose de nous saisir de l’amour dont nous avons été aimés et de nous laisser créer par cela comme aimant à notre tour9.
Nous sommes en contact avec les autres et le monde par l’intermédiaire de notre corps, même dans l’au-delà nous serons des êtres de relation. Aujourd’hui, Christ nous montre que l’essentiel, c’est la qualité des relations que nous avons avec les autres, avec Dieu, mais aussi avec notre prochain10.
Mais heureusement, celui qui a un gros nez, ou un bras en moins ne ressuscitera pas avec des caractéristiques physiques particulières, et ce que l’on fait du corps des morts n’a aucune importance pour ce qui est de leur résurrection, le respect que nous leur devons est sentimental et symbolique (ce qui n’est pas peu de chose).
1 Colossiens 2:10
2 Matthieu 5:3
3 Jean 3:36
4 Luc 24:46, 1 Corinthiens 15:14
5 Jean 20, Luc 24
6 Matthieu 28:20
7 Galates 2:20
8 1 Corinthiens 15
9 Jean 15:9-12
10 Marc 12:30-31
Marc Pernot

Christ, ce n’est pas le nom de famille de Jésus mais c’est une fonction, comme roi, président ou charpentier. Christ est un mot grec (Christos), qui se traduit en français par Oint, et se dit en hébreu Messie.
Dans la Bible, un christ (avec une minuscule), c’est quelqu’un qui a reçu l’onction d’huile sainte pour faire de lui un serviteur de Dieu, chargé d’une responsabilité particulière (un ministère) :
- Un prophète est chargé d’annoncer le point de vue de Dieu.
- Un prêtre est chargé de prier Dieu, et de l’adorer.
- Un roi est chargé d’agir et de gouverner dans ce monde.
Un christ (avec une minuscule) est donc quelqu’un qui est chargé par Dieu de faire avancer les choses pour les gens qui l’entourent. Le Christ (avec un C majuscule) c’est cela mais d’une façon totalement radicale et universelle. Pour les chrétiens, Jésus de Nazareth est le Christ. Depuis 2000 ans, des milliards de juifs et de païens ont effectivement reçu de lui une vie nouvelle. Il est le Prophète ultime, le Grand-Prêtre ultime, et le Roi. Mais il est même plus que cela, il est celui par qui toute personne, même la plus simple est à sa mesure prophète (écoutant et annonçant la Parole de Dieu), prêtre (en priant Dieu) et roi (en agissant dans le monde au service des autres).
Bien des juifs ont reconnu en Jésus le Christ, à la suite des apôtres, de Marie, et de bien d’autres disciples de Jésus qui étaient tous des juifs. D’autres personnes du peuple juif attendent encore le Messie.
Marc Pernot
Quand Jésus dit » le sabbat est fait pour l’homme et non l’homme pour le sabbat » (Marc 2:27) il dit cela pour expliquer son attitude, libérale par rapport à cette excellente pratique religieuse qu’est le Sabbat. Cette réponse de Jésus est lumineuse, elle remet parfaitement les choses en place, en perspective dans notre existence. Ce qui importe dans la religion, ce n’est pas la religion elle-même mais c’est le projet de Dieu pour que l’homme puisse vivre
La religion doit être faite pour la personne humaine, pour son développement, son cheminement, sa création. C’est cela qui est sacré aux yeux de Dieu, pas la religion en elle-même.
Cette phrase de Jésus, nous pouvons la décliner pour chacun des éléments fondamentaux de notre religion. Le culte est fait pour nous aider, la prière est faite pour nous aider, la Bible est écrite pour nous. Ce sont des moyens qui nous sont donnés, comme on offre un vélo d’appartement à quelqu’un qui doit faire de l’exercice pour être plus en forme.
Le protestantisme, et particulièrement le protestantisme réformé, insiste sur cette juste place du culte dans la vie du fidèle : un simple moyen fait pour l’homme, mais un moyen utile. L’expérience montre que la participation au culte est très efficace pour avancer, pour approfondir sa réflexion personnelle, mais aussi sa relation à Dieu et ses relations aux autres. Cela fait près de 2500 ans que l’on expérimente cette efficacité, depuis le développement du culte à la synagogue. Ce culte est apparu, lui aussi, comme un mouvement de réforme, nous en avons gardé les traces dans la Bible, dans les Psaumes et les paroles des prophètes qui critiquent le côté purement formel des rites qui étaient pratiqués au Temple de Jérusalem et dans les autres lieux de sacrifices. Jésus reprend plusieurs de ces paroles, par exemple : » C’est la miséricorde que j’aime et non les sacrifices, c’est la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » (Osée 6:6, Matthieu 9 :13). Tout, dans le Temple et dans les rites du Temple, était considéré comme infiniment sérieux, important, sacré. Les prophètes, et Jésus encore plus, remettent l’acte religieux à sa place. L’acte religieux n’est pas fait pour Dieu, comme le pensaient les prêtres du temple, mais l’acte religieux est fait pour l’homme, nous dit Jésus. Le culte est un moyen utile au service de la personne humaine, pour qu’elle progresse dans sa qualité d’être, dans sa capacité à vivre bien, dans sa capacité à faire du bien, grâce à une juste relation avec son prochain et avec son Dieu.
Le culte est fait pour l’homme. Mais il y a quand même un culte que l’on peut rendre à Dieu. Ce culte, c’est la conversion personnelle. C’est ce que l’on voit dans la conclusion de la parabole de la brebis perdue. Jésus dit qu’il y a » de la joie dans le ciel » pour un seul pécheur qui change d’orientation grâce à Dieu, plus que pour 99 juste qui seraient déjà en train de chanter des Alléluyah (Luc 15). C’est ainsi que le véritable culte (littéralement : le service) rendu à Dieu n’est pas l’acte visible et extérieur, mais ce qui se passe à l’intérieur de l’homme. C’est ce que Jésus explique à la Samaritaine , il lui dit qu’à partir de maintenant ce n’est plus sur telle montagne ou telle autre que nous adorerons le Père, mais » en Esprit et en fidélité » (Jean 4:21-24).
L’essence du culte c’est donc la conversion. C’est cela qui rend service à Dieu. Car cette démarche nous fait du bien, et Dieu se réjouit de nous voir recevoir la vie. Le culte doit être fait pour l’homme, très concrètement, très pragmatiquement pour que nous puissions avancer. Cela demande des réglages assez fins, car il faut que le culte puisse à la fois être assez fort pour aider la personne à avancer réellement mais, qu’en même temps, ce culte ne soit pas le sommet de la vie spirituelle du fidèle, qu’il reste un simple moyen au service de la prière et de la réflexion personnelle de chacun.
Pour avancer en marchant, il est utile d’avoir un pied qui s’appuie sur le sol pendant que l’autre prend le risque de se lancer en avant. Il semble qu’il en soit de même pour notre cheminement personnel. Nous avons besoin d’un enracinement solide et nous avons besoin d’un élan, d’une prise de risque vers l’avant. À l’Oratoire, nous avons choisi d’avoir notre pôle d’enracinement dans la forme et d’avoir le souffle de nouveauté dans le fond. D’autres églises, et c’est leur droit, ont une forme de culte moderniste et un fond très conservateur. C’est pourquoi notre culte est délibérément dépouillé, presque austère. Nous évitons de jouer sur l’ambiance ou la sensiblerie, l’atmosphère est recueilli. La liturgie du culte cherche à exprimer cet enracinement. A travers un cadre stable et des paroles essentiellement tirées de la Bible elle-même. La prédication cherche à partir de la Bible mais en portant sur des questions profondes, abordées sans complaisance, le but étant plus d’aider chacun à se poser des questions, à se remettre en question que d’apporter des réponses.
Le fait même de se déplacer (un dimanche matin !) pour aller dans ce lieu étrange, avec des personnes que l’on a pas choisies et très diverses, pour participer à ce culte est déjà un exercice spirituel en soi. On peut se dire à soi-même : » montre moi ton agenda et je te dirai qui tu es, ce que tu vas devenir ! « . C’est ainsi que des personnes comme Paul Ricœur et Théodore Monod, qui avaient déjà quelques moyens de penser par elles-mêmes, allaient au culte régulièrement. C’est un choix, celui de faire une place à Dieu. C’est une démarche, et c’est un témoignage.
Quand nous allons au culte, peut-être que ce jour-là, les chants ne nous plairont pas, peut-être que la prédication ne nous parlera pas, mais le fait même d’avoir creusé un espace dans notre emploi du temps, le fait même d’avoir espéré avancer grâce à Dieu et d’être sorti de chez nous pour aller avec les autres, cette démarche portera son fruit en nous et pour les autres. Et finalement, le succès indéniable du culte dominical est peut-être là. Cela expliquerait que parmi les activités de notre église, la plus suivie soit le culte. Les techniques modernes de communication élargissent encore ce succès, puisque sur notre site Internet aussi, les pages sur le culte et les prédications sont de très loin les pages les plus visitées, et qu’à la télévision ou à la radio les cultes sont bien plus suivis que les débats.
Et pour la personne qui a du mal à venir physiquement au culte, ou qui aurait du mal encore à franchir le pas en se déplaçant physiquement ? Nous essayons de proposer des enregistrements du culte (sur CD ou cassette), nous envoyons chaque semaine aux personnes qui le désirent le texte de la prédication (quand elle est disponible), et nous mettons sur Internet la vidéo de la prédication.
Rien de tout cela n’est possible sans votre participation. C’est ensemble que nous faisons le culte à l’Oratoire. Et c’est par la foi, dans le secret de notre espace intérieur que nous rendrons un culte à Dieu, celui de la miséricorde et de la conversion.
Marc Pernot
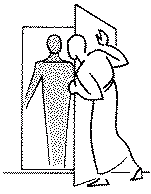
Être » croyant » dans la Bible, c’est une question de foi, pas de doctrine. C’est une question d’espérance en Dieu.
Le critère pour être croyant n’est pas celui de la croyance, pas même celle d’être certain que Dieu existe. C’est à la fois plus et moins que ça. Il y a des personnes qui pensent que Dieu existe mais qui ne pensent presque jamais à lui : elles ont la croyance en Dieu mais elles ne sont pas croyantes au sens de la Bible, elles ne sont pas tellement fidèles puisque leur relation à Dieu est en réalité presque nulle. Par contre, pour quelqu’un qui doute de l’existence de Dieu ou qui ne sent pas sa présence, il est possible de le chercher et d’espérer en lui, il lui est possible de lire la Bible et même de prier, il peut ainsi chercher à vivre en espérant rencontrer Dieu un jour. Il est alors un vrai » croyant « .
Sur cette question, il y a un malentendu terrible entretenu par une faute de traduction très fréquente. Dans les Évangiles, il y a souvent marqué que l’essentiel est de “ croire ” : croire en Dieu, croire en Jésus-Christ, croire en son nom… Quand on entend une telle affirmation, on peut penser que cela veut dire que c’est une question de vie et de mort d’avoir telle ou telle croyance. Or, le verbe traduit alors par croire ne veut pas du tout dire ça. Le verbe pisteuo (en grec) ou aman (en hébreu) n’est pas du domaine de la croyance mais du domaine de la foi, de la relation à Dieu, d’une relation maintenue même si c’est pour s’opposer à lui (comme Abraham devant Sodome et Gomorrhe 1, ou Moïse sur la montagne 2) ou en doutant de lui (comme David dans le Psaume 22)…
À parrtir du malentendu sur ce verbe croire, on a longtemps répété aux gens qu’il fallait croire ceci pour être sauvé mais surtout ne pas croire cela parce qu’alors on serait perdu en dehors de la » vraie foi « . Les gens ont donc souvent pris peur, évitant de penser et prenant pour sacrées telles ou telles croyances. Mais Jésus n’est pas comme ça, il insiste sur la foi, la confiance en Dieu, dans son amour. Nous pouvons alors nous tourner vers lui (nous “ convertir ”) et c’est lui-même qui nous éclairera, peu à peu, sur ce que nous devons penser.
Marc Pernot
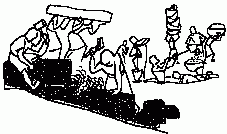
Il est difficile de dire qui est Dieu, mais la chose qui me semble la plus certaine que l’on puisse dire sur Dieu c’est qu’il est créateur. C’est d’ailleurs sur cette notion que s’ouvre la Bible : Dieu qui entreprend de créer le monde en mettant en ordre le chaos primordial1 . L’Évangile selon Jean reprend cette notion fondamentale pour dire que la venue du Christ est un acte de création aussi considérable, mais dans le domaine de la grâce et de la vérité (voir ces articles).
Dire que Dieu est créateur cela a plusieurs conséquences importantes dans notre compréhension de Dieu et du monde.
- Cela veut dire que le monde est bon, d’abord. Il existe des pensées selon lesquelles la réalité spirituelle seule a de la valeur et que le monde matériel est mauvais. Ce n’est pas le cas du christianisme, nous pensons que Dieu crée l’univers et qu’il le fait pour le bonheur et pour la vie.
- Mais dire que Dieu est créateur, c’est dire aussi que la dimension spirituelle prime sur le monde matériel. Ce n’est pas la matière seule qui en se perfectionnant peu à peu d’elle-même arrive à la conscience et à l’amour. Mais c’est l’inverse, c’est une conscience et un amour, Dieu, qui a choisi de s’intéresser et d’agir dans le domaine matériel.
Ces éléments sont donc importants sur le plan de notre pensée, mais également sur notre façon de concevoir la vie et de la vivre.
Dieu est créateur, et nous sommes appelés à l’être, à notre façon, selon notre personnalité. Nous ne sommes pas appelés à être de purs esprits en sortant du monde, mais à être créateurs dans le monde, dans le domaine matériel comme dans le domaine spirituel, pour continuer la création d’un monde plus juste.
Et comme en Dieu la dimension spirituelle prime sur le matériel, qu’il en soit ainsi pour nous, que ce soient notre foi, notre espérance et notre amour qui aient la priorité sur les autres dimensions de notre existence et qui inspirent notre façon de vivre.
Personne n’a jamais vu Dieu2 , mais comme Dieu est créateur, nous pouvons voir ce qu’il fait, et ce n’est pas rien. La prodigieuse dynamique d’évolution qu’a connue l’univers dans les 15 à 18 derniers milliards d’années fait raisonnablement penser qu’un créateur a participé à cette œuvre (voir l’article sur Dieu). Il y a plusieurs interprétations possibles de la Bible, certains lecteurs pensent à partir de ces textes qu’il n’a pu y avoir d’évolution dans l’univers et que le monde a été créé tel quel par Dieu. D’autres théologiens pensent que Dieu crée le monde en suscitant une dynamique d’évolution. On peut tout à fait avoir l’un ou l’autre avis tout en étant profondément croyant et respectueux de la Bible. Personnellement je pense que Dieu crée en appelant le monde et les êtres à évoluer.
Comme exemple de texte biblique soutenant cette idée, il y a le magnifique Psaume 121 qui dit littéralement “Le secours me vient de l’Éternel qui est en train de créer les cieux et la terre…”. La traduction habituelle de ce psaume est malheureusement trompeuse quand elle dit que l’Éternel “a fait (au passé) les cieux et la terre”, mais le verbe est au participe présent dans le texte hébreu, ce qui veut dire qu’une caractéristique essentielle de Dieu est d’être sans cesse en train de créer. Ce passage et de nombreux autres passages de la Bible montrent que Dieu est encore créateur aujourd’hui et qu’il sera toujours la source d’un mouvement d’évolution qui concerne l’univers entier. Ce point de vue est cohérent avec ce que nous observons dans notre monde, par nos yeux et par la science.
Ce point est également important face à l’existence du mal dans le monde (voir cet article). Nous sommes inachevés, l’univers est inachevé, et Dieu poursuit son œuvre de création, ou tente de la poursuivre avec patience et amour. Comprendre cela influe sur notre compréhension de l’existence du mal en ce monde, sur notre relation à Dieu, et sur notre façon de vivre. Alors nous pouvons nous révolter face au mal et prier comme Jésus nous le propose dans l’espérance que son “règne vienne sur la terre comme au ciel”, nous pouvons le prier, sachant qu’il est notre aide, une aide infiniment plus sage et puissante que ce que nous pouvons imaginer.
Marc Pernot

Conversion et repentance sont des mots qui appartiennent au langage religieux. Dans la Bible, le vocabulaire employé à l’origine était bien plus simple et concret.
Se convertir, dans la Bible, c’est se tourner dans une autre direction, sous-entendu : se tourner vers Dieu. L’Évangile ne nous demande pas d’être à tel niveau (de foi, de morale, de quantité de prière), mais simplement de se tourner vers Dieu. C’est la principale chose que nous pouvons faire, ou plutôt être. Tout le reste en découle.
Se tourner vers Dieu c’est être disposé à évoluer (ce qui est déjà formidable) et c’est placer son espérance en Dieu et attendre quelque chose de lui (c’est vouloir avancer dans ce sens-là grâce à lui, avec lui).
Se convertir c’est vouloir avoir la foi, ou avoir plus de foi. La conversion est ainsi de l’ordre du choix personnel. Même dans le doute ou dans l’erreur, on peut se dire » c’est vers là que je veux me tourner ! «
L’Évangile annonce la grâce de Dieu et il met l’accent sur notre conversion, sur cette simple orientation de notre regard dans cette direction, ce qui est facile quand on sait que Dieu nous attend avec vraiment la volonté de bien nous accueillir et de nous aider. L’Évangile est ainsi vraiment libérant. Il pourrait nous demander de croire ceci, d’être persuadé de cela, d’agir de telle ou telle façon, de se priver de ceci, ou prier de telle façon en telle et telle quantité… Au lieu de cela, le Christ nous propose » simplement » de nous tourner vers Dieu. Et il nous dit qu’on peut le faire sans crainte. Dieu nous aidera à avancer, à notre rythme.
Fondamentalement, l’appel de Jean-Baptiste et de Jésus « convertissez-vous » est un appel à se tourner vers Dieu, à espérer en lui, à le choisir comme source de notre cheminement et but de ce cheminement. C’est donc un appel à la foi, un appel à un changement profond dans notre mentalité.
Cet appel « convertissez-vous » est parfois traduit dans certaines versions de la Bible par « repentez-vous » c’est un peu dommage car le but est plus profond qu’une réflexion sur nos actes, le but c’est bien cette conversion qu’est la foi. Mais il y a quand même quelque chose de vrai dans cet appel « repentez-vous », car la première étape de la démarche de conversion est la repentance.
La repentance consiste à avoir un regard lucide sur soi-même, sur sa manière de vivre avec ce qu’elle a de bien et de moins bien. L’aide de Dieu est en réalité indispensable pour avoir un regard vraiment lucide sur nous-mêmes, mais on peut commencer à réfléchir sur cette question même si l’on n’a pas encore vraiment la foi. C’est l’occasion de ressentir que l’on a du bon et du moins bon en nous-mêmes. C’est l’occasion de nous rendre compte que nous avons du mal à trouver nous-mêmes la paix intérieure et que nous n’arriverons pas à mettre de l’ordre dans notre vie par nos seules forces humaines. La repentance est ainsi comme une préparation à espérer le pardon et l’aide de Dieu, notre Créateur. La repentance nous prépare à la conversion, elle nous ouvre à la foi.
Et un commencement de foi approfondit notre repentance, rendant plus lucide notre regard sur nous-mêmes et nous donnant l’expérience de l’irremplaçable aide de Dieu pour avancer.
C’est ainsi que la repentance et la conversion, ou la repentance et la foi, sont comme deux jambes qui nous permettent d’avancer.
Marc Pernot

Un adulte qui a reçu le baptême quand il était un bébé n’est pas obligé de devenir chrétien. C’est sa liberté. Il n’a pas choisi de recevoir le baptême, de même que l’on ne choisit pas d’avoir des parents qui vous aiment (si on a cette chance). La grâce est le choix de Dieu, sans chantage de sa part ; quand nous répondons à cet amour en l’aimant un peu, c’est une bonne surprise pour lui. L’amour de Dieu appelle ainsi la foi de l’homme.
L’essentiel se joue ainsi dans le secret de cette relation entre une personne et Dieu, mais bien souvent cela nous aide de marquer des étapes dans notre vie par un geste solennel. Quand une personne désire répondre à l’amour de Dieu publiquement devant l’église pour la première fois, il » confirme » l’existence de ce lien qu’il y a entre Dieu et lui, lien que Dieu a établi le premier en aimant la personne. La confirmation est ainsi le complément du baptême. Une préparation et un âge suffisant sont nécessaires pour affirmer sa foi en Christ en connaissance de cause.
La confirmation n’est faite qu’une fois, mais on peut désirer faire une profession de foi publique (au cours d’un culte) à l’occasion d’un nouveau départ ou d’une étape importante dans sa foi.
Marc Pernot
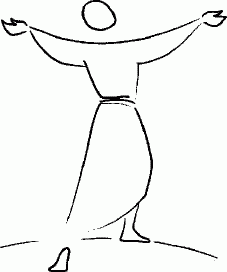
Il est vraiment utile de réfléchir sur ce que l’on croit, de creuser la question en discutant, en lisant et en priant… C’est comme cela que l’on a une chance de progresser dans sa théologie mais aussi dans sa façon de comprendre la vie. Jésus nous a donné un coup de main essentiel pour progresser dans cette réflexion. Quand Jésus parle, ces débats duraient déjà depuis des millénaires, comme on le voit dans la Bible, et à la suite de Jésus, ces débats ont continué de plus belle.
Jésus nous encourage à avoir foi en Dieu, bien entendu, mais aussi à penser notre foi (voir l’article sur l’intelligence). La foi est du domaine de la relation à Dieu, cette relation nourrit une pensée rationnelle, une théologie et une philosophie de vie. Et, inversement, notre théologie n’est pas neutre, une bonne théologie stimule notre recherche de Dieu, elle influe sur notre façon de comprendre ce qu’est le bien, et nous aide pour témoigner de notre foi auprès des autres.
Une “ confession de foi ” est en général un texte assez court, de quelques lignes qui cherche à dégager quelques points essentiels de notre réflexion, quelques points prioritaires pour nous. Il serait donc plus juste d’appeler cela une “ confession de croyances ” qu’une confession de foi, mais pourtant, à travers ces mots, c’est bien la foi qui nous pousse à parler.
La confession de foi s’exprime souvent à la première personne » Je crois en Dieu, le Père… Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur… « . Au cours du culte, la personne qui préside choisit ou rédige une confession de foi et la propose à l’assemblée.
Une des plus anciennes et courtes confessions de foi chrétienne est » Jésus-Christ est le Seigneur « 1, ce qui est commun à absolument tous les chrétiens. Elle veut dire :
- Que cet homme, Jésus, est le Christ, c’est-à-dire qu’il est envoyé par Dieu comme sauveur de l’humanité et donc en particulier mon sauveur.
- Et cela veut dire que je reconnais ce Jésus-Christ comme le Seigneur, c’est-à-dire comme ayant une importance capitale pour ce que je veux être, sur ce que je connais de Dieu. Mais ces conséquences, il m’appartient de les chercher en termes de croyances, d’actes de services, d’actes religieux, de don… selon ce que ma conscience me dictera, éclairée par Dieu lui-même.
Si nous sommes ainsi unis par une même foi (au sens de relation à Dieu par Christ), nous sentons que nous sommes alors déjà assez en communion entre nous pour lire la Bible ensemble, prier ensemble, participer à la Sainte-Cène ensemble. La diversité des confessions de foi est même une chance car elle nous rappelle qu’aucune confession de foi n’est parfaitement fidèle à Dieu et au Christ. Cette diversité nous encourage ainsi à poursuivre le chemin dans l’humilité et le dialogue avec les autres.
Marc Pernot
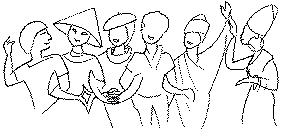
1 1 Corinthiens 12:3 ; Philippiens 2:11
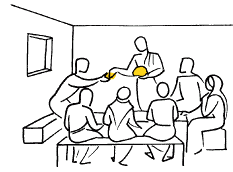
La communion est un des deux sacrements (l’autre est le baptême). Il consiste à prendre un peu de pain et de vin avec les autres participants du culte.
On appelle ce repas de différents noms selon le sens que l’on désire privilégier, mais chacun des sens de ce geste est important :
- Communion, sous entendu » communion avec le Christ « , avec sa vie, ses paroles et son Père (Dieu). Pour les chrétiens, le Christ est présent, même si les façons de comprendre cette présence divergent un peu. Pour les protestants, il s’agit d’une présence spirituelle, Christ ayant promis d’être avec nous 1.
- Saint-Cène, par référence au dernier repas de Jésus avec ses disciples, juste avant d’être exécuté. (Cène voulant dire repas en latin). En nous souvenant de ce repas, nous sommes comme rassemblés par le Christ avec ses premiers disciples.
- Repas du Seigneur. C’est ainsi que la première génération de chrétiens appelait ce geste. Le Repas du Seigneur, c’est le repas que l’on prend dans le paradis à la table du Messie. Par le Christ, nous sommes ainsi déjà partiellement dans la vie éternelle, même si nous sommes encore sur terre.
- Eucharistie. Ce mot grec signifie » remerciement « , sous entendu remerciement à Dieu pour tout ce qu’il nous donne.
La Communion est un geste qui dit deux choses qui se complètent :
- le don que Dieu nous fait en Christ (à travers le pain et le vin qui sont offerts). Le pain évoque la Parole de Dieu qu’incarne le Christ. Le vin évoque la vie que le Christ nous donne, et la joie intérieure qui va avec.
- la foi de la personne qui prend et qui mange ce que Dieu lui offre, exprimant ainsi son désir de vivre de plus en plus en communion avec Dieu grâce au Christ.
La communion a ainsi une dimension individuelle importante, elle est un rappel du baptême (signe de ce que Dieu nous donne) et un renouvellement de notre profession de foi (toujours à approfondir). La communion a également une dimension communautaire, car l’ensemble des êtres humains en communion avec le Christ est comme un corps dont le Christ serait la tête 2.
C’est le Christ qui nous invite à sa table, et il invite chaque personne sans distinction. Toute personne qui le désire peut donc participer à la Communion en signe de son désir de vivre de ce que Dieu nous donne en Christ, et de prendre sa place avec les autres dans la communauté des chrétiens.
Voir aussi cet article.
Marc Pernot
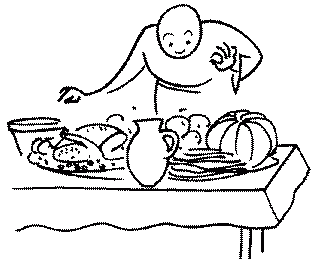
Dieu ne nous demande pas de devenir de purs esprits. Le monde où nous sommes est fait pour que nous connaissions le bonheur et notre corps est une dimension essentielle de notre être en ce monde.
Dieu ne nous demande donc pas de renoncer à la chair, c’est lui qui nous l’a donnée. Mais il nous donne aussi son Esprit pour que nous ne vivions pas n’importe comment, mais que nous soyons un peu à l’image du Dieu créateur, du Dieu qui aime, du Dieu fidèle, du Dieu qui donne du bonheur.
Pourquoi, par exemple, se priver de la joie qu’offre le plaisir de manger de bonnes choses ? Cela fait partie des dons de Dieu, pour nous rendre la vie joyeuse. Mais la foi fait vivre cette joie un peu différemment. D’abord dans la louange, en remerciant Dieu pour la joie reçue. Ensuite en remettant cette joie à sa place, non comme notre raison de vivre mais comme un simple bonus.
La foi peut nous donner aussi l’envie de vivre cette joie avec d’autres, ou pour que d’autres puissent en avoir aussi… Dieu peut nous aider aussi à avoir la force de nous contrôler afin que, par exemple, la gourmandise ne nous abîme pas, en nous diminuant physiquement (en devenant énorme), ou mentalement (en devenant à moitié ivre).
Jésus n’est pas contre la joie, ni pour nous, ni pour lui-même. Il est même critiqué par certains, selon les évangiles, d’être un bon » mangeur et buveur « , et bien souvent il nous est montré participant à des fêtes et des repas…
La question des plaisirs du sexe est du même ordre mais probablement un peu plus complexe puisque qu’une autre personne est en jeu. Là encore, le plaisir n’a rien de sale ni d’opposé à la volonté de Dieu, au contraire. Ce qui est vrai, c’est que le sexe en dehors d’une relation d’amour et d’engagement n’est pas une bonne chose. Ce n’est pas que cela fâche Dieu, mais simplement parce que cela est nuisible à l’épanouissement de tout le monde. Par contre, quand 2 personnes veulent vivre ensemble toute leur vie et se rendre mutuellement heureux, le sexe est une très belle chose et peut les rapprocher encore. Cela aussi est un don de Dieu.
Marc Pernot
D
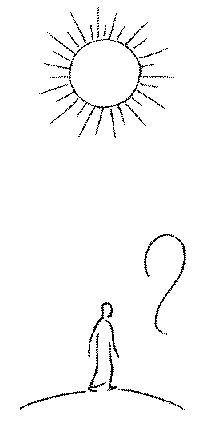
La science progresse en se remettant en question, en réfléchissant sur ce qui ne colle pas tout à fait pour perfectionner le modèle. La pensée théologique avance également grâce au doute. Celui qui n’aurait pas de doute en théologie serait bien trop certain de ce qu’il pense. Il serait persuadé que sa pensée est une vérité divine. On n’est alors pas loin de l’idolâtrie, cette sorte d’erreur qui consiste à prendre une construction humaine comme Dieu.
Le contraire de la foi, ce n’est pas le doute mais plutôt de ne pas s’intéresser à Dieu. Celui qui doute s’intéresse quand même à Dieu, il peut le prier même s’il doute de sa présence, il peut le chercher même s’il ne sait pas bien qui il est.
Pour ce qui est de l’existence de Dieu, on peut évidemment en douter à différents degrés, ce serait dommage de trancher cette question trop vite. Tout dépend de ce que l’on entend par le mot Dieu, si c’est un vieux monsieur barbu assis quelque part dans le ciel, je n’y crois pas non plus. Si l’on entend par Dieu en tant que dynamique d’évolution dans l’univers, je pense qu’il existe et qu’il est même plus que ça… De toute façon, l’essentiel est de chercher Dieu, car le chercher c’est déjà espérer, c’est déjà être en relation à l’essentiel, le chercher, c’est déjà avoir la foi, comme le dit Blaise Pascal, qui dans un moment de doute, a reçu cette pensée importante : « Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m’avais trouvé »1
Marc Pernot
1 Pensées 553
D’un point de vue rationnel, il est probable que Dieu existe
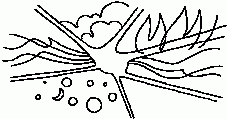 Certaines choses sont invisibles, mais existent pourtant. C’est, par exemple, le cas de l’air : on ne le voit pas, mais s’il manque, on s’en rend vite compte. Et quand on voit bouger les branches des arbres, nous déduisons logiquement qu’il y a quelque chose qui les agite.
Certaines choses sont invisibles, mais existent pourtant. C’est, par exemple, le cas de l’air : on ne le voit pas, mais s’il manque, on s’en rend vite compte. Et quand on voit bouger les branches des arbres, nous déduisons logiquement qu’il y a quelque chose qui les agite.
De même, Dieu est invisible mais on a besoin de sa présence et on peut voir son action dans le monde visible. La science nous apprend que le monde est en évolution. L’explication la plus vraisemblable de ce mouvement est l’existence de » quelque chose » d’extérieur à l’univers qui en est la cause, l’origine et le sens. Ce n’est pas une preuve absolue, mais c’est assez raisonnable de le penser. Si on découvre une maison isolée dans une forêt, il n’est pas absolument impossible que le seul hasard ait déposé des pierres en forme de murs, puis des gros morceaux de bois taillés en forme de charpente, puis des morceaux de fers en forme de clous, et de la terre en forme de tuiles… rien ne le prouve absolument, mais il est quand même assez raisonnable que cette maison ait été construite par quelqu’un. Or, le monde est encore en évolution, mais déjà en l’état, il est infiniment plus complexe et merveilleux qu’une petite maison.
Dieu existe, on peut le rencontrer
« J’ai rencontré Dieu » c’est ce que nous disent les milliards de croyants du monde entier, même si certains croyants très sincères n’ont jamais eu l’impression de faire cette expérience. Cette relation à Dieu a commencé du temps de l’homme des cavernes quand il dessinait des bisons sur les parois, ou dressait des pierres, ou faisait un culte pour la naissance ou la mort d’un proche. Tous les peuples ont une religion, car tous ont eu cette expérience de l’existence d’une source de vie au-delà de la simple matière : un être que nous appelons Dieu (en français), God (en anglais), Allah (en arabe)… Aujourd’hui des quantités de gens, des chercheurs en physique quantique, des cuisiniers, des philosophes ou des chasseurs de phoques prient et peuvent témoigner de cette expérience de leur rencontre avec Dieu. Et ils disent que cette réalité est fondamentale pour eux.
Qui est Dieu ?
Chacun se fait une idée de Dieu, aucune n’est parfaitement exacte, il n’y a pas deux personnes qui ont exactement la même conception, car la façon de voir Dieu est une chose très personnelle. C’est normal. Si l’on demande à plusieurs personnes de décrire un individu donné, les façons de le voir seraient relativement différentes sur certains points et semblables sur d’autres. Les mêmes personnes diraient encore un peu autre chose un an après… Il y a ainsi des différences entre les religions et des différences de théologie entre les gens d’une même religion, et il y a évidemment une différence radicale avec ceux qui choisissent de ne pas s’intéresser à Dieu ou de nier toute idée de dieu.
Le point commun entre tous les chrétiens est de faire confiance en Jésus de Nazareth pour savoir qui est Dieu. Cela implique en particulier l’idée d’un Dieu unique qui aime chaque être humain sans condition, qui aime la vie et qui la rend plus forte que tout et si belle.
Personnellement je trouve cela vraiment bien comme Dieu, et tout en respectant les autres religions, plus je les découvre, plus je me réjouis de faire confiance au Père de Jésus-Christ, cela me convient mieux que de prendre l’humanité comme dieu, ou mon ventre comme dieu, ou l’argent, ou mes petits loisirs…
Est-ce que je m’intéresse à Dieu ?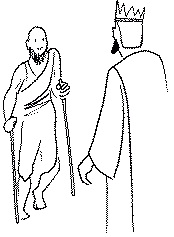
La majorité des gens croient en l’existence de Dieu, même en France qui est un des pays du monde où il y a le plus d’athées. Mais cela ne veut pas dire pour autant que tous ces gens choisissent de faire une place à Dieu dans leur vie. Sans être athées du point de vue de leur convictions, ils vivent néanmoins comme étant sans-dieux (athées).
Le point délicat est en réalité là : est-ce que l’on choisit de se donner une orientation pour son existence, et est-ce que l’on choisit Dieu comme orientation, est-ce que l’on compte sur lui pour avancer ?
Mais dans tous les cas, même si l’on ne s’intéresse pas à lui, Dieu s’intéresse à chacun de nous parce qu’il considère chacun comme un être unique et irremplaçable. Même si on ne croit pas en Dieu, il est bon de savoir que Dieu, lui, croit en nous. C’est ce que l’on appelle la grâce.
Et si, finalement Dieu “n’existait pas” ?
Cela ne rendrait pas du tout inutile de chercher à savoir qui est Dieu, c’est une façon de chercher à définir notre idéal de vie, et de fonder notre réflexion sur l’Évangile, une des plus belles philosophies de vie. Et ce ne serait vraiment pas du temps perdu de prier Dieu, ce serait alors au moins une façon sincère de placer sa journée passée et sa vie future devant cet idéal.
Mais en plus, Dieu existe. Il existe à sa façon unique en son genre. Et il a quelque chose de fantastique à nous apporter.
Marc Pernot
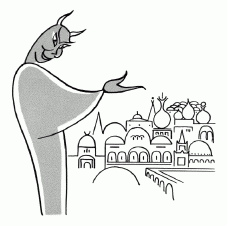
Certains croient qu’il existe une puissance négative personnifiée (ayant une volonté propre) : le Diable, ou Satan, ou le Malin. D’autres (dont je suis) pensent qu’il y a une seule et unique puissance transcendante, un seul Dieu, et qu’il est bon. Ce seul Dieu suffit à comprendre l’existence de l’univers, et ce qui s’y passe.
Quelques textes de la Bible parlent du diable ou de satan. Il y en a fort peu, et l’on n’est pas obligé de comprendre ces textes comme parlant d’une personne individuelle.
À l’époque de la Bible une théologie assez répandue était dualiste (avec deux dieux, un bon qui construit et un mauvais qui démolit, avec des anges dans chaque camp). La plupart des personnes qui ont écrit la Bible connaissaient cette façon de voir, mais ils s’en distinguent délibérément par leur compréhension du monde avec un Dieu unique. Pour eux, la création du monde ne se fait pas dans une lutte entre une puissance du bien (Dieu) et une puissance du mal (diable, esprit du mal, ou dieu des ténèbres), mais Dieu crée le bien en mettant de l’ordre dans le chaos 1.
Peut-être que certains auteurs de la Bible ont gardé dans un coin de leur théologie des traces de pensée dualiste, comme on voit quelques traces de polythéisme dans certains des textes les plus anciens de la Bible 2. Mais ce n’est pas certain du tout qu’ils aient cru un jour à l’existence d’une personne maléfique dans le ciel ou sous la terre…
» Satan » veut dire tout simplement l’ennemi, et » diable » cela veut dire ce qui divise, ce qui éparpille. Dans les deux cas, nous n’avons pas besoin d’aller chercher bien loin pour nous sentir personnellement concernés. Nous avons nos ennemis intérieurs, parfois terribles. Il nous arrive aussi de lutter contre le bien, de blesser ou de tuer, il nous arrive donc d’être une force qui divise et produit du chaos. Nous sommes divins, mais aussi sataniques et diaboliques par certains côtés, nous sommes tous ainsi, plus ou moins.
Mais, hors de l’homme, je ne vois pas où serait dans l’univers l’œuvre d’un mal personnifié. Si une sorte de dieu méchant (ou un ange déchu, si l’on veut l’appeler comme ça) cherchait à faire le mal, il enverrait des cancers ou des coups de foudre sur les personnes les plus merveilleuses. Or, nous observons que les catastrophes naturelles frappent au hasard, indépendamment de la valeur spirituelle et morale de la personne.
Il n’y a dans le monde que l’être humain pour combiner volontairement le mal. Il n’y a que l’homme pour être, parfois, satanique. L’animal ou la nature n’en sont pas capables.
Marc Pernot
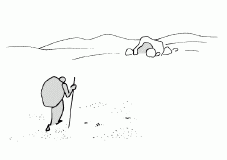
Il se passe beaucoup de choses dans le désert, en tout cas dans la Bible.
C’est dans le désert que le peuple hébreu avance vers la « Terre Promise », c’est-à-dire vers la libération, l’abondance et la paix que Dieu leur offre. C’est dans le désert que Dieu leur parle et les nourrit. C’est dans le désert que Jean-Baptiste annonce la venue du Christ. C’est dans le désert que Jésus se prépare à assumer sa mission et qu’il a la victoire sur ses tentations, c’est dans le désert qu’il va pour prier Dieu…
Pourquoi est-ce que la Bible attache tant d’importance au désert ?
D’abord à cause d’un jeu de mot. En hébreu, le mot « désert« , מִדבָּר, midbar signifie littéralement « pour-la-Parole« . Dans la Bible, le désert n’est pas un lieu où il n’y a rien, c’est le lieu où l’homme est seul avec la Parole de Dieu.
Mais au-delà du jeu de mot, il y a une réalité : il est bon de se retirer régulièrement à l’écart, dans le silence, pour se retrouver en vérité soi-même avec son Dieu. Il est bon aussi de faire silence, d’arrêter un peu le tourbillon de ses distractions, d’arrêter un moment de parler soi-même pour s’ouvrir à ce que Dieu veut nous offrir.
À chacun de trouver son rythme et les moyens qu’il se donne pour de se retirer ainsi dans le désert.
Marc Pernot
E
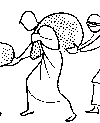
Jésus ne nous offre pas sur un plateau une bonne petite morale prête à appliquer à la lettre. Au contraire, ce qu’il nous propose c’est tout simplement » d’être parfait comme notre Père céleste est parfait » ! 1 Cela semble fou comme commandement moral, mais en réalité c’est formidable. Car cette morale responsabilise sans culpabiliser.
Cela ne culpabilise pas, car comment pourrait-on nous en vouloir de ne pas arriver à être parfait ? Nous sommes tous frères et sœurs face à cette réalité.
Mais en même temps, cette morale que nous propose le Christ nous tourne vers un idéal, un vrai, pas un idéal de petit joueur, un idéal magnifique qui a l’avantage d’être cohérent avec notre théologie. L’idéal que Jésus nous propose, c’est de vivre comme Dieu lui-même vit, d’être créateur de bonheur et de vie comme lui, d’aimer même unilatéralement, comme lui,…
Cet idéal infini est génial. Par exemple, si le Christ nous avait dit : un bon chrétien donne 10% de ses revenus pour la solidarité matérielle et spirituelle avec les autres :
- Celui qui y arriverait se dirait qu’il est vraiment un bon chrétien, qu’il a fait ce qu’il faut, et même plus que ce qui lui était demandé. Ce ne serait bon ni pour lui-même (il a atteint le but demandé), ni pour sa relation à Dieu (il n’a plus besoin de lui pour aller plus loin), ni vis-à-vis des autres (qui n’ont pas tous réussi à être si généreux).
- Celui qui n’arriverait à donner que 8% parce qu’il est en train de s’acheter une maison ou qu’il a je ne sais quelle difficulté, ou pas assez de volonté… celui-là serait culpabilisé, ce qui n’est pas la volonté de Dieu.

Heureusement, le Christ ne nous donne jamais ce genre de petites consignes morales. Il ne nous dit pas que nous devons donner 10%, il ne nous dit pas non plus que nous devons » partager » avec nos frères et sœurs dans le besoin, ni de délivrer les esclaves, ni de prier tant de fois par jour,… Ce qu’il nous dit va bien plus loin.
Ce que nous propose le Christ comme direction de vie, c’est d’être parfait comme notre Père est parfait.
Ce que nous dit le Christ c’est de donner notre vie pour les autres. Ce n’est pas simplement un discours, puisque Jésus donne effectivement sa vie. Heureusement, nous n’avons en général pas à mourir pour le service des autres, mais notre idéal reste un idéal infini : c’est d’être à l’image de Dieu lui-même, comme le Christ l’a été.
Notre idéal est infini et magnifique. Nous nous en imprégnons, et ensuite, nous faisons ce que nous pouvons, en conscience, sachant que Dieu comprend, pardonne, aime son enfant tel qu’il est, même imparfait, même pécheur. Dieu a de l’ambition pour nous : il nous donne son idéal, il fait tout pour nous aider aussi à le vivre.
1 Matthieu 5:48
Marc Pernot

Une certaine idée de la justice est celle du donnant-donnant. Selon cette conception, quand quelqu’un a fait une faute, cette faute doit être payée d’une manière ou d’une autre, la faute doit être expiée, vengée. Parfois, cette logique est particulièrement cruelle, une simple offense étant punie de mort. L’équité est déjà un progrès par rapport à la vengeance, c’est ce que propose le principe « œil pour œil, dent pour dent » 1, c’est-à-dire que si quelqu’un crève un œil à un autre dans un accident, on lui crève un œil en échange, c’est déjà mieux que de le tuer pour ça. Cette équité qui a été la base de la justice à une certaine époque selon la Bible serait déjà un grand progrès dans les pays où l’on coupe une main à un voleur, ou quand une personne risque la peine de mort pour des questions religieuses.
Le Christ propose un autre type de justice que l’équité, il propose la justice de l’amour, de la bienveillance et du service. À la place du principe « œil pour œil », Jésus nous propose d’aimer nos ennemis, de bénir et prier pour ceux qui nous font du mal. Et il ajoute que c’est comme ça que Dieu agit envers le coupable.2
Notre péché contre Dieu n’est donc pas à expier. Dieu n’attend pas que quelqu’un paye pour la faute, il n’est pas dans cette logique-là du donnant-donnant. Le problème de la faute c’est qu’elle provoque des souffrances (que l’on doit essayer de consoler et guérir). Il aussi faut éviter qu‘il y ait d’autres victimes. Le problème, enfin, c’est que la faute montre que son auteur a besoin de progresser. Avec le Christ, l’expiation d’une faute marche dans l’autre sens que dans l’ancien temps. Avant, il fallait que le coupable paye (ou que quelqu’un paye pour lui). Au contraire, avec le Christ, il faut que le coupable soit aidé, on paye donc pour soigner le coupable. C’est ce que fait Dieu, en tout cas, il est prêt à tout donner pour qu’un seul homme progresse et devienne quelqu’un de vraiment bien. C’est ce qu’il montre en Christ.
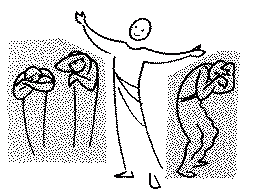 L’expiation n’est donc pas pour acheter l’amour et le pardon de Dieu : de toute façon il nous aime toujours. Mais l’expiation est donnée par Dieu pour que nous puissions enfin être guéri et aimer 3.
L’expiation n’est donc pas pour acheter l’amour et le pardon de Dieu : de toute façon il nous aime toujours. Mais l’expiation est donnée par Dieu pour que nous puissions enfin être guéri et aimer 3.
À partir de quelques rares textes du Nouveau Testament, des théologiens chrétiens ont tenté de rétablir l’ancienne expiation en disant que Dieu ne pouvait pas pardonner nos fautes sans que quelqu’un paye, et que le Christ en souffrant beaucoup sur la croix a ainsi acheté le pardon de Dieu pour l’humanité. C’est surtout un théologien du Moyen-âge qui a bien présenté cette théorie au XIe siècle (Anselme de Cantorbery). Cette théorie revient bien des siècles en arrière avant le Christ, à l’époque où l’on pensait qu’un sacrifice humain pouvait plaire aux dieux !
Au contraire, la bonne nouvelle du Christ, l’Évangile, c’est que Dieu est amour, et que son amour, comme tout amour véritable, ne s’achète pas. Pour nous, le cœur même de l’Évangile c’est que le premier à aimer (même ses ennemis) : c’est Dieu. Il n’a nul besoin et nulle joie de voir un homme souffrir et être crucifié. Heureusement. Quand le Christ meurt sur la croix, ce n’est certainement pas à Dieu qu’il apprend à aimer et à pardonner, c’est à nous qu’il tente d’apprendre à aimer. Christ nous montre combien il aime l’humanité malgré tout, et cela nous donne une idée de l’amour infini de Dieu pour nous.
Marc Pernot
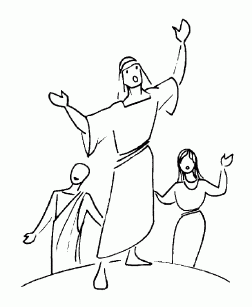
Évangile est un mot grec εὐαγγέλιον, evangelion (composée de eu-, « bon », et ange, messager) qui veut dire « bonne nouvelle ». L’Évangile avec une majuscule est le message donné par Jésus-Christ, mais c’est également plus que cela, l’Évangile c’est Jésus-Christ, sa personne et sa vie.
Pour connaître cet Évangile de Jésus-Christ, nous avons principalement quatre témoins qui nous ont laissé chacun un livre que, du coup, on appelle des évangiles (avec un é minuscule). D’autres textes nous permettent de connaître l’Évangile, comme les « Actes des apôtres » et les lettres de Paul, de Jean, de Pierre, Jacques et Jude, et encore l’Apocalypse de Jean. On n’appelle pas ces autres textes des évangiles car on réserve ce terme aux livres qui sont présentés sous la forme d’une vie de Jésus, les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Nous connaissons d’autres « évangiles » que ces quatre-là. En particulier l’évangile de Thomas dont on avait entendu parler et qui a été retrouvé dans des fouilles dans les années 1950. Ce texte comprend probablement des passages très anciens, peut-être même des paroles de Jésus prises en note de son vivant. Mais ce texte comprend aussi des textes qui ont certainement une autre origine philosophique et théologique que celle du Christ (des textes gnostiques, qui sont bien moins intéressants).
Les évangiles sont présentés comme une vie de Jésus, mais ce n’est pas ce que l’on entend aujourd’hui par une biographie. Les évangiles ne sont pas des livres d’histoire mais des prédications inspirées par la vie de Jésus. Comme le dit l’auteur de l’Évangile selon Jean, chaque élément du récit est écrit pour nous permettre se saisir le salut qui nous est offert en Christ1. Les événements racontés dans l’évangile ne parlent donc pas, ou pas seulement du passé, de ce qui est arrivé en l’an 30 à Jérusalem ou à Capharnaüm, mais de ce qui peut nous arriver aujourd’hui par la foi en Christ. Pour lire ces textes, on doit se mettre dans la peau des différents personnages, pour se laisser relever de notre péché comme la femme adultère2, pour se laisser ouvrir les yeux comme avec l’aveugle guéri par Jésus3, pour ressusciter comme Lazare4, pour être libéré de ce qui nous empêche d’avancer et des forces de mort qui nous condamnaient. Et nous sommes également appelés à nous mettre à la place de Jésus, en étant, à notre mesure, celui qui aide, éclaire, console et fait vivre.
Les premières générations de chrétiens se sont mises d’accord pour garder les 4 textes les meilleurs et les plus anciens sur Jésus-Christ. Leur diversité est une véritable leçon d’ouverture. La liberté de penser et de s’exprimer existait vraiment à l’origine du christianisme.
La lecture d’un évangile en entier ne prend que 2 ou 3 heures seulement. C’est une bonne idée d’avoir lu au moins deux des évangiles, par exemple ceux de Matthieu et de Jean.
Marc Pernot

Cette personne que l’on appelle Dieu (élohim en hébreu) est appelée aussi d’un autre nom dans la Bible. Ce nom a été révélé par Dieu à Moïse au buisson ardent1 : YHWH ( en hébreu). Les juifs ne prononcent pas ces 4 lettres, par respect pour Dieu et pour résister à l’illusion de penser que l’on pourrait connaître totalement Dieu. Mais on sait que YHWH se prononçait Yahou, ou en abrégé, Yah. En effet, il reste des traces de l’ancienne prononciation dans des noms propres comme Ésaïe qui se dit en hébreu Yesha-Yah ou Yesha-Yahou (l’Éternel délivre).
en hébreu). Les juifs ne prononcent pas ces 4 lettres, par respect pour Dieu et pour résister à l’illusion de penser que l’on pourrait connaître totalement Dieu. Mais on sait que YHWH se prononçait Yahou, ou en abrégé, Yah. En effet, il reste des traces de l’ancienne prononciation dans des noms propres comme Ésaïe qui se dit en hébreu Yesha-Yah ou Yesha-Yahou (l’Éternel délivre).
YHWH pourrait se traduire en français approximativement par » Je suis. Je serai « . Ce nom est important d’un point de vue philosophique : Dieu est le seul qui existe véritablement en tant que tel. Tout le reste est arrivé à l’existence comme une conséquence d’autres choses qui l’ont précédé, comme nous descendons physiquement de nos ancêtres. Dieu, lui, n’est issu de rien d’autre que lui-même, il n’en a pas besoin car il est éternel, il est l’être même, celui qui était, qui est et qui vient, comme le dit l’apôtre Jean 2.
La traduction » l’Éternel » rend bien cette conception de Dieu, mieux que la traduction » le Seigneur » qui évoque l’idée de quelqu’un qui commande, et mieux que Yahwé ou Jéhovah qui sont de maladroits essais de prononciation de YHWH.
Dans la Bible, les mots » Dieu » et » YWHH » ne sont pas interchangeables. Ils évoquent deux façons dont la même personne, Dieu-YHWH, agit dans le monde :
- Il est appelé Dieu quand il est créateur. Pour créer, Dieu sépare ce qui est bien de ce qui est mal, il agit pour mettre en valeur le bien, et pour faire reculer le mal, c’est une des spécialités de Dieu, mais ce n’est pas tout…
- Il est appelé Éternel (YHWH) quand il sauve, quand il aime, quand il nous associe à notre propre création. On comprend qu’il faille un autre mot, parce que quand il sauve quelqu’un, quand il pardonne, l’Éternel accepte la part de mal qui est en nous (c’est ça, aimer). Et donc en aimant, l’Éternel se salit les mains, pour ainsi dire, alors que Dieu rejette activement le mal.
Le mot Dieu évoque plutôt le côté masculin de Dieu (dans les fonctions traditionnelles du Père de famille), l’Éternel évoquerait plutôt le côté maternel de Dieu, avec cette tendresse qu’une maman peut avoir pour son bébé, bien qu’il ne soit pas (encore) capable de grand chose.
La Confession de foi fondamentale de la Bible, dans laquelle apparaît le génie théologique des hébreux, c’est d’avoir compris qu’une seule et même personne est à la fois Dieu et YHWH, qu’il juge et qu’il aime, qu’il crée et qu’il sauve. Voilà cette magnifique confession de foi avec Moïse :
Écoute, Israël, l’Éternel notre Dieu, l’Éternel est Un.3
Cette confession de foi est d’ailleurs reprise par Jésus :
Voici le premier commandement : Écoute, Israël,
le Seigneur notre Dieu, est l’unique Seigneur,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force.4
Chercher à écouter l’Éternel notre Dieu, c’est une réponse intelligente et fidèle à la grâce et la puissance de Dieu-YHWH.
1 Exode 3:14
2 Apocalypse 1:8
3 Deutéronome 6:4
4 Marc 12 :29
Marc Pernot
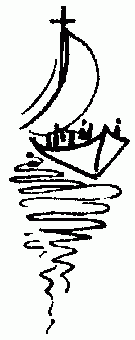
Dans les langues de la Bible (en hébreu, comme en grec), il y a un seul mot pour dire : » esprit « , » vent » ou » souffle « . C’est un courant d’air qui est utilisé dans la Bible pour servir d’image à la présence de Dieu dans le monde, à sa grâce qui nous offre la vie, et à son action parfois si discrète, parfois si puissante. Comment cette image curieuse a-t-elle pu germer dans la tête des théologiens hébreux ? C’est que Dieu est invisible (un peu comme l’air qui nous entoure), mais que l’expérience de sa présence et de son action est quelque chose dont toute personne peut faire l’expérience.
Le souffle, l’air que nous respirons, c’est la chose la plus indispensable à notre vie. On peut facilement oublier qu’il existe, on peut même s’en passer quelques secondes, mais s’il manque nous mourrons très vite. L’air est offert à tout le monde, il suffit de le respirer. C’est ainsi que la grâce de Dieu est offerte à tous et qu’il est naturel de se donner la peine de recevoir Dieu pour vivre de sa présence.
Le vent est une puissance qui peut être violente ou très douce. C’est une bonne image pour expliquer le mode d’action de Dieu sur la Terre, pour dire de quel type est sa puissance : Dieu agit dans le monde comme un vent poussant des navires sur la mer. C’est comme cela que Dieu poursuit sans cesse l’œuvre de sa création, il est une force et une direction qui sont proposées. L’être humain n’est pas inerte, comme le serait un grain de sable dans le vent, mais nous choisissons d’accepter ou de ne pas accepter l’élan que Dieu propose (c’est nous qui tenons le gouvernail de notre vie et c’est nous qui ouvrons ou fermons les voiles au vent de l’Esprit de Dieu).
La notion de trinité développée par l’église dans les premiers siècles après Jésus donne à l’Esprit une place importante. Cette notion un peu complexe ne doit pas nous faire penser que l’Esprit serait un morceau de Dieu. Quand on parle de l’Esprit de Dieu c’est une métaphore, une image (Dieu n’est pas fabriqué avec des molécules de gaz, comme l’air), et cette image évoque une des façons dont Dieu agit dans le monde et dans l’histoire 1.
C’est extraordinaire que la Bible nous dise que Dieu donne son Esprit à l’être humain lors de sa création 2. Dieu donne ainsi à l’être humain d’être un peu comme lui :
- L’Esprit guide le serviteur de Dieu 3, les prophètes, et donc le Christ, plus que tout autre 4 , et à sa suite, c’est chaque personne, même la plus humble, qui est appelée à recevoir l’Esprit, et à devenir prophète 5 .
- L’Esprit console, réconforte, c’est pourquoi il est appelé parfois le » consolateur « , ou le » défenseur » (en grec le Paraclet 6 ).
- L’Esprit donne la vie 7, une vie si profonde et vraie qu’elle est plus forte que la mort.
- L’Esprit est créateur 8 et nous sommes appelés à être créateurs. 9
1 Genèse 1:1-5
2 Genèse 2:7-17
3 Ésaïe 11
4 Luc 4:14…
5 Actes 2:1-6, 17-18
6 Jean 14:15…
7 Romains 8:9…
8 Genèse 1:2
9 Genèse 2:15
Marc Pernot
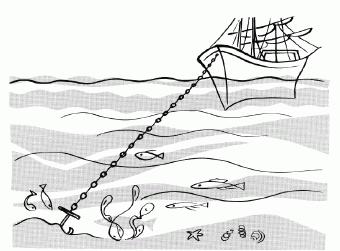
En hébreu, le mot espérance désigne aussi la corde qui sert à attacher des choses ensemble. L’espérance c’est comme un lien qui nous accroche à quelque chose de solide, comme une corde accrochée à une ancre permet à un bateau de ne pas aller à la dérive. Notre espérance est dans le Dieu de Jésus-Christ. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous sentons que ce lien est solide et sûr. Cette confiance que nous pouvons avoir en Dieu est basée sur la certitude de sa fidélité, qui garantit notre avenir1 .
L’apôtre Paul dit que trois choses seulement demeurent, l’espérance en fait partie avec la foi et l’amour 2 . Le salut peut tarder, l’espérance peut être enfouie, mais elle ne disparaît pas car nous savons que notre avenir est dans la bonne main de Dieu. En Christ, cette espérance n’est pas seulement une belle idée mais le salut de Dieu est une réalité concrète. Nous sommes bien reliés, au-delà du visible, à du solide.
1 C’est ainsi qu’Abraham espère (Romains 4:18)
2 1 Corinthiens 13.
Marc Pernot
Cette notion existe plus dans l’imaginaire populaire que dans la Bible. Selon certaines traditions, l’enfer serait un lieu de torture éternelle pour ceux qui sont recalés par Dieu à l’examen d’entrée au Paradis.
Cette façon de voir est bien simpliste et n’est pas cohérente, à mon avis, avec ce que le Christ nous dit de Dieu. Comment pourrait-il torturer son enfant, même une seule seconde ? Comment pourrait-il même abandonner un de ses enfants dans le néant pour l’éternité ? C’est impossible à penser quand on a entendu Jésus-Christ comparer Dieu à un berger qui va à la recherche de la moindre des brebis perdues, et qui ne cessera pas de la chercher encore en encore jusqu’à ce qu’il la retrouve 1.
L’Ancien Testament parle effectivement du séjour des morts (le Shéol 2). À l’époque, les croyants se demandaient si l’on y était encore vivant. Dans ce débat, Jésus prend position en affirmant que la vie continue après la mort du corps.
Dans l’Evangile, le Christ parle de la Géhenne3 , en utilisant ainsi le lieu de la décharge municipale de Jérusalem comme image. On y brûlait les ordures, le feu ayant alors plus le rôle de purification que de torture, pour nettoyer et assainir la ville. Nous pouvons donc comprendre cette façon de parler de Jésus comme un appel à reconnaître qu’une part de notre vie n’est pas bonne, certes, mais aussi comme une bonne nouvelle puisqu’il nous annonce que ce qui est impur et nauséabond dans notre vie sera ainsi éliminé et purifié par le jugement de Dieu. Il gardera le trésor de bonté qui existe en chacun, même s’il est parfois bien caché.
Au sens spirituel, l’enfer c’est être loin de Dieu, c’est être aujourd’hui coupé de lui. Nous sommes tous pécheurs, mieux vaut moins que plus, mais nous le sommes tous et donc partiellement en enfer, partiellement en souffrance, partiellement dans le néant. Mais nous sommes aussi, heureusement, déjà un peu au paradis par ce quelque chose de divin qui nous habite et dont le signe est une certaine capacité à aimer. C’est ce qu’exprime magnifiquement l’apôtre Jean dans cette fameuse proclamation de l’Evangile : »tout ce qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. »4
Marc Pernot
1 Luc 15:4
2 Voir par exemple le Psaume 6
3 Voir par exemple Matthieu 10:28
4 1 Jean 4:7
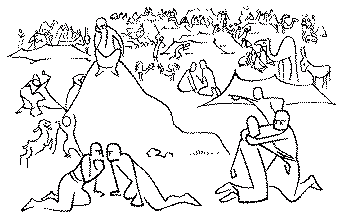

Dieu nous considère de toute façon comme son fils ou sa fille chéri, même une personne qui lui tourne le dos. L’idéal pour nous est d’être devant lui comme un de ses enfants, un tout petit enfant.
Jésus nous dit cette bien curieuse chose : « Je vous le dis, en vérité, une personne qui ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n’y entrera pas. ». Ce n’est évidemment pas du chantage, ni une menace, car ce n’est pas le genre de Jésus et ce n’est pas par la peur que Dieu cherche à nous faire avancer. Au contraire, c’est en nous donnant confiance. Jésus nous dit que le Royaume de Dieu est tout proche, grand ouvert, et l’on peut y entrer immédiatement, c’est son message essentiel. Et dans cet enseignement, il nous montre la porte du Royaume, il nous donne la clé pour y entrer : il suffit de le recevoir comme un petit enfant.
Jésus nous propose d’être comme un enfant, même si l’on a 115 ans, ou plutôt d’avoir certaines qualités qu’ont les enfants (on n’est pas forcé d’imiter leurs défauts). Dans un petit enfant, ce qu’il y a de formidable c’est qu’il a soif d’apprendre, de progresser, de devenir grand. Un enfant sait aussi qu’il a besoin des parents (même s’il les trouve parfois gênants sous certains aspects). Quand on est comme un enfant avec Dieu, on est vraiment dans une bonne dynamique, on est alors en train de recevoir le Royaume de Dieu, nous dit Jésus, car entrer dans le Royaume, c’est cela : faire confiance à Dieu pour vivre et avancer.
Marc Pernot

Le mot » église » signifie » ceux qui sont appelés hors de chez eux « , appelés à se mettre en route par Dieu. C’est l’appel de Dieu qui fonde l’église, ce n’est donc pas nécessairement une pensée commune, ou un chemin commun, mais une même voix qui appelle chacun. L’Église avec un grand É est cette large communauté qui dépasse largement toutes les institutions humaines (les églises avec un petit é). L’Église est constituée de la multitude des hommes et des femmes appelés par Dieu en Christ. Les églises, elles, sont constituées de ceux qui entendent cet appel et veulent y répondre concrètement en célébrant Dieu mais aussi en témoignant de l’Évangile de multiples façons. Ces fidèles se rassemblent alors en fonction de leur sensibilité personnelle et de l’endroit où ils sont.
Dans la Bible, le livre des Actes des apôtres raconte les débuts de l’Église, d’abord à Jérusalem par une expérience spirituelle forte qu’ont connue les proches de Jésus à la Pentecôte 1, puis de proche en proche, de nombreuses églises naîtront grâce au témoignage de chrétiens qui fera entendre l’appel de Dieu en Christ, l’Évangile. Dès le départ, chaque chrétien avait sa sensibilité personnelle, bien entendu. Il y avait par exemple Pierre, l’apôtre au caractère fougueux, et Jean, le théologien poète si proche de Jésus. Il y avait Paul qui était favorable à l’abandon des pratiques religieuses compliquées de la religion juive, et d’autres chrétiens qui tenaient à les conserver…
La diversité des individus est une chance, elle fait la richesse de l’humanité. La diversité des églises est également une chance si chacune sait qu’elle n’est qu’un membre particulier de l’Église avec un grand É. Cette diversité permet de mieux faire sentir l’infinie valeur de l’Évangile, elle peut être une chance pour tous de progresser vers une plus grande fidélité au Christ.
Bien entendu, une église n’est pas plus parfaite que les êtres humains qui la composent. Chaque église a besoin de se convertir, de progresser, de se réformer sans cesse pour être plus fidèle au Christ et mieux remplir son rôle. Cela n’est possible que dans la mesure où les chrétiens s’engagent dans leur paroisse, disent leur opinion, font avancer les choses.
La mission de l’Église, et donc des églises c’est :
- de témoigner de l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui par une foi vivante,
- de se rassembler pour célébrer Dieu, lire la Bible et la méditer, afin de nourrir la foi et le questionnement de chaque membre,
- d’unir des personnes pour mieux servir notre prochain.
D’expérience, c’est vrai que l’église est comme une salle de musculation pour la foi. En choisissant d’aller au culte régulièrement, notre foi est de plus en plus en forme.
Marc Pernot
1 Actes 2:1-6
F
Jésus
Marc Pernot
Bien des personnes pensent aujourd’hui que la foi c’est le sentiment de la présence de Dieu, le sentiment religieux. Ce n’est pas tout à fait exact.
Le mot » foi » dans la Bible évoque la confiance, la fidélité, la solidité. Et ainsi, même quand on ne sent pas particulièrement la présence de Dieu (ce qui arrive à tout le monde) on a quand même la foi quand on reste tourné vers Dieu à l’espérer, si on garde confiance en lui, si on continue à le chercher, à le célébrer, à attendre sa bénédiction.
Quand Dieu manifeste sa présence pour nous, c’est une grâce, mais le fait que Dieu soit parfois comme absent est également une grâce, comme quand des parents s’effacent un peu pour laisser plus d’autonomie à leur enfant adolescent. Il y a plusieurs paraboles dans les évangiles où Jésus présente Dieu comme un maître qui s’absente pour un temps assez long, laissant des personnes libres de gérer1 . Les personnes fidèles continuent à vivre selon la Parole du maître, et attendent son retour. C’est ça la foi.
La foi n’est donc pas un sentiment, c’est d’abord un choix que l’on fait, une orientation.
Il peut y avoir parfois une certaine confusion entre la foi et les croyances, comme si avoir la foi c’était penser ce qu’il faut, connaître et croire telle ou telle doctrine. C’est vrai que la théologie et ce que l’on pense ont de l’importance, mais la foi est plus profonde que la simple croyance. La foi, c’est être tourné vers Dieu, c’est espérer en lui. C’est pourquoi Jésus peut montrer en exemple la foi d’un centurion romain2 alors que cet homme n’avait certainement pas une théologie exemplaire, il devait même rendre un culte à l’empereur de Rome comme dieu. Ses croyances pourront progresser par la suite, mais il a déjà une foi formidable que l’on voit dans sa démarche pleine d’espérance et d’humilité devant le Christ de Dieu.
Jésus lui-même, au moment où il est exécuté sur la croix, fait preuve d’une foi intense mais où le doute surgit. Il se sent abandonné de Dieu, il ne ressent plus sa présence à ses côtés. Que fait-il ? Il crie sa révolte contre Dieu, disant » Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? « 3 Bien entendu, Jésus n’a alors pas perdu la foi, puisqu’il reste fidèle à Dieu en s’adressant à lui. Avec du recul, il est facile de dire que Dieu ne l’avait pas abandonné, Dieu n’abandonne pas ses enfants. Jésus fait ainsi un reproche injustifié à Dieu, mais qu’importe, il reste en relation à Dieu par sa prière, par sa pensée tournée vers lui, s’adressant à lui. Nous comprenons facilement l’angoisse dans laquelle l’homme Jésus se trouve, le sentiment d’injustice et d’abandon. Et Dieu le comprend encore mieux que nous-mêmes.
Avoir la foi, c’est cela : se tourner vers Dieu, et rester tourné vers lui.
La foi a des conséquences dans le domaine des actes et de la pensée. Quand Jésus résume l’essentiel de ce qu’il nous propose de vivre, il dit :
Voici le premier commandement : Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, est l’unique Seigneur : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, et de toute ta force. :… et tu aimeras ton prochain comme toi-même. 4
Écouter Dieu, c’est la foi. Écouter : c’est une attitude, un choix. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même sont déjà des conséquences de la foi, des conséquences dans le domaine des actes (la morale), dans le domaine de l’intelligence (la théologie et la philosophie), et dans le domaine religieux (la prière).
1 Marc 13:34, Marc 12:1, Matthieu 25:14, Luc 19:12, Luc 12:36
2 Matthieu 8 :5
3 Matthieu 27:46-50
4 Marc 12 :29-31
Marc Pernot

Jésus nous apprend à appeler Dieu « Notre Père »1 . Qu’est-ce que cela nous apprend sur Dieu, sur nous ?
La Père c’était quelqu’un que l’on respectait comme le chef de famille. C’est une bonne idée d’écouter ainsi ce que Dieu nous dit.
Si le Père est Roi, les enfants sont prince ou princesse. Le Fils est ainsi presque l’égal du Père. Dieu donne donc des consignes, mais pas comme un patron à ses employés. Il est plutôt comme un Père qui écoute ses enfants, tient compte de leurs avis, et leur confie des responsabilités importantes.
Le Père c’est aussi celui qui nous donne tout, comme un père prépare son fils pour qu’il reprenne, par exemple, la ferme et les terres de la famille. Pour les enfants, l’héritage est un vrai cadeau, car les parents auraient très bien pu tout dépenser pour faire la fête et ne rien laisser, mais Dieu est un Père généreux. Nous sommes chez nous en ce monde, il ne nous laisse pas tomber, mais il compte sur nous pour que nous poursuivions son œuvre de création, en embellissant la vie autour de nous comme le Christ aurait pu le faire.
Dieu est notre Père et notre Mère. Il nous a donné la vie biologique, il nous a aussi donné son Esprit qui nous fait vivre de sa vie à lui. Nous sommes ainsi vraiment ses enfants.
Mais, en plus, nous dit la Bible, nous sommes enfants de Dieu parce qu’il nous adopte 2. C’est vraiment rassurant. Parfois nous sommes loin de lui ressembler (ce qui arrive, quand nous faisons du mal), parfois nous refusons d’être son enfant (quand nous rejetons son Esprit). Et bien, même alors, Dieu continue à nous reconnaître, lui, comme son enfant bien aimé parce qu’il a choisi une fois pour toutes de nous adopter et de nous bénir comme son enfant bien-aimé.
Jésus appelle souvent Dieu « Mon Père », et nous pouvons le suivre en cela comme en toute chose. Mais il nous apprend aussi à savoir dire « Notre Père » pour nous réjouir d’être aimé par Dieu mais en reconnaissant aussi que les autres sont pour moi des frères et sœurs selon Dieu.
Dans les évangiles, Jésus est souvent appelé « fils de l’homme », en hébreu « fils d’Adam », et il est appelé aussi « fils de Dieu ». Il est à la fois les deux, un humain, un fils d’Adam fait de poussière, fabriqué avec des atomes ordinaires. Et il est aussi fils de Dieu, un être d’une richesse infinie, un être capable du meilleur par pure générosité. Jésus est le modèle pour tout homme et toute femme. Il est le Fils par excellence, le Fils premier né d’un très grand nombre de frères et sœurs 3. Nous sommes tous des fils et des filles d’humains, et nous sommes tous des fils et des filles de Dieu par l’Esprit 4. Cette double nature fait la richesse et la complexité de la vie humaine.
1 Matthieu 6:9, Jean 20:17
2 Romains 8:15, Éphésiens 1:5
3 Romains 8:29
4 Jean 1:12-14
Marc Pernot
G

Quand un roi pardonne à l’un de ses sujets, on dit qu’il lui fait grâce. Quand quelqu’un est attirant sans être nécessairement beau, on dit qu’il a de la grâce, ou du charme… Bref, la grâce, c’est une sorte de bienveillance qui est une faveur, comme un cadeau immérité.
L’Évangile commence sous le signe de la grâce de Dieu avec la personne de Jean-Baptise, qui appelle à vivre du pardon de Dieu. D’ailleurs le nom même de Jean annonce la grâce de Dieu parce que » Jean » en hébreu se dit » Yohanan » = » l’Éternel fait grâce « .
Cette notion est centrale dans la Bible, et particulièrement dans l’Évangile. Parler de la grâce de Dieu cela veut dire que le salut n’est pas à acheter, mais offert gracieusement (gratuitement) par Dieu, parce qu’il a choisi librement de nous donner la vie, tout simplement parce que nous avons du prix à ses yeux et qu’il nous aime 1.
On a parfois pensé que Jésus nous sauvait parce qu’il aurait payé pour nos fautes sur la croix, et que cette mort était nécessaire pour que Dieu puisse nous pardonner. Cette façon de comprendre le salut n’est pas la seule possible. La grâce de Dieu c’est au contraire l’affirmation que son amour n’a pas besoin d’être acheté, ni par notre propre valeur ou celle de nos actes (comme à un examen), ni par la torture du coupable, et encore moins par la mort d’un innocent. Dieu fait grâce de nos fautes par amour. Nous trouvons grâce à ses yeux parce qu’il nous aime comme une maman aime son bébé. La mort du Christ sur la croix est le signe de la grâce de Dieu, elle n’achète pas son amour. De toute façon aucun amour vrai ne s’achète.
Un des versets les plus connus des évangiles montre bien le lien entre l’amour de Dieu et la vie du Christ :
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne meurt pas,
mais qu’il ait la vie éternelle.2
Dans ce verset, nous avons bien l’annonce de la grâce : » Dieu aime infiniment le monde « . Cela est posé en premier, sans cause, sans prix d’achat, alors que nous sommes encore pécheurs, et même parce que nous sommes en train de mourir de notre péché et que Dieu veut nous sauver de cette situation mortelle. La grâce de Dieu appelle notre foi. Car » croire en lui « , c’est cela, ce n’est pas une question de croyance intellectuelle mais une question de foi, c’est compter sur Dieu pour qu’il nous fasse vivre en Christ.
La grâce, c’est donc l’amour de Dieu.
On parle aussi d’une grâce, avec un article indéfini : c’est un acte de Dieu pour nous aider, une conséquence de la grâce. La première des grâces, c’est le don du Christ, sa vie, ses paroles et même sa mort. Par lui, Dieu veut sauver les pécheurs que nous sommes tous. La grâce est la source de tout.
Marc Pernot
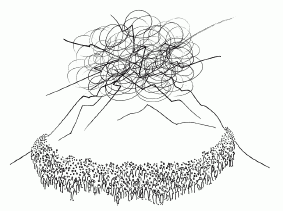
Dans la Bible, il est souvent question de la “gloire de Dieu”, et il est utile de rechercher ce que cela peut vouloir dire car ce n’est pas tout à fait ce que l’on pense en premier en lisant ces mots. Il ne s’agit pas de la gloire qui concerne le passé, même si l’on pourrait effectivement honorer Dieu pour ce qu’il a déjà accompli. Mais la Bible parle de la gloire de Dieu pour évoquer son action présente, par exemple c’est la « gloire de Dieu » qui libère les hébreux de l’esclavage en Égypte, les guidant dans le désert, les nourrissant et leur donnant de l’eau afin de les amener jusqu’au lieu de la promesse. Cette « gloire » c’est donc la présence agissante de Dieu pour nous et en nous.
Glorifier Dieu, ou » rendre gloire à Dieu « , c’est lui donner de l’importance dans nos vies en le laissant nous apporter tout ce qu’il espère nous donner pour nous développer et nous faire vivre dans la liberté.
Il est extraordinaire que, nous aussi, de simples humains, nous recevions de Dieu « un poids éternel de gloire« 1 , une capacité à vivre au-delà de la dimension temporaire de notre existence, une capacité à être créateur, à notre mesure.
1 2 Corinthiens 4:18
Marc Pernot
H

Oui, l’homme est un animal, mais il n’est pas que ça. Nous avons une foule de choses en commun avec les animaux, de sorte que du point de vue scientifique il n’est pas facile de dire ce qui nous distingue d’eux. C’est ce que l’on voit dans la première page de la Bible, car les animaux et les êtres humains sont créés le même jour, le 6e. Nous aurions donc tort de faire les malins, ou de considérer les animaux comme des choses sans valeur. Au contraire, cela nous invite à réfléchir sur la place importante dans l’univers qu’ont, ensemble, tous les êtres vivants.
La Bible ajoute que l’être humain a quelque chose de plus qu’un animal :
Dieu bénit l’être humain 1. Ce qui fait de nous un être humain c’est que Dieu nous reconnaît comme tel en nous bénissant. Ce titre n’est pas à mériter en étant intelligent ou sage, Dieu nous reconnaît comme humain, nous le sommes donc. Il nous adopte comme son enfant, nous le sommes donc2 .
De plus, Dieu donne à l’être humain son Esprit 3. L’être humain est ainsi une créature comme n’importe quel animal, mais il est aussi bien plus que cela, car Dieu lui donne d’être à son image, sous certains aspects. Nous sommes alors une créature, mais aussi, à notre mesure, nous sommes un créateur, un peu comme Dieu. Nous sommes bénis par Dieu, et nous pouvons aussi être source de bénédiction…
Nous recevons ainsi une distinction extraordinaire de ce Père qui nous veut du bien, et cela nous donne des possibilités et une mission particulières dans la création.
Après avoir créé et béni l’homme, Dieu le place dans sa création » pour la cultiver et la garder « 4, nous donnant la responsabilité de soigner notre planète et de perfectionner ce qui ne va pas dans la nature (par de la médecine, de l’irrigation, des constructions intelligentes et bonnes, mais aussi par l’art et la bonté). Dieu propose enfin à l’homme de nommer les animaux5 , l’homme a ainsi une place à part, mais il est appelé aussi à reconnaître l’importance des animaux dans l’ordre de la création.
Marc Pernot
1 Genèse 1:28
2 Romains 8:17
3 Genèse 2:7
4 Genèse 2:15
5 Genèse 2:20
I
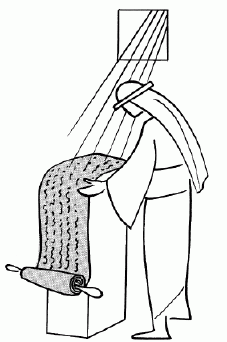
Quand Jésus veut résumer ce qui est l’essentiel de la foi et de la religion, il propose ceci : » tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. « 1, Jésus cite alors un verset de la Bible2 , mais c’est lui, Jésus, qui a ajouté le » tu aimeras Dieu de toute ton intelligence « qui ne se trouvait pas dans l’original du Deutéronome. Cet ajout a très certainement fait un choc à ceux qui écoutaient Jésus, puisque ce texte était la base de leur théologie, qu’ils le récitaient chaque matin en se levant et chaque soir en se couchant… Quand Jésus dit cela, il nous encourage très très fortement à utiliser notre intelligence, il fait même de la réflexion personnelle un devoir quotidien pour chacun de nous.
L’intelligence est donc selon Jésus une alliée de la foi, qui n’a rien à craindre de l’intelligence, au contraire. La foi n’a rien à craindre des sciences physiques ou humaines, ni de la recherche biblique, elle n’a rien à craindre des débats philosophiques ou théologiques.
L’intelligence est même, pour Jésus, une dimension essentielle de la foi. Jésus nous dit qu’aimer Dieu véritablement, c’est l’aimer en réfléchissant par soi-même. Ce n’est pas du tout une évidence. Bien des gens pensaient, et même pensent encore aujourd’hui, que pour bien aimer Dieu il faudrait renoncer à réfléchir par soi-même, qu’il faudrait sacrifier son intelligence au nom de la foi. Jésus dit ici le contraire. L’intelligence, selon ces paroles de Jésus, est une des dimensions de la foi, une dimension essentielle, bien sûr, puisque l’intelligence est une des plus excellentes qualités que Dieu donne à l’homme. Certes, la foi est plus large que l’intelligence, car Dieu reste évidemment en grande partie inconnaissable (même nos plus proches parents le sont aussi pour nous…). Mais l’intelligence fait partie de la foi.
Jésus part ainsi de la Bible et il y ajoute le devoir de réfléchir par soi-même sur cette base, même si les théologiens professionnels ne sont pas d’accord, bien sûr, puisque cela remet en cause leur pouvoir sur le petit peuple. Jésus propose de composer une équipe formée de la Bible et de l’intelligence. Il ne réserve pas cette démarche à une élite de théologiens professionnels, mais il fait ainsi de la réflexion personnelle un devoir de base, quotidien, pour toute personne, le devoir d’appliquer son intelligence dans toutes les dimensions de sa vie, à commencer dans sa recherche de Dieu, mais aussi dans sa religion, dans sa façon de faire de la théologie, dans sa façon d’aimer les autres et d’agir.
Jésus invite chaque croyant à réfléchir par lui-même, dans la confiance que nous donne l’amour de Dieu pour nous. C’est une constante des paroles et de la façon d’être de Jésus : ses paraboles nous invitent à réfléchir, mais aussi : ses commandements impossibles du genre « soyez parfaits comme Dieu lui-même est parfait« 3 , ses paroles provocantes, ses gestes, sa liberté vis-à-vis des commandements de la Loi de Moïse, sa mort même… Tout nous invite à réfléchir par nous-mêmes, et à cheminer ainsi dans l’amour de Dieu. C’est alors que nous serons dans une relation vraie avec Dieu. Quand on a réfléchi par soi-même à ce qui nous semble être juste aux yeux de Dieu, on est bien plus dans la vérité, au sens de l’Évangile, que quand on nous force par la crainte à suivre une voie toute tracée.
1 Marc 12:29
2 Deutéronome 6:5 (le Shema Israël)
3 Matthieu 5:48
Marc Pernot
J
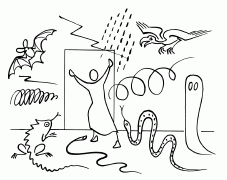
Le mot de justice fait un peu peur, il fait penser à un tribunal, avec des accusations, des juges, des policiers, et la prison qui n’est pas bien loin. Effectivement, nous ne sommes pas parfaits, nous ne nous sentons évidemment jamais à la hauteur de l’idéal que nous aimons dans l’Évangile, nous avons donc des choses à nous reprocher et c’est bon d’en avoir conscience (pour avancer).
Nous avons longtemps eu peur du jugement de Dieu (voir ci-dessus). Mais le message de Jésus-Christ s’appelle l’Évangile (littéralement, » La Bonne Nouvelle « ) et non pas la Terrible-Menace ou le Dernier-Avertissement. Et ce nom de Bonne Nouvelle est précisément en rapport avec la notion nouvelle proposée par Jésus sur la justice de Dieu.
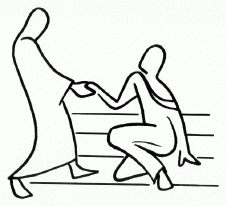
La justice de Dieu :
- Ce n’est pas une justice qui nous condamne pour nos fautes,
- Mais c’est une justice qui nous justifie, qui nous rend justes, qui nous purifie, qui nous rend meilleurs.
La justice de Dieu se traduit par notre » justification » et non par notre condamnation. Parce que Dieu nous aime en tant que personne, mais qu’il n’aime pas l’injustice, il nous aide à la faire reculer en nous. C’est donc avec soulagement que nous accueillons cette action de Dieu pour nous sauver.
Paul résumera cette bonne nouvelle ainsi : » c’est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi « 1 .
Voir aussi les articles Jugement et Grâce.
1 Éphésiens 2 :8
Marc Pernot

On a pu avoir peur du jugement de Dieu. On a malheureusement fait peur aux gens avec cela dans le but (louable) de les amener à se tourner vers Dieu, mais ce moyen n’est pas compatible avec le message central de l’Évangile.
Jésus-Christ, par ses paroles mais également par chacun de ses actes, nous assure que Dieu regarde avec bienveillance l’être humain. Il n’y a donc rien à craindre de son jugement, parce que le jugement de Dieu c’est l’amour. Qu’est-ce que c’est qu’aimer ? C’est avoir un regard positif sur l’autre et lui vouloir du bien. C’est une façon de regarder qui retient ce qu’il y a de beau, de merveilleux et de vivant dans une personne, en passant par-dessus ce qui ne va pas trop bien. Aimer quelqu’un c’est voir aussi les progrès qu’il pourrait faire et être prêt à l’aider pour cela. Une telle attitude est courante entre les personnes. Dieu est le premier à aimer, le seul à le faire parfaitement. Le jugement de Dieu est de la bienveillance active, qui voit le bien, qui espère et cherche à mettre en valeur le meilleur de chacun.
On a souvent présenté le jugement de Dieu comme une sélection entre les personnes pour retenir ceux qui ont la moyenne et recaler les autres, un petit peu comme le soldat SS qui était chargé de la sélection à l’entrée des camps de concentration pendant la seconde guerre mondiale, envoyant à la mort ceux qui ne sont pas en forme suffisante ! Certains textes bibliques peuvent être interprétés ainsi, mais ce n’est pas la seule façon de les comprendre.
Le bien et le mal sont mêlés en chacun de nous, à un degré divers, mais c’est toujours le cas. Chacun de nous est donc concerné par les descriptions de ce qui arrive au pécheur et de ce qui arrive au juste. Le jugement de Dieu voit, aime ce qui est bon en chacun et il le sauve, il rejette ce qui est mauvais et il nous en purifie. Ce tri entre l’homme bon et l’homme mauvais traverse chaque être humain. Et les descriptions de la disparition du pécheur, du méchant est alors une excellente nouvelle, celle de notre salut accompli par Dieu en Jésus-Christ.
Cela est confirmé par les images utilisées dans la Bible pour parler du jugement de Dieu, ces images font en général appel à cette notion de purification (de l’individu), plus qu’à la notion de sélection des individus :
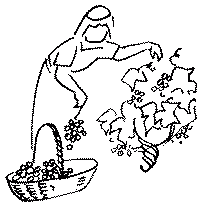
- Le jugement est parfois comparé aux vendanges de la vigne et au pressoir dans lequel on met les grappes pour recueillir le jus en écartant ce qui n’est plus utile (la peau et les branches du raisin).
- Le jugement de Dieu est parfois comparé au feu qui purifie le minerai pour en tirer l’or et rejeter les scories
- Le jugement est comparé aux moissons et au vannage du blé pour recueillir le bon grain, et retirer les mauvais ainsi que la paille qui a porté le grain mais qui n’est pas comestible.
- Le jugement est comparé à l’élagage d’un arbre afin de l’aider à mieux se développer…
Il n’y a donc rien à craindre du jugement de Dieu, au contraire, il y a tout à en espérer. Il est promesse de progrès et de vie. Ce jugement intervient dans la fin des temps, nous dit souvent la Bible, mais cela ne veut pas dire qu’il n’interviendrait qu’après la mort de notre corps, ou à la fin de l’histoire de notre monde actuel. En effet, dans la façon de parler du peuple de la Bible, avec la venue du Christ nous sommes dans cette période que l’on appelle « la fin des temps », et c’est donc immédiatement que le jugement de Dieu survient, et ce n’est pas une menace pour nous en tant que personne, mais une menace pour ce qui est mauvais en nous et qui nous fait mourir. Ce jugement est un excellent service à recevoir de Dieu aujourd’hui, nous libérant, nous aidant à avancer, nous faisant naître et ressusciter.
Cette façon qu’a Dieu de nous juger nous est proposée comme modèle dans notre façon de regarder les autres (et nous-même) avec bienveillance et optimisme, une générosité active qui les grandit.
Le jugement de Dieu est donc l’amour, et nous n’avons rien à craindre de lui1 , mais tout à espérer. La bonne volonté de Dieu n’a pas de faille, mais c’est notre bonne volonté à nous qui manque souvent. C’est cela qui est le plus problématique. Dieu ne cesse de vouloir nous donner la vie, mais si nous ne voulons pas la recevoir cela rend sa tâche terriblement difficile. Qu’arrive-t-il à celui qui refuse de prendre la vie que Dieu offre ? Dieu ne le condamne pas à mort, bien entendu, mais cette personne n’a tout simplement pas la vie. C’est comme ces gens qui ont gagné au loto et qui ne vont jamais chercher les dizaines de millions qui leur sont réservés, c’est juste tant pis pour eux.
Il y a là comme un jugement sans juge ni tribunal. Le Royaume de Dieu est grand ouvert et quiconque le désire peut y entrer, celui qui le fait est dedans, celui qui n’entre pas reste dehors. La vie éternelle est offerte, celui qui la prend est vivant celui qui ne la prend pas reste mort.
L’Évangile est la Bonne Nouvelle de la grâce de Dieu, de son amour et du Royaume qui nous est réservé. C’est le premier point du témoignage du Christ. Le second est un appel à la conversion, un appel à nous saisir maintenant de ce qui nous est offert par Dieu pour naître à la vie, un appel pour nous laisser soigner par Dieu et guérir de ce qui ne va pas dans notre existence souffrante. Personne ne peut répondre à la place d’un autre.
Voir aussi les articles sur Justification et Grâce.
Vous pouvez, si vous le désirez, consulter ces pages du site de l’Oratoire :
- prières, lecture du Psaume 1er
- prédication sur Noé
- prédication sur la parabole du jugement
- • article sur la lecture des passages terribles
- …
Dans la confiance en Dieu, et non dans la crainte !
1 Romains 8:15 ; 1 Jean 4:18
Marc Pernot

Jésus est le nom d’un homme qui est né vers l’an -6 de notre ère, qui a vécu ensuite dans la ville de Nazareth au Moyen-Orient, et qui est mort exécuté comme agitateur politique vers l’an 33.
Cet homme ayant été suivi par un petit groupe de disciples, les éléments les plus intéressants de la vie de cet homme sont connus par les témoignages de disciples ou de groupes de disciples qui ont écrit chacun un livre, un évangile. Ils soutiennent qu’il est l’homme le plus important pour l’avenir de l’humanité (le Christ de Dieu). Jésus est également évoqué par des témoignages de ses opposants de son époque, comme les rabbis juifs du Talmud (qui disent qu’il était un sorcier et un semeur de désordre) et par des allusions dans des textes romains des premiers siècles, bien qu’un mouvement de réforme religieuse dans un des nombreux peuples de l’empire romain n’ait qu’une importance mineure pour les historiens de l’empire. La pensée de Jésus est également connue à travers les commentaires des nombreux théologiens chrétiens dès le premier siècle dont les ouvrages ont été conservés.
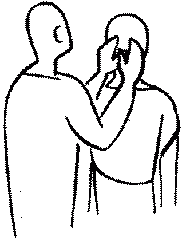
Ce nom « Jésus » était assez courant à l’époque, puisque c’est le nom du successeur de Moïse, Josué. Mais ce nom convient particulièrement bien au Christ puisqu’il signifie littéralement « Le salut de l’Éternel« , le salut du Dieu qui s’est révélé à Moïse1. À Nazareth, on l’appelait « Jésus fils de Joseph »2 , ou « le fils du charpentier »3 . Quand il a commencé à être connu dans d’autres régions d’Israël, on l’a appelé « Jésus de Nazareth »4 . Et c’est seulement plus tard, dans l’église chrétienne qu’on l’appellera Jésus-Christ5 . Christ n’est pas le nom de famille de Jésus, c’est sa fonction, comme on dit « le Général » pour de Gaulle ou « le Roi » pour Dagobert.
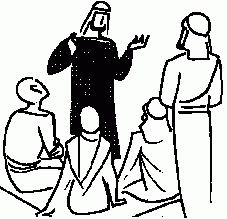
L’appeler Jésus-Christ c’est déjà une confession de foi qui affirme que cet homme, Jésus, est le Christ, l’envoyé de Dieu pour participer d’une façon décisive au salut de l’humanité tout entière. Il est un fait certain, c’est que Jésus a eu une importance considérable dans l’histoire du monde, importance qui se perpétue deux mille ans après.
Selon les témoignages qui nous sont parvenus, on peut esquisser rapidement les principaux faits certains de la vie de Jésus :
- Jésus a d’abord eu une vie de charpentier. Un témoignage du IIe siècle nous rapporte qu’il était spécialisé dans la fabrication de charrues en bois.
- Il était juif, raisonnablement pratiquant (connaissant bien la Bible, fréquentant la synagogue, allant à Jérusalem pour la Pâque) mais plutôt libéral dans cette pratique religieuse.
- Il a côtoyé un homme qui prêchait la conversion pour le pardon des fautes, Jean-Baptiste, puis Jésus a pris son autonomie par rapport à lui.
- Il a alors eu une vie publique de Rabbi (un maître juif itinérant), proposant son interprétation de la Bible, racontant de courtes histoires édifiantes (paraboles), critiquant les autorités religieuses en place.
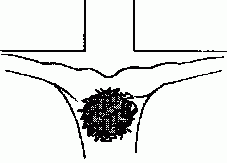
- Il a guéri des personnes infirmes ou malades, ses amis disant que ces miracles prouvaient qu’il était envoyé de Dieu, ses opposants disant au contraire que c’était pour tromper les gens que Jésus faisait cela.
- Il a finalement été exécuté, pendu sur une croix selon une méthode de torture courante à l’époque, ou lapidé selon un autre témoignage. Ses disciples, assez nombreux pendant un premier temps, l’ont abandonné lors de son arrestation et de son exécution.
Les évangiles nous en disent plus sur sa vie et ses paroles, même si ces témoignages sont très condensés, ne reprenant qu’un relativement petit nombre d’événements servant de base à leur témoignage sur Jésus.
1 Matthieu 1:21
2 Luc 3:23, Jean 1:45, Jean 6:42
3 Matthieu 13:55
4 Très fréquent : voir par exemple Marc 1:24
5 Matthieu 1:1
Marc Pernot
L
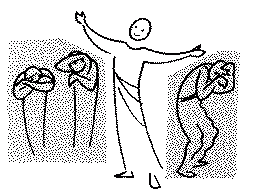
La liberté est annoncée dans l’Évangile comme une réalité qui ne va pas de soi. Jésus nous dit que » La Vérité vous rendra libre « 1, ce futur qu’emploie ici Jésus montre que pour l’instant nous sommes prisonniers d’une certaine manière, et que l’objectif de Dieu est de nous libérer. C’est d’ailleurs un message central dans la Bible : l’être humain a besoin d’être libéré par Dieu, comme le peuple hébreu a été libéré d’Égypte.
On peut se demander si nous avons la moindre liberté dans notre vie : bien souvent il nous semble que ce n’est pas tellement le cas et qu’une bonne partie de ces chaînes sont en nous-mêmes. Nous sommes prisonniers de nos humeurs, de nos préjugés, de nos manques de capacités. La première libération qui nous est apportée par le Christ, c’est d’être libéré d’une ancienne peur de Dieu : en manifestant son amour, il réconcilie l’homme avec son Dieu2 . Il permet ainsi à chacun de s’ouvrir au salut de Dieu, qui nous libère progressivement en nous créant, en nous ouvrant les yeux, en libérant nos capacités, en nous libérant de ce que l’on ne peut changer du passé et de ce qu’il y a de mauvais dans nos rêves…
Une question majeure en théologie est discutée depuis 2000 ans : est-ce que l’homme est libre vis-à-vis de Dieu, est-ce que l’homme participe à son salut ou bien est-ce que tout vient de Dieu ?
L’être humain n’a effectivement pas le choix d’être aimé par Dieu, c’est comme ça, c’est la liberté de Dieu. Cette façon d’aimer n’est pas très étonnante puisque l’enfant qui a la chance d’être aimé par des parents n’a également aucun mérite à cela (il a souvent été aimé avant même d’être conçu). Cette grâce de Dieu rend possible l’amour de l’homme pour son Dieu. Mais cet amour de l’homme n’est pas obligatoire, il n’a de sens que s’il est libre d’aimer ou non. Où serait le respect de la personne humaine si elle n’avait pas son mot à dire ? Dieu peut aimer l’être humain malgré lui, cela est en soi une garantie de vie. Mais c’est dans la mesure où nous nous confions dans les mains de Dieu qu’il peut nous donner d’être un peu plus ce qu’il espère pour nous.
La possibilité d’avoir la foi est un don de Dieu (une Grâce). Mais avoir la Foi est un choix de la personne individuelle. C’est le sens même des appels à se tourner vers Dieu que l’on trouve partout dans la Bible, et à chaque page des évangiles. Les sacrements tentent de rendre compte de cette relation de Dieu avec l’homme et de l’homme avec son Dieu.
Aux personnes qui nous disent « je vous envie d’avoir la foi », on peut répondre qu’elles n’ont qu’à décider de l’avoir et de prendre un peu de temps pour chercher Dieu. Nous avons vraiment cette liberté, et elle est essentielle.
Marc Pernot
M
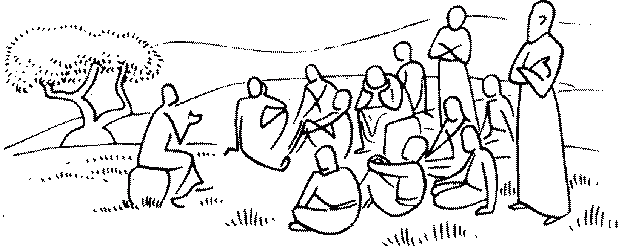
Un » mystère « , dans la Bible, c’est un secret qui est maintenant révélé. Ce qui est étrange, c’est que ce mot soit devenu synonyme de l’inconnaissable.
Peut-être est-ce la faute de théologiens qui, à un moment de l’histoire, auraient voulu garder leur pouvoir en laissant planer des secrets sans communiquer la révélation, le mystère devient alors pour la foule de ceux qui ne sont pas initiés un secret. Ce n’est pas fidèle à l’Évangile, car la révélation n’y est pas réservée à une élite mais elle est donnée pour que tous l’entendent et s’en réjouissent. Si Jésus n’explique pas ses paraboles, c’est qu’elles sont des exercices qui n’ont d’intérêt que si la personne elle-même butte dessus, mais il n’y a là aucun secret que Jésus tiendrait caché, au contraire.
Certains théologiens ont utilisé le mot » mystère » comme une sorte de joker quand leur théologie montre ses limites ou se révèle incohérente, ils répondent alors « c’est le grand mystère de la foi », entendant ainsi qu’arrêter de réfléchir serait une preuve de foi face à un problème de logique que pose leur théologie. En bien non, Dieu ne veut pas nous rendre stupides, il veut au contraire éveiller notre intelligence (voir cet article), et l’éclairer de ce que nous ne pourrions connaître sans révélation particulière. Le mystère n’est pas une chose incohérente ou impossible à connaître, le mystère c’est l’Évangile, nous dit l’apôtre Paul, le mystère c’est le Christ 1, le mystère c’est l’amour de Dieu que Christ nous révèle pour qu’on en vive et qu’on le proclame.
1 Éphésiens 6:19, Colossiens 2:2-3
Marc Pernot
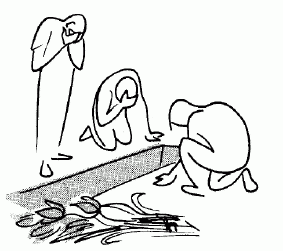
Désolé de parler de la mort, c’est vrai que » ça ne se fait pas » et que ce n’est pas drôle, mais il n’est pas inutile d’ouvrir les yeux sur cette réalité. Car notre mort nous pose une question intéressante : nous n’avons qu’un temps limité à vivre, que voulons-nous faire de ces quelques courtes années que nous avons devant nous ? C’est comme si nous étions pour trois jours seulement dans un pays étrange et merveilleux que nous ne traverserons qu’une seule fois dans notre vie, que voudrions-nous faire de ces quelques heures que nous avons devant nous, quelle personne rencontrer, que faire et quel cadeau laisser là-bas ? Cela mérite réflexion, et cela nous aidera bien d’avoir des indications pour mieux choisir ce que nous voulons choisir. Nous souvenir que nous ne sommes pas éternel est ainsi une bonne chose pour ne pas passer à côté.
Mais il y a une autre mort dont nous pouvons prendre conscience : le manque de vie spirituelle. Là aussi, prendre conscience de cette réalité n’est pas triste, mais utile, afin de naître enfin, ou de naître un petit peu plus et de grandir dans cette dimension. C’est d’autant plus facile qu’il suffit pour cela de nous ouvrir à ce quelque chose qui vient de Dieu et qu’il ne demande pas mieux de nous offrir. C’est ce que dit l’Évangile quand il nous dit que Christ est la résurrection et la vie (voir les articles sur ces deux mots). Vivre dans l’égoïsme, coupé de Dieu et des autres, c’est être à moitié mort, et condamné à mort. Ressusciter c’est s’ouvrir à la vie et aimer enfin. Et même vivre pour toujours.
L’Évangile nous annonce qu’en Christ, la mort est vaincue. Bien entendu, la mort physique continue à frapper, mais elle n’est pas la fin de tout. Il y a une dimension de la vie humaine que la mort n’atteint pas, la vie éternelle. En Christ, les puissances de mort reculent, en particulier l’indifférence, le manque de foi, le manque d’espérance…
Cela n’empêche pas que cette mort physique soit un drame, surtout quand elle est prématurée. Car la vie de notre corps, en ce monde, est en réalité une véritable bénédiction pour nous et pour ceux qui nous sont proches.
La mort de ceux que nous aimons est très difficile à vivre. C’est normal, et il est important de soutenir ceux qui sont dans le deuil. Mais la mort ne diminue en rien la valeur à nos yeux de celui dont le corps a cessé de vivre, et nous pouvons continuer à être en relation avec lui par l’amour.
Parfois, une personne se suicide. Ce n’est jamais une bonne chose pour plein de raisons :
- C’est exagéré. Les choses évoluent avec le temps, il est donc vraiment dommage de prendre une option aussi définitive. Des difficultés peuvent sembler insurmontables à un moment donné ou quand on n’a pas le moral, mais plus tard il en serait autrement.
- C’est gâché. La vie est faite pour être vécue, explorée. La vie est faite pour être source de bénédictions, ce n’est pas sympa de se défiler. On peut se creuser la tête (avec l’aide de Dieu) pour trouver quelque chose de positif à faire, le suicide n’en fait pas partie.
- Ce n’est pas gentil. La mort de quelqu’un que l’on aime nous fait souffrir, cela montre que nous ne sommes pas le seul concerné par notre propre mort. Le suicide d’un proche est particulièrement dur à vivre.
Mais le suicide est souvent la conséquence d’un trouble psychologique qui fait que la personne n’est pas totalement libre de son choix. Il n’y a pas alors forcément de » raison « , c’est simplement bien triste, sans que ce soit la faute de l’un ou de l’autre.
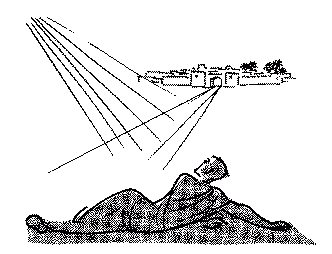
Marc Pernot
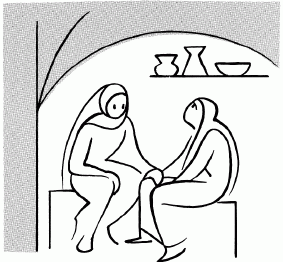
Ce mot est directement tiré du latin, il veut dire littéralement « qui a un cœur sensible à la misère« . Il y a de la compassion dans la miséricorde, il y a de l’amour, de la fraternité et du pardon. À quoi sert ce mot s’il y en a d’autres plus faciles pour dire la même chose ? Parce que les traducteurs de la Bible ont choisi, ou même fabriqué ce mot pour parler de l’extraordinaire façon qu’a Dieu de nous aimer. C’est donc normal que ce mot soit un peu rare dans le langage courant, parce qu’il est rare de rencontrer une telle qualité d’amour entre nous.
Dieu est miséricorde. Il y a dans cette notion une promesse qu’il aimera fidèlement, quoi qu’il arrive, et pour toujours. Il souffre quand nous souffrons, il pardonne, il prend pitié de nos faiblesses, il ne méprise pas le petit mais y attache une attention toute particulière pour lui venir en aide… Comme une mère qui aime chacun de ses enfants.
En prenant conscience de la miséricorde de Dieu pour nous, cela peut nous donner des idées, cela peut attendrir notre cœur, nous rendre moins durs et moins indifférents à nos frères et sœurs, nous sommes alors un petit peu plus « miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. » C’est ce que nous propose Jésus-Christ1 .
1 Luc 6:35-36
Marc Pernot
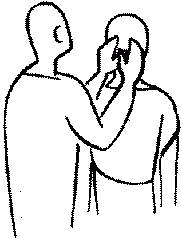
Les miracles que raconte la Bible sont aujourd’hui souvent un obstacle à la foi. En effet, les histoires de miracles sont plutôt racontées dans les romans ou dans les sectes qui attirent ainsi les amateurs de surnaturel. Et puis, ces miracles racontés dans la Bible posent des questions, comment est-ce que Moïse aurait pu écarter la mer, comment Jésus aurait-il pu marcher sur l’eau, guérir un aveugle et ressusciter un enfant mort et qu’est-ce que tout cela nous apprend sur le salut que Dieu nous donne ?
Devant un récit de miracle, il y a différentes façons de penser parmi les chrétiens, certains pensent qu’il y a bien eu un événement physique extraordinaire, d’autres chrétiens pensent qu’il faut prendre ces récits de miracles au sens figuré. Ces 2 positions sont respectables :
- Il n’est pas idiot de penser que Dieu fasse des miracles, puisque l’apparition de la vie dans l’univers matériel est un prodige qui a certainement eu lieu. Il y a 15 milliards d’années, rien dans l’univers ne permettait de prévoir qu’il apparaîtrait un jour des êtres capables de penser et d’aimer, cette apparition est un événement qui va à l’encontre de tout ce qui existait avant, c’est donc un miracle immense. Cette évolution montre que Dieu fait des choses qui dépassent tout ce que l’on peut imaginer (mais cela ne veut pas dire qu’il fait n’importe quoi quand même). La science nous montre aussi que les lois physiques sont plus surprenantes que ce que l’on pense, en particulier quand on entre dans les domaines des particules ou des grandes dimensions.
- Il n’est pas idiot non plus de penser, par exemple, que Jésus n’ait pas marché sur l’eau au sens matériel du terme, mais que ce récit soit à prendre seulement au figuré (il arrive par la foi à avancer malgré l’adversité, sans couler à pic). Lire ainsi ce récit de miracle n’est pas un manque de respect par rapport à la Bible, c’est juste une question d’interprétation. En effet, quand on lit dans la Bible que » le Christ est la lumière du monde « 1, on comprend bien que c’est une façon de parler et que même avec la présence de Dieu on a quand même besoin d’allumer des lampes dans sa maison le soir…
Finalement, pour lire un de ces récits de miracle, la question de savoir ce qui s’est passé matériellement est une question d’opinion personnelle, et cette question est relativement secondaire.
Ce qui est important pour nous, lecteur de la Bible, c’est de chercher, dans tous les cas, ce que veut dire pour nous ce récit de miracle. Nous comprendrons alors quel miracle Dieu veut accomplir dans notre propre vie. Au delà de nos différences d’opinions concernant la réalité historique du miracle, nous pouvons être unis dans cette recherche du sens de ce récit pour nous : le salut vient dans notre existence comme un miracle, c’est à dire comme quelque chose qui dépasse ce que nous pourrions accomplir avec nos seules forces humaines.
Même si Jésus a matériellement marché sur l’eau, il ne l’a pas fait pour faire le malin, mais pour dire quelque chose de vraiment essentiel à ses disciples. Son acte est alors encore de la théologie, c’est un signe, un geste symbolique, et c’est ce message théologique que tous les chrétiens s’accordent à trouver fondamental.
Des miracles, Dieu en fait tous les jours dans notre vie, et chacun des miracles racontés dans la Bible peuvent encore se produire dans notre vie. Comme le montre le Christ, Dieu peut ouvrir nos yeux (sur la vérité), il peut guérir nos jambes paralysées (nous permettre d’avancer dans notre vie), il peut même nous ressusciter (faire naître en nous une vie nouvelle, si profonde qu’elle est éternelle)…
Et pour nous, après la création de l’univers le miracle le plus sensationnel c’est le Christ. En lui et par lui, Dieu fait entrer le monde dans une ère nouvelle.
1 Jean 1, Jean 9:5, Psaume 27
Marc Pernot

Le mot » ministère » est un mot grec qui se traduit en français par » service « . La théologie chrétienne garde souvent le mot grec quand il s’agit du service de Dieu, ou du service des autres au nom de Dieu. Au sens chrétien de ce mot, toute personne est ministre selon l’appel du Christ qui recommande que nous soyons tous au service les uns des autres 1. On voit la différence entre les ministres du gouvernement (de grands chefs qui roulent souvent en voiture précédée par des motards pour leur assurer la priorité sur les autres) et le ministre au sens de l’Évangile qui se fait petit pour servir les autres, à la suite du Christ2 .
Pour ce service, notre diversité de personnalités, de qualités, d’expériences est une chance, nous pouvons être ainsi complémentaires pour agir dans le monde. C’est à chacun, éclairé par Dieu, de trouver sa place dans le service commun, de reconnaître la ou les personnes qui lui sont confiées à un moment donné pour qu’il leur propose quelque chose leur permettant d’avancer. Paul compare l’humanité à un corps dont chacun de nous serait une main, un doigt de pied, un oeil… chacun avec son utilité propre, avec le Christ qui est comme la tête du corps que nous formons ensemble3 . Unis par le Christ, notre diversité est alors une communion. Christ coordonne nos services (nos ministères, si l’on veut s’amuser à jargonner en utilisant de jolis mots grecs).
Marc Pernot

Jésus ne parle pas tellement du mariage, et les évangiles ne nous disent rien concernant la situation personnelle de Jésus, cela veut dire que cela ne nous regarde pas, que cela n’a pas d’importance concernant notre salut que Jésus ait été marié ou non. Cela veut dire aussi que le secret d’une belle vie, d’une vie féconde et vraie, n’est pas dans le fait d’être marié ou d’être célibataire, mais dans une façon d’être qu’il est essentiel de vivre que l’on soit célibataire ou marié, en aimant Dieu et son prochain comme soi-même.
Le mariage est un engagement des deux conjoints dans la fidélité, pour toute la vie. Le mariage chrétien comprend plusieurs dimensions qui se complètent :
- Il est d’abord un engagement qui se fait dans le secret des cœurs,
- Il a également une dimension sociale à la Mairie,
- Et il a enfin une dimension spirituelle et religieuse, en demandant à Dieu de bénir ces engagements et la vie qui s’ouvre ainsi. Cette cérémonie est également l’occasion pour les époux de dire à leurs proches qu’ils comptent sur eux et de partager avec eux ce qui fait le cœur de leur foi.
L’union des deux conjoints ne se fait pas en une seconde, mais elle est sans cesse à construire, car nous changeons tous, heureusement, nous évoluons. C’est pourquoi il est tellement utile de laisser une place à Dieu, au Créateur, pour qu’il poursuive son œuvre d’union entre les deux époux chaque jour de leur vie, et pas seulement le jour du mariage. Au cours de la cérémonie, une Bible est remise aux époux pour manifester cette réalité et qu’ils puissent nourrir leur réflexion, leur dialogue entre eux deux, et leur prière grâce à la lecture de la Bible ensemble. Inviter les personnes sur qui l’on compte et chercher ensemble quelles sont les espérances du couple, ce qui les fait vivre comme foi et comme idéaux, tout cela participe à la constitution du couple.
Si la cérémonie de mariage n’est pas appelée « un sacrement » dans le protestantisme, ce n’est pas parce que le mariage ne serait pas hautement considéré, ou qu’il ne serait pas sacré. Mais simplement à cause de la définition de la notion de sacrement (voir ce mot). Dans le protestantisme, nous tenons à ce que tous et toutes puissent recevoir tous les sacrements donnés par l’Église, pour bien marquer l’égalité de chacun devant Dieu. Or, tous ne sont pas mariés, tous ne sont pas pasteurs, et si ces cérémonies de mariage et de consécration (ou ordination) de pasteur existent, tous n’y sont pas appelés.
Le mariage chrétien est pour toute la vie, dans la fidélité. Il arrive qu’un couple divorce, c’est un échec dont la faute revient parfois plus à l’un qu’à l’autre des époux, parfois la responsabilité de cet échec est partagée entre les deux époux. Dieu accompagne ces familles, parfois il peut aider à une réconciliation, parfois il doit se résigner à cette séparation, peut-être tenter aussi de les orienter afin qu’ils trouvent, enfin, l’homme et la femme de leur vie et puissent constituer de vrais couples. Il ne peut pas y avoir de règle générale en ce domaine, il n’y a que des cas particuliers. En cas de divorce, au moins, les deux ex-époux pourront faire tout ce qu’ils peuvent, même unilatéralement, pour que cette séparation se fasse de la manière la plus respectueuse, la plus fraternelle possible. Il est en particulier indispensable quand il y a des enfants, que jamais ils n’entendent leurs parents dire du mal l’un de l’autre.
Marc Pernot
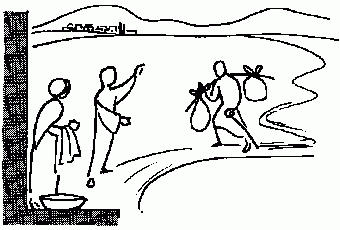
Dans la Bible, la vie est souvent comparée à une marche à pieds1. Cela donne une vision dynamique de notre existence, avec les différents âges de la vie qui sont comme des pays que l’on explore en découvrant leur beauté. Le temps qui passe n’est pas forcément à regarder comme une réalité négative mais comme une chance de pouvoir avancer et vivre de belles choses. C’est vrai que notre corps s’usera avec le temps, mais intérieurement nous pouvons avancer et même nous élever considérablement dans notre qualité d’être. Il y a des obstacles sur notre route, parfois ces obstacles sont terribles (c’est vrai que la vie est injuste, certains étant durement frappés et d’autres presque pas) mais Dieu nous accompagne pour nous en sortir.
Dieu est lui-même en marche, il n’est pas une statue en marbre dressée dans un temple, mais il est une personne vivante qui évolue et qui est source d’évolution.
L’exemple même du salut que Dieu nous donne est l’Exode, le passage du peuple hébreu de l’Égypte à la Terre promise. Cela symbolise le passage de la vie dure à la vie belle grâce à Dieu, cela symbolise le passage de la vie comme esclave (du péché) à la vie d’être libre (dans le Royaume de Dieu).
Pâque est un mot hébreu, פֶּסַח, Pesa’h, qui évoque ce passage. La fête de Pâques est célébrée en réalité chaque dimanche, elle nous propose de nous ouvrir régulièrement à ce cheminement que Dieu nous donne en Christ2.
Marc Pernot
Toute philosophie et toute théologie se pose la question de l’existence du mal (et du bien, voir aussi ce mot). La Bible rend compte de plusieurs réponses différentes à la question que pose cette douloureuse réalité.
Passons rapidement en revue cinq de ces réponses pour chercher les avantages et les limites de chacune.
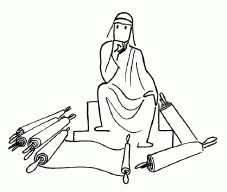
a) « Cette question nous dépasse. »
C’est une façon d’éluder la question, de renoncer à y apporter une réponse satisfaisante.
- Dans la Bible : Le livre de Job conclut sur cette réponse.
- Avantage : c’est vrai que notre point de vue est toujours partiel et limité. Nous sommes un peu comme une fourmi marchant sur une immense affiche, ne voyant que des taches de couleurs sous ses pattes sans voir ce que cela représente. En dernier recours, l’humilité et la confiance en Dieu sont une bonne attitude, car nous ne sommes pas Dieu.
- Inconvénient : Cette théologie n’invite pas tellement à agir contre la souffrance. Mais surtout, Dieu ne nous demande pas de renoncer à l’intelligence pour avoir la foi ! Au contraire : quand Jésus cherche vraiment à faire réfléchir les personnes qui l’écoutent, tous, même les personnes les plus simples (voir confession de foi). C’est vrai que nous ne comprenons pas tout, mais la Bible nous dit que Dieu nous crée à son image, et il nous a rendu capables de quand même comprendre quelque chose de la réalité qui nous entoure.
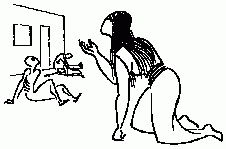
b) Dieu créerait la souffrance pour notre bien.
La souffrance est alors comparée à un médicament amer, un avertissement, un exercice pour nous rendre plus fort ou une épreuve pour nous évaluer. La souffrance nous apparaîtrait comme pénible, mais elle serait donc en réalité un bien.
- Dans la Bible : Psaume 32:10, Ésaïe 48:10.
- Avantage : cette solution est simple et claire.
- Inconvénient : Cette théologie invite à accepter la souffrance comme venant de Dieu, plutôt que de lutter contre la souffrance. Mais le plus grave c’est qu’une multitude de personnes a été rendue athée par cette théologie, ou en est venu à douter de la bonté de Dieu. Car, effectivement, si Dieu était à la fois tout puissant et amour, il aurait d’autres moyens que la torture pour nous éduquer ! Et, face à la leucémie d’un enfant ou à de terribles catastrophes naturelles, cette théologie qui soutient « Tout vient de Dieu, le bien comme le mal » est vraiment épouvantable à entendre (voir aussi le mot providence).
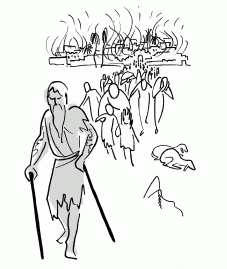
c) Dieu laisserait la liberté à l’homme, qui a tout gâché.
Dieu aurait tout parfaitement créé à l’origine, puis il aurait restreint sa toute puissance pour laisser à l’homme la liberté de faire le bien comme le mal.
- Dans la Bible : voir les textes où Dieu s’absente (par exemple Adam et Ève, ou la parabole des talents).
- Avantage : C’est vrai que le mal que nous faisons a pour conséquence des souffrances importantes et un gâchis dont les conséquences se font sentir parfois fort loin dans l’espace et le temps.
- Inconvénient : Cette explication est parfois injuste et culpabilisante, par exemple quand elle nous rend responsables, sans que l’on sache comment, de la mort subite d’un nouveau-né, ou responsable d’un cyclone qui a tout ravagé sur son passage, comme de la souffrance injuste du bébé gazelle croqué par un lion. Tout cela existait avant que l’homme puisse en être responsable. Enfin, dans cette théologie, Dieu n’est pas complètement innocent, il est au moins coupable de non-assistance. Des parents responsables laissent une liberté raisonnable aux enfants mais empêchent quand même les trop graves conséquences quand ils le peuvent. Dieu n’aurait-il pas dû imposer des bornes à notre liberté pour éviter Auschwitz ?
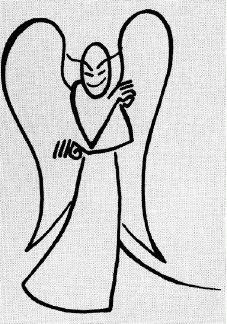
d) Dieu affronterait un ennemi actif.
Cette théologie est bien plus ancienne que la Bible. Il y aurait un Dieu bon, et il y aurait une autre personne transcendante qui ferait le mal. Certaines théologies chrétiennes ont repris cette théologie avec une puissance du mal personnifiée (voir le mot Diable).
- Dans la Bible : Apocalypse 2:13, Job 1, 2 Pierre 2:4.
- Avantage : cette solution est claire et elle innocente vraiment Dieu. Il est et demeure à 100% bon, il n’est jamais source de souffrance.
- Inconvénient : Une telle lecture est proche du dualisme, une théologie à deux dieux. On a le droit de penser cela, et certains théologiens chrétiens le font, mais c’est dommage d’abandonner ainsi le monothéisme radical de l’Évangile et de la Loi de Moïse qui affirme qu’il y a un seul Dieu, une seule personne transcendante dans l’univers et qu’elle crée le bien. De plus, cette explication ne correspond pas bien à l’expérience, car quand une catastrophe frappe, on peut remarquer qu’elle frappe tout le monde, au hasard, le pécheur comme le juste. S’il y avait un diable derrière, il frapperait surtout les êtres bons.
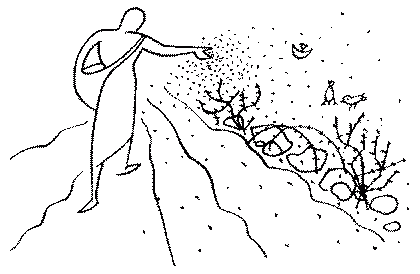
e) Dieu serait en train de poursuivre son œuvre de création.
Dieu serait puissant, mais il ne pourrait pas tout faire en une seconde, il crée dans la durée. Dieu n’est alors la cause que du bien, mais il y a encore du chaos dans ce monde que Dieu est en train d’organiser progressivement.
Dieu crée l’homme dans ce chantier en cours, et il l’appelle à participer à cette œuvre et à se développer lui-même.
- Dans la Bible : tous les passages qui disent que le Royaume de Dieu vient, qu’il est à attendre, à préparer. Par exemple, dans le Notre Père = « que ta volonté soit faite… » et le Psaume 121 qui parle de « l’Éternel qui est en train de créer le ciel et la terre » (et non « qui créa le ciel et la terre » comme le disent des traductions mensongères).
- Avantage : Dieu est totalement innocent de toute souffrance, que ce soit comme acteur de cette souffrance, ou même comme laissant faire. Dieu est la source d’une dynamique d’évolution positive. C’est un grand avantage théologique, assurant une bonne cohérence avec ce que nous savons de Dieu par Jésus-Christ. Cette théologie est également intéressante sur le plan moral : elle nous mobilise pour lutter avec Dieu contre toute souffrance.
- Limite : Comme dans la théologie précédente, Dieu ne serait actuellement pas tout puissant. Cela peut gêner certaines personnes, même si dans la Bible l’idée de » toute puissance » de Dieu est en réalité extrêmement rare et contestée (voir le mot Puissant).
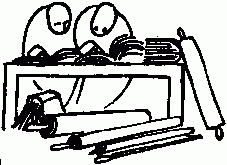
Bilan de ces 5 propositions
On ne peut vraiment pas dire que cette question de l’existence du mal n’a pas de réponse, au contraire, elle en plutôt trop. Chacun peut donc en retenir une, en combiner plusieurs, ou en chercher d’autres…
Personnellement, ma réponse à cette question intègre trois des cinq réponses, et rejette les deux autres.
- Oui, on ne comprend pas tout, et le moindre progrès est pour nous un effort, une sorte de souffrance, pourtant bonne dans ce cas (réponse -a). Mais Dieu cherche à nous rend intelligent (voir l’article sur l’Intelligence) faisons donc lui confiance en essayant de réfléchir grâce à lui.
- Oui, l’homme est responsable des autres et du monde, et il est coupable d’une partie de la souffrance (réponse -c), mais n’exagérons pas inutilement non plus notre culpabilité.
- Et je crois que Dieu n’est pas indifférent à la souffrance et ne se résignera jamais devant le mal. Il agit dans le monde, poursuivant son œuvre de création, il nous aide à transformer la souffrance en vie, il nous accompagne, il nous pardonne, il nous appelle à agir, il nous ressuscite (réponse -e).
En conclusion, Dieu est bon, et il est à 200% innocent du mal, si je puis dire pour résumer le fait qu’il n’est pas la cause de mal, et qu’il est au contraire totalement engagé dans la lutte pour le bien. Il peut même transformer le mal, qu’il ne voulait pas, en une source de bien imprévue. Cela ne justifie pas après coup le mal, mais cela nous encourage à le vivre avec Dieu, et comme lui, à « ne pas nous laisser vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. »
Marc Pernot
P
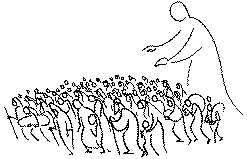
Le mot puissant est assez connu et clair en français courant, mais c’est la question de la puissance de Dieu qui est assez sensible, et qui connaît depuis le milieu du siècle dernier une évolution intéressante.
Dieu est puissant. Il est à l’origine d’un immense mouvement d’évolution dans l’univers, et des milliards d’hommes et de femmes témoignent de la puissance de Dieu dans leur vie. Mais est-ce que Dieu est » tout puissant » ou non ? Cette question est si fondamentale que des traducteurs de la Bible ont longtemps commis une erreur grave (ou peut-être un mensonge ?) en traduisant l’hébreu » El shaddaï » par « Dieu tout puissant ». C’est faux, » El » veut dire » Dieu « , et l’on peut comprendre » shaddaï » comme on veut mais il n’y a pas le mot » tout » dans le texte original. L’imagination de ces traducteurs a influencé sur ce point leur façon de comprendre la Bible. Ils se sont laissés influencer aussi par le fait qu’à leur époque un roi était souvent un tyran qui avait les pleins pouvoirs, ils ont alors imaginé que Dieu était un peu comme cela. Peut-être se sont-ils également laissés influencer par la conception qu’avaient des grecs et des romains de leurs dieux (Jupiter et Zeus) ?
Mais, aujourd’hui bien des théologiens chrétiens évoluent dans leur conception de la puissance de Dieu pour la relativiser dans le temps présent. Beaucoup disent que sa puissance est celle de l’amour, une puissance d’accompagnement et de pardon. Les éditions récentes de la Bible ont enfin rectifié leur traduction d’El Shaddaï, ainsi qu’un autre fausse mention de la toute-puissance Dieu dans l’annonce faite à la vierge Marie1 . Il n’y a que quelques très rares textes qui attribuent à Dieu la toute-puissance, exactement dix2 , et ce sont tous des textes qui parlent de la fin des temps. Là dessus, tout le monde peut être d’accord, au terme des siècles, tout sera dans la main de Dieu. Mais dans le temps présent, non. La toute-puissance de Dieu dans le temps présent est un mythe ou un fantasme.
Il y a de nombreuses choses que Dieu ne peut pas faire : il ne peut pas faire le mal ni haïr un de ses enfants, il ne peut pas non plus forcer qui que ce soit à aimer (ça n’a pas de sens)… Mais on découvre en Jésus-Christ qu’avec » Dieu, on peut s’attendre à tout « , il est patient, plein d’idées originales et d’enthousiasme pour faire avancer la vie, il crée avec douceur et patience, une infinie patience qui ne désespère jamais d’aucune personne. Il est infiniment puissant, évidemment, et il nous invite à participer à sa puissance d’amour.
Ce point est fondamental dans notre compréhension de Dieu et du monde, en particulier dans l’existence du mal sur terre (voir cet article). Dieu agit contre la mal car il est bon et puissant, mais il reste du mal car il n’est pas tout puissant.
Voir l’article sur l’existence du mal et de la souffrance
1 Luc 1:49
2 2 Corinthiens 6:18, Apocalypse 1:8, 4:8, 11:17, 15:3, 16:7,14, 19:6,15, 21:22
Marc Pernot
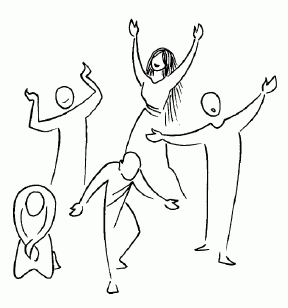
Cent cinquante prières et poèmes, des louanges à Dieu, des cris de détresse, de foi, de bonheur, d’espérance et de doutes… le livre des Psaumes est une formidable nourriture pour notre vie.
Ces textes ne nous font pas la leçon, ils ne cherchent pas à nous imposer des dogmes ou des rites, ils ne sont « que » des témoignages de foi vécue.
Depuis 3000 ans, ils sont sur la table de chevet ou dans le sac de voyage de bien des croyants, juifs et chrétiens. Avec les quatre évangiles, ils forment à mon avis la base de notre lecture personnelle de la Bible.
Marc Pernot
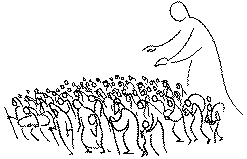
L’idée de providence sous-entend que Dieu gouverne les événements du monde, et donc en particulier notre vie. Tout dépend comment on entend cela. Les opinions sont très diverses à ce sujet entre les différentes religions et même entre chrétiens. Il y a même des non-croyants qui croient à une sorte de providence, comme les gens qui croient aux astres et les superstitieux. Ils pensent que quelque chose dirige de l’extérieur le cours de l’histoire, et que nous avons ainsi un destin, plus ou moins inscrit quelque part.
Cette question de la providence pose des questions assez délicates en relation avec d’autres notions comme :
- la question de la liberté humaine face à la puissance de Dieu,
- la question de l’existence du mal et de la bonté de Dieu.
Dieu a certainement une action dans ce monde, l’évolution de l’univers permet de le penser. Mais est-ce qu’il dirige tout pour autant ? Personnellement, je ne le pense pas.
- Dans la Bible, la liberté de l’être humain est un point important. Dieu ne crée pas des robots, mais des êtres qu’il veut libres, qu’il libère même volontairement et qu’il laisse vivre en se faisant discret. Cette liberté est sans cesse rappelée dans la Bible par des appels à progresser. Cette liberté est un risque que Dieu prend, et contrairement à ce que l’on pense parfois, il semble n’avoir pas tout prévu par avance. La Bible nous montre Dieu descendant voir comment les choses évoluent, parfois il semble surpris, souvent choqué, même, et il se voit dans l’obligation de réagir en intervenant pour sauver l’avenir de ses enfants1.
La providence n’est donc pas totale, et si Dieu devine souvent ce que nous allons faire (il en connaît un brin sur la nature humaine), personne, pas même Dieu ne connaît absolument à l’avance ce qui n’est pas encore arrivé.
Il semble que la nature aussi ne soit pas totalement pilotée par Dieu, pas pour l’instant. En effet, quand des cyclones dévastent des pays et des familles qui ne sont pas plus coupables que nous, on ne peut pas en rendre responsable un Dieu d’amour. Au contraire, il travaille encore à la création d’un monde toujours plus juste2.
- La Bible annonce aussi l’action de Dieu dans le monde et dans notre vie. Il agit en nous, il agit pour nous, même si nous ne sommes que peu de chose face à l’univers entier. L’espérance chrétienne, fondée sur la confiance que nous avons en Dieu, c’est qu’en définitive, le mal, la souffrance et la haine ne l’emporteront pas, mais que grâce à Dieu le bonheur et la vie auront finalement le dessus3 . Cette action de Dieu nous accompagne avec amour plus qu’avec violence, même l’amour de Dieu est plus fort que tout ce qui peut s’y opposer, il transforme le mal que nous avions combiné en bien4, il garde notre vie, la vie de chacun, nous aidant à cheminer malgré les difficultés diverses qui peuvent survenir malgré sa volonté5.
En conclusion, nous pouvons dire avec le Christ « Notre Père, que ton règne vienne« . Nous pouvons espérer cette action de Dieu dans le monde, nous pouvons lui faire une place, l’accompagner à notre mesure. Nous aimerions bien que Dieu crée à l’instant un monde parfait devant nos yeux. C’est ce que demandent des apôtres quand ils comprennent que Jésus s’en va sans avoir réglé tous les problèmes : “Alors c’est pour quand ? ” Jésus leur répond : “Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins partout, jusqu’aux extrémités de la terre.” Dans un sens, cela peut nous décevoir, Dieu n’est pas un Père Noël qui ferait tout comme par magie sans que nous ayons à lever le petit doigt. Dieu sait ce qu’il a à faire et il le fait à son rythme selon son temps à lui, mais en ce qui nous concerne, c’est en nous et à travers nous qu’il veut agir dans le monde.
La providence de Dieu est ainsi quelque chose qui nous responsabilise, et c’est ensemble, Dieu, le monde et nous qui élaborons un idéal commun et cheminons vers lui.
1 Par exemple avec Adam & Ève (Genèse 3:8), Noé (Genèse 6:6), Babel (Genèse 11:5)
2 Romains 8:22, Psaume 121 (« l’Éternel en train de créer le ciel et la terre« , au présent)
3 Romains 8:38-39
4 Genèse 50:20
5 Psaume 23, Psaume 121…
6 Actes 1:6-8
Marc Pernot
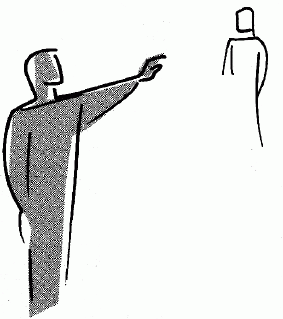
Au XVIe siècle, protester voulait dire témoigner, oser dire ce que l’on croit. C’est déjà un beau programme, dans la suite du Christ dont c’était une spécialité et qui fait de nous des prophètes, des porteurs de parole.
Protester veut dire également s’indigner, se révolter ouvertement contre quelque chose. C’est excellent aussi, à condition que cela soit fait avec amour et pour faire avancer les choses. Jésus était parfois plein de douceur pour réconforter quelqu’un, mais il avait souvent des paroles et des gestes forts pour dire sa révolte. Ce n’était jamais pour rejeter quelqu’un, bien au contraire, mais c’est par intérêt pour cette personne qu’il ose lui dire ce qu’il pense et il l’appelle à ne plus continuer comme avant mais à changer grâce à Dieu, il l’appelle à la conversion et lui annonce la vie.
Marc Pernot
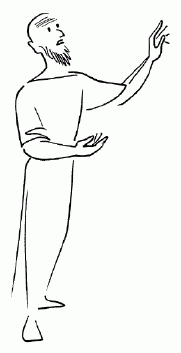
Le prophète n’est pas tellement quelqu’un qui prédit l’avenir, mais il est plutôt quelqu’un qui dévoile le sens profond de l’actualité. Cela est bien plus utile. De toute façon il n’est possible à personne de connaître l’avenir avec certitude (même Dieu est souvent surpris par ce qui arrive 1, alors… ceux qui prétendent avoir les clefs de l’avenir sont des escrocs ou des fous).
Le prophète est un homme ou une femme qui reçoit l’Esprit de Dieu. À la suite de Jésus-Christ, nous sommes tous appelés à recevoir l’Esprit, et être ainsi prophète 2, voyant le monde avec un point de vue élevé par Dieu, voyant mieux la situation et la profonde valeur des personnes qui nous entourent.
Le prophète est ainsi un « voyant » 3, et il devient un « porteur de parole », envoyé par Dieu pour dire avec fidélité ce que nous voyons à ceux qui nous sont confiés.
Dire que Jésus est le Christ, c’est dire qu’après lui, toute personne est appelée à devenir elle-même personnellement, un ou une prophète. C’est ce qui est annoncé par exemple :
Jean 14:16 -> Jésus dit : » Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous. l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Ce « consolateur » (paraclet) ne désigne pas telle ou telle personne individuelle, mais le Saint-Esprit qui est donné pour que chacun puisse être en dialogue direct et personnel avec Dieu.
C’est effectivement ce qui était promis par les prophètes de l’Ancien Testament, par exemple : Jérémie 31:31-35 « Je mettrai ma loi, ma Parole, au-dedans d’eux, Je l’écrirai dans leur coeur; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple. Celui-ci n’enseignera plus son prochain, Ni celui-là son frère, en disant: Connaissez l’Eternel! Car tous me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu’au plus grand, dit l’Eternel. »
C’est ce que dit également le livre des actes des apôtres, dans la Bible : Actes 2:17 « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront ». Nous sommes sans ces « derniers jours », selon la théologie chrétienne, puisque le Messie est venu. Dieu répand ainsi son Esprit sur tout être humain.
Oui, il existe donc des prophètes après le Christ, et Dieu continue à se révéler, à parler. Dieu cherche même à parler à chacun, et à faire de chacun et chacune un prophète portant la Parole de Dieu dans le monde.
Marc Pernot
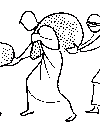
La Bible nous propose d’aimer Dieu et d’aimer notre prochain comme nous-mêmes1 . Ce résumé de l’essentiel est l’idéal de vie le plus célèbre dans le monde, à juste titre car il est vraiment excellent à garder en tête pour tracer son propre chemin dans la vie. Mais le mot « prochain » n’est pas très clair, peut-être. Les égoïstes en profiteront pour dire qu’il faut ainsi n’aimer que ses proches parents, amis ou voisins, c’est bien naturel, et ce serait de la part du Christ vraiment enfoncer une porte grande ouverte que de nous dire solennellement ça. Mais en réalité, Jésus nous propose d’aller au delà de cette évidence et d’aimer aussi, quand les circonstances le demandent, une personne étrangère ou une personne qui nous a fait du mal. C’est ce que fait Jésus, par exemple, en aidant un serviteur inconnu d’un centurion romain 2, ce qui est vraiment le type même d’une personne éloignée de Jésus du point de vue de la famille, de la religion, de la nationalité, de la morale, et qu’il n’a jamais rencontré.
Alors comment ce serviteur du centurion romain est-il le prochain de Jésus ? Pour comprendre la notion de « prochain« , il est utile d’aller rechercher le sens premier de ce mot dans la Bible. En hébreu, le mot « prochain » vient du mot « berger« . Notre prochain n’est donc pas une personne qui me serait proche physiquement, ni une personne dont je me serais approché, mais c’est une personne qui a le même berger que moi. Ce qui fait que nous sommes, toi et moi, un prochain de l’autre, c’est que Dieu veille sur toi comme il veille sur moi3 . Je ne sais pas s’il existe des extra-terrestres quelque part, mais si c’était le cas, il serait notre prochain, car Dieu serait notre berger commun.
Nous avons donc de très nombreux prochains, les autres personnes vivant actuellement ainsi que celles qui vivront dans les générations futures. Nous pouvons vouloir du bien à toutes ces personnes, mais concrètement nous n’arriverons pas à les aider toutes. Comme bien souvent, le commandement que nous donne Jésus est alors impossible à tenir, et c’est pour cela que c’est à la fois libérant et responsabilisant comme éthique (voir cet article). C’est impossible d’aimer tout le monde, mais il y a une ou des personnes qui nous sont confiées personnellement à un moment donné, en fonction des besoins, en fonction aussi du plan de Dieu, mais aussi, bien heureusement, en fonction de nos choix personnels et de nos qualités.
Il est d’ailleurs remarquable que ce commandement biblique « tu aimeras ton prochain » ne soit pas à l’impératif, mais au futur. Cela fait de cette phrase à la fois une proposition et une promesse. Avec l’aide de Dieu tu pourras enfin aimer (voir ce mot).
1 Marc 12:30-31, Jésus cite alors un passage du premier testament (Lévitique 19:18)
2 Matthieu 8:5
3 Voir par exemple le Psaume 121, mais aussi le Notre Père (Matthieu 6)
Marc Pernot
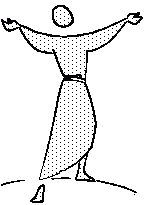
Dieu est créateur, il entre donc en relation avec l’univers. L’être humain est particulièrement sensible à ce que Dieu veut communiquer. Et l’être humain a quelque chose de plus que tout autre créature, il peut s’adresser à Dieu.
La prière est cette relation entre Dieu & l’être humain, et entre l’être humain & son Dieu. La prière est parfois quelque chose que l’on dit à Dieu, mais c’est principalement le fait de se placer devant Dieu en comptant sur lui pour qu’il nous fasse évoluer…
Quand prier ?
Certaines religions proposent de prier tant de fois par jour, ou de prier à tel et tel moment. Le Christ nous dit simplement que c’est une bonne idée de » Veiller et prier en tout temps. « 1
On peut choisir de prier le matin en se levant, avant les repas, en se couchant, ou dans la nature… Il n’y a pas de règle, sauf que la régularité aide certains à entrer plus facilement dans la prière.
Où prier ?
Quand le Christ meurt sur la croix, le voile du temple s’est déchiré, nous dit l’Évangile, ce voile venait fermer « le saint des saints », la pièce la plus sacrée du temple de Jérusalem, cela veut dire que par le Christ, l’univers entier devient le lieu sacré de la présence de Dieu. Tous les endroits se valent donc en principe pour prier, et le lieu le plus ordinaire devient le « saint des saints » quand quelqu’un s’arrête pour y prier Dieu. Mais il y a des questions psychologiques qui ne sont pas neutres non plus. Certaines personnes sont aidées par certains lieux, comme un joli petit coin chez eux, ou d’entrer dans une église, ou face à la nature, c’est parfait. Mais ce n’est pas Dieu qui écouterait mieux quand nous prions à tel endroit plutôt que tel autre, bien sûr.
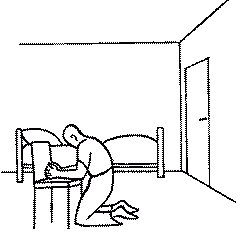
Comment prier ?
Quand ses disciples lui posent la question, Jésus répond : » Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. « 2 La solitude et le silence sont ainsi des éléments importants, mais sans que ce soit interdit de prier avec d’autres, comme le font les apôtres, et comme le faisait Jésus. Il se retirait souvent seul pour prier dans la nature, parfois il prie avec ses disciples. Chacun est ainsi libre de prier seul ou avec d’autres, à genoux, debout, couché, assis…
Qui prie-t-on ?
Dieu seul, en tout cas selon Jésus. C’est ce que nous montrent les évangiles (absolument chaque fois qu’il parle de la prière, il dit de prier le Père). Nous prions donc Dieu, et comme il nous le propose, nous le prions » au nom de Jésus-Christ « , c’est-à-dire en communion avec Jésus, avec dans l’esprit et dans le cœur cette confiance qu’il nous donne.
Que prier ?
C’est une question secondaire, finalement, parce que l’essentiel, c’est de prier. Mais il y a quand même des façons de prier qui sont plus positives que d’autres pour notre évolution.
En particulier, c’est bon de présenter à Dieu ce que l’on aimerait voir arriver (comme » Seigneur, j’aimerais tant que mon enfant guérisse « ). Mais peut-être est-il préférable de ne pas donner à Dieu des ordres, même si c’est pour demander une bonne chose (comme » Seigneur, guéris-le ! « ). En effet, Dieu sait ce qu’il doit faire et il le sait mieux que nous-mêmes. Il est donc préférable de ne pas lui parler à l’impératif et de nous préparer à recevoir ce qu’il nous offrira à son idée. Pour cela, il est bon d’être ouvert à tout, pas simplement fixé sur une seule chose que l’on attend de Dieu, car on risquerait alors d’être déçu et de passer à côté de la merveille qu’il voulait accomplir pour nous, en nous.
Si quelqu’un est malade, le problème ne vient pas de Dieu et nous n’avons pas à essayer de le convaincre que la santé est mieux que la maladie (Dieu est l’inventeur de la vie).
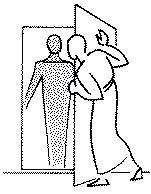
Notre prière peut contenir :
- une louange pour reconnaître que Dieu est Dieu, que c’est lui qui sait vraiment ce qui est le bien. On peut prier même si on ne sait pas bien qui il est, ou si l’on doute.
- une présentation de notre vie, pour placer notre journée passée devant son regard, pour nous réjouir de ce qui est bon et pour reconnaître aussi notre péché, notre besoin de lui. Nous pouvons aussi placer devant lui les heures qui vont suivre, pour qu’il nous aide à y voir plus clair et nous élève.
- un appel : on demande à Dieu de réaliser en nous les promesses de l’Évangile. On peut prier parce qu’on veut avoir la foi. On peut prier pour les autres, penser à eux devant Dieu, nous associer à lui dans notre amour pour eux, présenter à Dieu notre désir de leur apporter ce dont ils ont besoin pour avancer.
- ce que l’on a sur le cœur : On peut dire nos joies et nos peines avec Dieu, on peut exprimer nos projets et nos regrets… comme avec quelqu’un de très proche.
- du silence, pour laisser Dieu » parler « . Mais si l’on entend des voix, c’est probablement le voisin qui met la télé trop fort, Dieu parle au cœur, et sa Parole est plus que des mots.
Marc Pernot

Le prêtre est une personne qui est plus particulièrement chargée de faire l’intermédiaire entre le peuple et Dieu. Dans le peuple hébreu, à la suite de Moïse et de son frère Aaron, il y a eu des prêtres qui étaient principalement chargés des sacrifices d’animaux et des cultes lors des fêtes et des occasions spéciales. Ils étaient ainsi plus particulièrement chargés de faire monter à Dieu cette prière qu’est l’offrande. Mais au-delà de cette fonction particulière, c’est le peuple d’Israël tout entier qui est considéré comme étant « un peuple de prêtres » 1, chargé d’assurer ce lien entre l’humanité toute entière et le Dieu de l’univers.
Dans le Nouveau Testament, Jésus choisit des apôtres, envoie des disciples en mission, mais il ne parle pas d’une fonction de prêtre qui serait confiée à certaines personnes particulières et il n’est pas question de prêtres dans les premières églises chrétiennes. Il y avait des témoins privilégiés que sont les apôtres (voir cet article), il y a eu aussi dans une fonction nouvelle dans cette première église, celle des diacres, hommes ou femmes chargés par l’église d’être au service des pauvres et qui annonçaient également l’Évangile. Mais de prêtres, on n’en voit pas dans les églises de la première génération de disciples du Christ (en tout cas selon la Bible). En effet, c’est le Christ qui est le Prêtre, et il est le précurseur qui fait de tout être humain (homme ou femme) un prêtre.2
Il est le Prêtre : il est celui qui nous a permis d’être cœur à cœur avec Dieu. On n’a alors plus besoin de prêtres, comme en ont d’autres peuples, puisqu’en Christ, chacun, même le plus petit des petits, le plus pécheur des pécheurs peut s’adresser à Dieu sans crainte. Le Christ apprend à chacun à prier tout simplement dans le secret de sa chambre, qui devient alors comme le plus sacré des sanctuaires, le lieu de la rencontre avec Dieu, le Père qui est là dans le secret et entend, comme le dit Jésus3 .
Il n’y a ainsi pas de personnes mises à part pour assurer la fonction de prêtre dans l’Évangile, parce que l’humanité tout entière est appelée par le Christ à devenir un peuple ou chacun est un prêtre de Dieu. Il y a là une différence avec d’autres religions, cette différence a une base théologique fondamentale :
- Certaines religions sont un effort de l’homme pour atteindre Dieu, ou les dieux. Il faut alors des professionnels, des prêtres, pour entrer en contact avec un dieu qui est souvent considéré comme redoutable envers la personne mal préparée qui ose le déranger (c’est en tout cas ce que prétendent les prêtres de ces dieux).
- Le Christ nous montre que Dieu est présent, proche, qu’il n’est pas indifférent ou difficile à atteindre, mais infiniment accueillant pour quiconque accepte de répondre à son appel. Ce n’est ainsi pas l’homme qui fait des efforts pour entrer en contact avec Dieu, mais Dieu qui fait des efforts inouïs pour entrer en contact avec l’humanité.
Nous sommes donc tous prêtres (faisant monter vers Dieu notre prière), mais aussi des croyants (cherchant à écouter Dieu), et de témoins de ce Dieu qui aime l’être humain…
Pasteur

Pasteur veut dire berger en vieux français. Selon une image très courante dans la Bible, le Bon Berger c’est le Christ, ou c’est Dieu (voir Jean 10, Psaume 23). Cela veut dire que Dieu a pour chaque être humain l’attention, l’affection même, que le berger a pour un agneau. Il le guide là où il y a un pâturage et de l’eau, il le met à l’abri la nuit dans une bergerie pour qu’il ne soit ni dévoré par le loup ni volé par un brigand, il le soigne quand il est blessé et le recherche quand il est perdu et porte quand il est fatigué…
La théologie chrétienne au cours des premiers siècles a même largement représenté le Christ comme un berger. Cela était pour eux le meilleur résumé possible de son rôle et de l’évangile (voir le dossier des premiers symboles chrétiens sur ce sujet).
Quand on a dit cela, on ne peut plus dire que l’homme ou la femme qui est « pasteur » d’une paroisse est LE Berger. Mais sans doute doit-il, à sa mesure, essayer d’avoir la même attention afin qu’ensemble nous puissions faire un pas vers le Royaume de Dieu.
Le pasteur n’est pas un prêtre, parce que le pasteur n’est pas un intermédiaire entre Dieu et la personne. Le rôle du pasteur est plutôt d’aider à ce que chacun puisse progresser dans sa relation personnelle avec Dieu.
- Il est surtout un théologien et un spécialiste de la Bible. Il aide et stimule la recherche de chacun.
- Il n’a aucun pouvoir particulier ni pour accorder le pardon (chacun est responsable devant Dieu et Dieu seul, et nous pouvons tous annoncer le pardon de Dieu) ni pour célébrer les sacrements (communion, baptême). Tout ce qu’un pasteur fait un laïc peut le faire (s’il en est chargé par les délégués des personnes de l’église) : le culte, les bénédictions de mariage, les obsèques, les baptêmes, le catéchisme, le ménage du temple…
- Le pasteur est généralement marié.
Marc Pernot
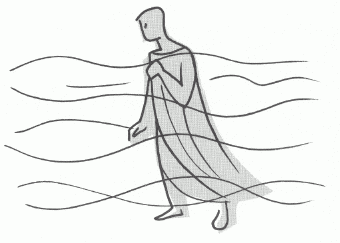
Cette notion a eu une certaine importance dans l’histoire de la théologie, particulièrement au XVIe siècle. Certains théologiens ont tellement voulu insister sur la puissance de Dieu qu’ils ont soutenu que si un homme se perd c’est qu’il était » prédestiné » à se perdre, Dieu l’ayant décidé ainsi par avance, comme il décide de sauver ceux qu’il a » prédestinés » au salut.
Du point de vue théologique cette notion est assez épouvantable si l’on pense que certaines personnes seraient ainsi totalement rejetées, et que finalement nous ne sommes que des pions dans la main de Dieu. Ce serait assez contradictoire, à mon avis, du Dieu que révèle Jésus-Christ.
Mais, heureusement, on peut comprendre autrement les textes bibliques utilisés par ces théologiens de la prédestination. C’est un fait d’expérience qu’il y a en chaque personne une part de bien et une part de mal, qu’il y a une dimension temporaire et qu’il y a également cette dimension d’éternité en chaque enfant de Dieu. Si l’on interprète les textes bibliques parlant du salut en tenant compte de cette réalité, alors, oui, la prédestination existe mais ce n’est plus une menace, mais une bonne nouvelle pour tous (ce qui est normal, dans l’Évangile). Il y a une part de bien en chacun de nous qui est » prédestinée » (si l’on veut utiliser ce terme) à être sauvée par Dieu, et il y a aussi une part de mal qui est » prédestinée » à être éliminée, ce qui est un bon débarras.
Marc Pernot

Un péché c’est une faute que nous commettons, le mal dont nous sommes la cause ou une occasion manquée de faire du bien.
Le péché, avec un article défini singulier, c’est le fait d’être coupé de Dieu. Lui, Dieu, n’est jamais coupé de nous, ne nous rejette ni ne nous abandonne jamais, même s’il se fait souvent discret au point d’être comme absent. Mais c’est nous qui sommes plus ou moins coupés de lui, quand on le rejette, ou quand on l’oublie. Le contraire du péché, c’est la foi.
Comme le dit l’apôtre Paul, nous sommes tous pécheurs 1. Dans un sens, il y a là une bonne nouvelle : cela fait de nous tous des frères et sœurs, et nous sommes tous au bénéfice du pardon de Dieu. Cela invite à être bienveillant dans notre façon de voir les fautes des autres 2.
Nous sommes tous pécheurs parce que nous faisons des erreurs (et même des horreurs), parfois sans savoir ce que nous faisons, parfois parce que nous n’avons pas eu la force de résister à la tentation, et parfois même en choisissant délibérément de faire le mal. Nous avons besoin d’être libérés de toutes ces faiblesses, et être fort comme l’est Jésus quand il résiste face à la tentation de mettre ses qualités (exceptionnelles) au service de sa propre gloire, et quand il tient bon face à la peur d’être persécuté3 .
Mais nous sommes tous pécheurs aussi pour une deuxième raison, c’est qu’il n’est pas possible de vivre en ce monde sans se salir les mains. Nous sommes souvent obligés de choisir entre des solutions dont aucune n’est parfaitement bonne, nous obligeant matériellement à faire le mal, même si nous cherchons à en faire le moins possible. Même Jésus était soumis à cela, à la complexité de la vie humaine en ce monde.
Pas de panique, nous dit l’Évangile, Dieu comprend, il aime, il pardonne. La question n’est donc pas là, Dieu n’est pas fâché contre nous quand nous avons fait du mal.
Mais le problème, c’est précisément ce mal que nous avons fait, car le mal, c’est de la souffrance, ou du bonheur qui ne sera pas vécu, c’est parfois des blessures et de la mort pour nous et pour d’autres personnes qui nous entourent ou qui nous succèderont sur cette terre. Même si Dieu nous pardonne, cela ne veut pas dire que la vie n’est qu’une fête où nous pouvons faire et ne pas faire n’importe quoi sans conséquences. Nous sommes responsables, et Dieu est un allié de choix pour nous aider à faire face à nos responsabilités.
Le second problème, essentiel, c’est nous-mêmes qui sommes loin d’être parfaits comme le prouvent toutes les fautes que nous faisons, elles sont comme la fièvre pour notre corps qui est un signe qu’il y a une maladie quelque part. Un bon médecin va observer ces symptômes pour mieux résoudre le problème à sa source, à la racine du mal. Pour ce qui est de notre vie, reconnaître nos péchés est essentiel afin de mieux savoir là où nous devrions progresser, travailler là-dessus. Dieu peut vraiment nous aider dans cette démarche, il peut nous ouvrir les yeux sur la réalité de notre vie, et comme Créateur, il apporte un secours irremplaçable dans notre évolution.
Le péché au singulier non plus ne fâche pas Dieu contre nous, il ne cesse jamais de nous aimer et de venir à nous. Mais nous ne lui facilitons pas la tâche quand nous refusons son aide.
À mon avis, personne n’est totalement coupé de Dieu, comme personne ne pourrait vivre sans une toute petite place pour l’amour ou l’espérance dans sa vie. Le tout petit peu de foi que nous avons est une espérance, car par ce petit début de foi un début de conversion (voir cet article) est possible, permettant à Dieu de commencer à nous libérer du péché et à nous créer.
1 Romains 3:10, 3:23
2 Romains 2:1
3 Matthieu 4:8, Matthieu 26:36
Marc Pernot
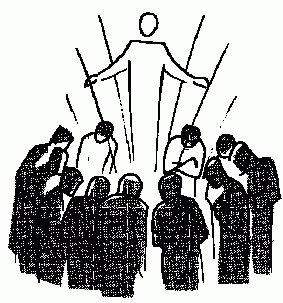
Parousie. C’est par ce mot savant (et grec) que l’on désigne le retour du Christ à la fin du monde. Des chrétiens de la première génération croyaient que cela devait arriver très prochainement. Certains ont arrêté ainsi de travailler, de se marier et d’avoir des enfants (voir dans la Bible le livre des Actes des apôtres et des lettres de Paul 1). L’attente des disciples se modifiera progressivement, comprenant que la fin du monde et le retour du Christ sont à attendre autrement.
Le retour du Christ est à attendre dans notre être, dans notre communauté humaine, et cela se réalise par notre conversion. C’est ce dont témoigne la fin de l’Évangile selon Matthieu : il conclut son livre en annonçant que le Christ n’est pas absent, mais vivant et présent à nos côtés tous les jours 2. C’est ce que vient à dire également l’apôtre Paul quand il nous dit que nous sommes collectivement le corps du Christ, un corps composé d’une multitude de membres dont le Christ vivant est actuellement la tête, coordonnant l’ensemble3 . C’est ce que dit aussi Jean quand il témoigne de cette promesse du Christ de demeurer en nous par l’amour4 .
Ce débat n’est pas une simple question de théologie abstraite, cela concerne notre vie quotidienne. C’est aujourd’hui qu’il faut vivre du salut de Dieu donné en Christ. Attendre encore la venue du messie, c’est passer à côté, attendre et attendre toujours le lendemain, cela fait 2000 ans que des chrétiens attendent ainsi que Jésus revienne établir son règne, alors que cette réalité est déjà donnée, et elle est à vivre maintenant. Cette façon d’annoncer le retour du Christ pour bientôt ressemble à cette blague que l’on raconte, où un barbier astucieux avait mis dans sa vitrine une affiche disant « demain, on rase gratis (gratuitement) », les passants venaient le lendemain se faire raser, mais comme l’affiche était encore dans la vitrine, c’était demain, toujours le lendemain que ce serait gratuit.
Le Royaume de Dieu est ainsi à la fois déjà partiellement là, en Christ, tout a été donné comme une graine de vie nouvelle dont nous voyons déjà les premières pousses. Mais l’accomplissement de son Royaume est encore à attendre et à construire. Comme le dit Jésus l’heure (du Royaume) vient encore mais elle est aussi vraiment déjà venue5, nous sommes à la fin des temps et cela a des chances de durer encore…
Le bien et le mal coexistent encore et nous attendons avec un peu d’incertitude pour savoir comment évoluent les choses. L’attente de la fin du monde (ou pour ceux qui veulent parler en franco-grec = l’eschatologie) est cette espérance qu’en définitive, le mal, la souffrance et la haine ne l’emporteront pas, mais que Dieu aura la victoire, que le bonheur et la vie auront le dessus 6.
1 1 Corinthiens 7:26…
2 Matthieu 28:20
3 1 Corinthiens 12
4 Jean 14:23
5 Jean 4:23
6 Romains 8:31…
Marc Pernot

En hébreu, c’est le même mot dabar qui signifie une parole et un acte. Ce détail est important pour mieux comprendre ce que l’on entend par « Parole de Dieu » : cela explique que la Bible nous dise souvent que la Parole de Dieu se voit autant qu’elle nous dit de l’écouter. Cela peut nous aider à mieux recevoir nous-mêmes ce que Dieu veut nous offrir.
La Parole de Dieu est un acte de création. On peut même dire que chaque fois que quelque chose devient vivant, ou progresse véritablement, il y a eu un acte de Dieu, une Parole de Dieu 1. Pourquoi est-ce que l’on a appelé alors » Parole » ce qui est un acte de Dieu ?
1) D’abord parce que cela dit comment Dieu agit, en offrant respectueusement ses services :
Quand un maçon monte un mur, les briques n’ont pas tellement leur mot à dire, elles sont manipulées et l’on ne leur demande pas de comprendre.
Mais Dieu crée le monde en parlant, en dialoguant. Il cherche plus à persuader qu’à contraindre. On a envie de dire qu’il choisit la difficulté, c’est vrai, car il a bien du mal à se faire comprendre et à se faire accepter par l’humanité qui n’écoute pas souvent, qui ne comprend pas tellement, qui oublie, provoque, et parfois fait le contraire par plaisir… Mais bon, comment forcer quelqu’un à vivre librement, comment forcer quelqu’un à aimer ? Ces capacités ne peuvent être données qu’après avoir été proposées et acceptées.
2) Et puis, comme la parole peut avoir du sens, les actes de Dieu ont du sens, ils ont une valeur qui les dépasse infiniment. Un acte de Dieu nous apprend quelque chose sur la façon d’être de Dieu, donc sur Dieu lui-même et sur ce que c’est que la vie juste et bonne. Par exemple quand Dieu crée la vie, on apprend que Dieu est » le vivant » et que notre mission est de développer la vie. Quand Dieu sauve, on apprend qu’il aime activement et que nous pouvons faire de même à notre mesure, quand Dieu parle, on apprend à la fois à écouter et à parler…
Comment, alors, écouter la Parole de Dieu, et recevoir cet acte de création qu’il nous propose individuellement aujourd’hui ? La Parole de Dieu peut venir d’un ange, ou de l’Esprit de Dieu, ou dans la prière (voir ces trois articles). C’est une réalité dont peuvent témoigner bien des personnes que nous connaissons. Mais il faut être très prudent avant de penser ou encore plus de dire « Dieu m’a dit que… » en effet, c’est au plus profond de nous-mêmes que cette Parole ou cet Acte de création de Dieu opère, et nous avons vite fait de confondre nos craintes ou nos désirs plus ou moins conscients avec la Parole de Dieu et vice-versa. Cela demande donc du discernement, cela demande d’en parler avec d’autres, de peser, de réfléchir à ce qui nous pousse en réalité, cela demande de prier encore. La lecture de la Bible (voir cet article) aide également car elle est une parole objective qui nous vient d’ailleurs et qui est un bon miroir pour nous-mêmes.
Parfois on entend dire que la Bible est la Parole de Dieu, c’est un peu vite dit. Ce serait extrêmement réducteur concernant cette Parole, puisque la Bible elle-même nous dit que Dieu est Parole et que le Christ est la Parole faite chair. La Parole, c’est ainsi une personne vivante, pas un objet matériel en papier avec de l’encre dessus. Mais la Bible n’est pas sans rapport avec la Parole de Dieu. La lecture de la Bible est bien souvent une occasion pour nous de recevoir la Parole. Quand nous lisons ces témoignages dans un esprit de prière, il arrive souvent que nous recevions de grandir dans la foi. Nous pouvons alors dire après coup que dans ce moment de lecture nous avons reçu effectivement une Parole de Dieu.
Cette Parole de Dieu, ce n’est pas non plus une parole comme l’est une leçon ou une recette de cuisine, à apprendre et à appliquer à la lettre. La Parole de Dieu, elle serait plutôt à manger comme du pain2 , il faut se saisir de la Parole, la mâcher, la digérer, l’assimiler et qu’elle devienne ainsi notre propre force. La Parole de Dieu n’est pas un chemin tout tracé mais une réalité qui nous développe.
Marc Pernot
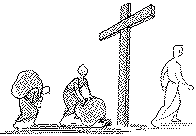
Le pardon de Dieu est total dans l’Évangile, c’est déjà une bonne chose à noter. Notre façon de vivre a évidemment une importance majeure, mais nous voyons souvent Jésus faire la distinction entre l’acte mauvais et celui qui l’a commis. Dieu a de la haine pour le péché mais de l’amour pour le pécheur. Dieu rejette la méchanceté, mais il accueille le méchant et désire l’aider à le devenir moins. C’est ça le pardon : ce n’est pas oublier la faute, mais c’est ne pas confondre le mal et celui qui en est l’auteur, c’est vouloir du bien même à l’auteur du mal.
Dans la prière essentielle qu’il nous propose, Jésus demande dans une même phrase « Notre Père, pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés« . Effectivement, le pardon de Dieu et le pardon que nous donnerions aux autres sont étroitement liés, mais ce n’est pas un chantage de la part de Dieu, bien entendu, comme si son amour était moins généreux que le nôtre. Mais en nous reconnaissant comme pécheur et au bénéfice du pardon de Dieu peut-être que ça pourrait nous donner l’envie de pardonner à notre tour, sait-on jamais ? Mais en réalité, je crois que Jésus nous propose de demander les deux à Dieu dans le Notre Père : le pardon de Dieu, et le pardon que nous pourrions donner aux autres.
C’est vrai qu’il est parfois impossible à nos forces humaines de pardonner ni même d’avoir envie de pardonner. Il est donc essentiel que Jésus ne nous dise pas » tu dois pardonner « , mais qu’il nous propose de le demander dans la prière, et que ce soit associé au pardon de Dieu. Le pardon est un domaine dans lequel il nous faut apprendre à grandir petit à petit, et il nous faut absolument l’aide de Dieu pour cela. Heureusement que le pardon n’est pas un commandement. Imaginez par exemple une maman dont l’enfant a été abîmé par un homme. Non seulement elle souffre avec son enfant, mais en plus elle est naturellement chargée de ressentiment contre le malade qui a commis cet acte. Il serait désastreux de lui dire » il faut pardonner » car cela ajouterait encore à son fardeau la culpabilité de ne pourvoir pardonner.
Mais ce que l’on peut dire, c’est qu’il est bon de pardonner, que ça fait un bien fou, que c’est une bénédiction. On peut dire que quand nous n’arrivons pas à pardonner nous pouvons alors demander à Dieu de nous aider à y arriver.
Il est bon d’être pardonné de Dieu, et il est bon d’arriver à pardonner nous-mêmes. La prière que Jésus nous a donné en exemple (le Notre Père 1) nous dit que le pardon est quelque chose que nous pouvons demander à Dieu et recevoir de lui. Cette prière nous permet aussi comprendre ce que Jésus nous propose quand il dit « tu pardonneras à ton frère« 2 , cela peut être pris comme une promesse, une force qui nous sera donnée par Dieu.
Un bon pardon est un pardon qui libère tout le monde, celui qui a été blessé et celui qui a blessé quelqu’un. Le pardon concerne ainsi plutôt l’avenir, il ne dispense pas d’essayer de réparer nos fautes quand c’est possible, ou de marquer au moins par un geste notre volonté de le faire.
Il n’est pas facile de pardonner, mais ce n’est pas facile non plus d’être pardonné par un autre. En effet, si nous avons un peu de cœur, nous avons du remord après avoir fait du mal à quelqu’un, nous ressentons envers lui comme une dette. Si cette personne nous pardonne, cela ajoute encore à ce sentiment de dette que nous ressentons envers elle. Il n’est ainsi pas facile d’être pardonné, et il est plus encore difficile de se pardonner à soi-même les bêtises que l’on a faites.
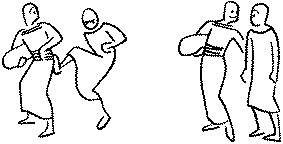
Dans tous les cas, le pardon de Dieu est une la source qui va nous aider. C’est ce qu’affirme la Bible, et c’est ce que peut ressentir le croyant. Dieu ne tient pas sans cesse la liste de tout ce que nous faisons de mal, il a un regard plus positif que cela sur nous. La preuve, c’est la façon dont se comporte le Christ vis-à-vis des pécheurs. Il relève la femme adultère 3, il raconte la parabole de la brebis perdue4 , il parle au brigand crucifié à côté de lui et prie pour les soldats romains qui sont en train de se moquer de lui tout en le crucifiant5 , Jésus nous montre cet amour de Dieu pour nous, pécheurs, nous offrant ainsi la certitude du pardon de Dieu.
À sa suite, nous avons parfois l’occasion d’aider quelqu’un à avancer sur le chemin du pardon, il nous arrive d’aider telles personnes à se réconcilier un peu, telle autre à essayer de réparer sa faute, une troisième à se pardonner à elle-même une faute irrécupérable… Quand cela arrive, on est alors vraiment content d’avoir pu y participer.
Marc Pernot
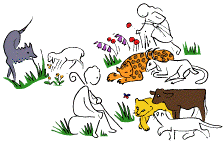
« Paradis » est un mot persan qui signifie le jardin des délices, en hébreu le « Jardin d’Éden ». Comme l’enfer (voir cet article) serait le séjour des morts pour toujours, le paradis serait le lieu où séjourneraient pour l’éternité les bienheureux accueillis par Dieu pour toujours. Là encore, il y a eu une dérive assez importante entre l’idée d’origine dans la Bible et ce qu’elle est devenue dans notre culture après des siècles d’assimilation de légendes diverses.
Dans l’Évangile, le Royaume de Dieu, ce n’est pas un lieu qui existerait quelque part, mais c’est un état, une façon d’être. Être dans le Royaume de Dieu signifie littéralement que Dieu règne sur nous. Ce Royaume, Jésus en parle au présent, il nous est donné tout de suite, là où nous sommes, alors que nous sommes encore vivants en ce monde. Voici deux exemples :
- « Le Royaume des cieux est à eux « (est maintenant à eux, au présent), promet-il à ceux qui sont « pauvres en Esprit« . C’est-à-die ceux qui demandent à Dieu son Esprit comme un pauvre demande le pain dont il a besoin pour être encore vivant demain. 1
- Quand les disciples demandent « Où est le Royaume de Dieu ? » Jésus répond : « Le Royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas : Il est ici, ou : Il est là. Car voici, le Royaume de Dieu est au-dedans de vous » (ou « au milieu de vous« ) 2.
On a parfois trompé les gens en leur promettant le paradis dans l’au-delà, à condition qu’ils acceptent de faire certaines choses maintenant. Le pire c’est que ce vieux truc marche encore (et fait la fortune des sectes).
L’Évangile ne joue pas ce jeu-là. Le Christ nous offre de recevoir maintenant le Royaume de Dieu, c’est à dire cette vie heureuse et pleine de valeur que Dieu veut pour nous dès cette vie présente. On ne peut pas tromper les gens avec une telle promesse, parce que l’on voit rapidement si c’est vrai ou non que la vie en relation avec Dieu est d’une extraordinaire valeur.
En Christ, nous sommes déjà dans le Paradis, nous y sommes partiellement mais réellement. Nous sommes encore de ce monde présent, tout pétri de matière, mais, par l’Esprit de Dieu, nous sommes déjà dans une dimension qui transforme ce monde et qui ouvre une perspective qui dépasse ce monde.
Marc Pernot
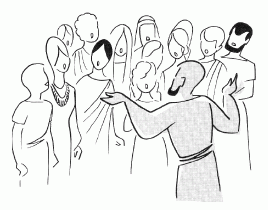
Jésus raconte souvent de courtes histoires aux foules qui se sont rassemblées pour l’entendre. On appelle ces histoires des paraboles parce que, comme une parabole en mathématique ou une antenne en forme de parabole, les petites histoires racontées par Jésus ont un sens qui mène infiniment loin.
En effet, ces histoires semblent toutes simples, mais quand on y regarde un peu, elles sont curieuses et même souvent dérangeantes. Jésus les explique rarement, comme s’il voulait faire réfléchir les gens par eux-mêmes, qu’ils se posent des questions et développent leur intelligence (voir cet article) et puissent ainsi évoluer dans leur propre façon de penser.
C’est pourquoi il est impossible de résumer une parabole car son principal intérêt ne se fait sentir que si on la lit et que l’on se pose des questions soi-même à cette occasion.
Marc Pernot
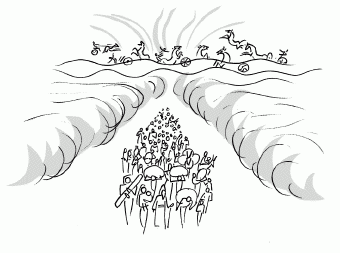
Pâque est un mot hébreu, פֶּסַח, Pessaḥ, qui veut dire le passage. Pâque nous rappelle l’importance de Dieu pour marcher vers la vie.
À l’origine, Pâque fait référence à la libération des Hébreux par Dieu racontée dans la Bible1. Dieu les a libérés de l’esclavage, il les a guidés, leur a expliqué ce que c’est que la vie bonne, les a nourris, et a finalement conduit le peuple hébreu dans le Désert jusqu’à la Terre promise. De génération en génération, les juifs célèbrent cette fête à peu près au printemps. Jésus suivait cette fête. Selon les Évangiles, Jésus a été crucifié et est ressuscité à peu près un jour de Pâques (aux environs de l’an 33 de notre ère). C’est une deuxième raison qui fait que les chrétiens sont attachés à la fête de Pâques et au dimanche.
Mais c’est surtout pour des raisons symboliques que la principale fête chrétienne (Pâques, avec un s), reprend la fête juive de Pâque. Nous ne sommes pas des esclaves du pharaon d’Égypte, comme les Hébreux, mais nous sommes encore plus ou moins esclaves de nos propres désirs, de nos préjugés, et des difficultés qui nous tombent dessus. Pour parler autrement, nous sommes à moitié morts et nous avons bien besoin de ressusciter. En Christ, nous pouvons nous laisser libérer par Dieu et cheminer dans la vie. Et le but de cette marche n’est pas une terre dans un endroit particulier, mais c’est vers le paradis, ou son Royaume, que Dieu nous conduit.
1 Voir le livre de l’Exode et sa suite
Marc Pernot
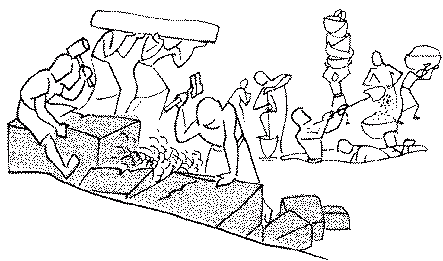
Bien des pages de la Bible témoignent du fait que Dieu cherche à nous donner la paix1 . Pour apprécier la pleine profondeur de ce don, il faut saisir le sens bien plus concret du mot “ paix ” en hébreu qu’en français. Pour nous, la paix, c’est d’abord la paix avec les autres et notre paix intérieure, qui sont toutes deux de très bonnes choses. Ces sens existent aussi en hébreu, mais l’hébreu shalom a également le sens d’achever la construction d’une maison2 de rembourser ses dettes3 , et d’être en bonne santé4 . Cette belle phrase de Jésus est alors plus compréhensible : » Heureux les artisans de paix, ils seront appelés enfants de Dieu « 5 . La paix se fabrique comme un maçon construit une maison ou comme une mère aide son enfant à grandir et à être en pleine forme.
Dieu donne la paix comme ça, en poursuivant son œuvre de création et en recherchant des relations harmonieuses entre les personnes, tout cela est vraiment bien dans sa nature. Dieu ne donne pas la paix comme on donne une orange. D’ailleurs la paix n’est pas quelque chose que l’on possède mais c’est quelque chose que l’on est, la paix est une qualité d’être comme la santé et l’aboutissement de notre construction. La paix c’est aussi une qualité de relation avec les autres, et cela est indissociable d’une certaine qualité d’être.
Dieu donne la paix comme il crée l’univers : en faisant évoluer la réalité dans le sens de la vie. Cette paix est déjà présente en nous (sinon ce serait invivable). Le pardon existe en ce monde, nous le vivons chaque jour sinon il n’y aurait plus personne sur terre depuis longtemps. La paix est donc bien là, mais elle est aussi à espérer, à construire encore.
C’est normal, car toute vraie création, toute évolution prend du temps, même pour Dieu. Surtout quand il s’agit pour lui de créer l’être humain, car alors, il n’a pas à travailler avec de la matière inerte comme quand il crée les galaxies, mais pour créer l’humain et créer la paix il doit alors travailler avec une » matière première » vivante qu’il choisit de respecter infiniment : la personne humaine. C’est avec nous que Dieu pourra construire peu à peu la paix qu’il nous souhaite.
1 Nombres 6:26, Ésaïe 54:10, Jean 14:27
2 1 Rois 9:25
3 Exode 21:34
4 Genèse 37:14
5 Matthieu 5:9
Marc Pernot
R
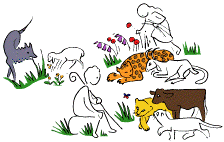
« Paradis » est un mot persan qui signifie le jardin des délices, en hébreu le « Jardin d’Éden ». Comme l’enfer (voir cet article) serait le séjour des morts pour toujours, le paradis serait le lieu où séjourneraient pour l’éternité les bienheureux accueillis par Dieu pour toujours. Là encore, il y a eu une dérive assez importante entre l’idée d’origine dans la Bible et ce qu’elle est devenue dans notre culture après des siècles d’assimilation de légendes diverses.
Dans l’Évangile, le Royaume de Dieu, ce n’est pas un lieu qui existerait quelque part, mais c’est un état, une façon d’être. Être dans le Royaume de Dieu signifie littéralement que Dieu règne sur nous. Ce Royaume, Jésus en parle au présent, il nous est donné tout de suite, là où nous sommes, alors que nous sommes encore vivants en ce monde. Voici deux exemples :
- » Le Royaume des cieux est à eux (est maintenant à eux, au présent) « , promet-il à ceux qui sont » pauvres en Esprit » (ceux qui demandent à Dieu son Esprit comme un pauvre demande le pain dont il a besoin pour être encore vivant demain). 1
- Quand les disciples demandent » Où est le Royaume de Dieu ? » Jésus répond : » Le Royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas : Il est ici, ou : Il est là. Car voici, le Royaume de Dieu est au-dedans de vous » (ou » au milieu de vous « ) 2.
On a parfois trompé les gens en leur promettant le paradis dans l’au-delà, à condition qu’ils acceptent de faire certaines choses maintenant. Le pire c’est que ça marche encore, ce vieux truc (et ça fait la fortune des sectes).
L’Évangile ne joue pas ce jeu-là. Le Christ nous offre de recevoir maintenant le Royaume de Dieu, c’est à dire cette vie heureuse et pleine de valeur que Dieu veut pour nous dès cette vie présente. On ne peut pas tromper les gens avec une telle promesse, parce que l’on voit rapidement si c’est vrai ou non que la vie en relation avec Dieu est d’une extraordinaire valeur.
En Christ, nous sommes déjà dans le Paradis, nous y sommes partiellement mais réellement. Nous sommes encore de ce monde présent, tout pétri de matière, mais, par l’Esprit de Dieu, nous sommes déjà dans une dimension qui transforme ce monde et qui ouvre une perspective qui dépasse ce monde.
Marc Pernot
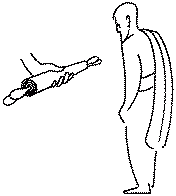
Le Dieu de la Bible est un Dieu qui prend les devants pour aller vers l’homme et lui apporter quelque chose. Il fait même plus que cela, Dieu s’expose, il se » révèle » à ses créatures que nous sommes, et c’est déjà un peu comme s’il nous considérait comme étant de peu inférieurs à lui (ce qui est fou) 1.
Cette façon d’être de Dieu, est une révolution par rapport à d’autres religions dont le but est d’essayer d’attirer l’attention et la bienveillance du divin, ou des religions dont la divinité ne fait pas grand chose pour aider l’homme à s’élever. Le Dieu de la Bible est ainsi le Dieu de la grâce, le Dieu de l’alliance, le Dieu de la Parole (voir ces articles).
La révélation de Dieu est progressive dans l’histoire de l’humanité, car il nous est naturellement difficile de nous figurer cet être unique en son genre qu’est Dieu. Mais en Christ Dieu se révèle d’une manière décisive, nous mettant en relation avec lui, c’est lui-même qui nous révélera par son Esprit toute chose 2, en tout cas tout ce qu’il nous est utile de savoir aujourd’hui.
Marc Pernot
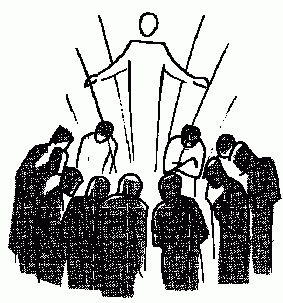
Parousie. C’est par ce mot savant (et grec) que l’on désigne le retour du Christ à la fin du monde. Des chrétiens de la première génération croyaient que cela devait arriver très prochainement. Certains ont arrêté ainsi de travailler, de se marier et d’avoir des enfants (voir dans la Bible le livre des Actes des apôtres et des lettres de Paul 1). L’attente des disciples se modifiera progressivement, comprenant que la fin du monde et le retour du Christ sont à attendre autrement.
Le retour du Christ est à attendre dans notre être, dans notre communauté humaine, et cela se réalise par notre conversion. C’est ce dont témoigne la fin de l’Évangile selon Matthieu : il conclut son livre en annonçant que le Christ n’est pas absent, mais vivant et présent à nos côtés tous les jours 2. C’est ce que vient à dire également l’apôtre Paul quand il nous dit que nous sommes collectivement le corps du Christ, un corps composé d’une multitude de membres dont le Christ vivant est actuellement la tête, coordonnant l’ensemble3 . C’est ce que dit aussi Jean quand il témoigne de cette promesse du Christ de demeurer en nous par l’amour4 .
Ce débat n’est pas une simple question de théologie abstraite, cela concerne notre vie quotidienne. C’est aujourd’hui qu’il faut vivre du salut de Dieu donné en Christ. Attendre encore la venue du messie, c’est passer à côté, attendre et attendre toujours le lendemain, cela fait 2000 ans que des chrétiens attendent ainsi que Jésus revienne établir son règne, alors que cette réalité est déjà donnée, et elle est à vivre maintenant. Cette façon d’annoncer le retour du Christ pour bientôt ressemble à cette blague que l’on raconte, où un barbier astucieux avait mis dans sa vitrine une affiche disant « demain, on rase gratis (gratuitement) », les passants venaient le lendemain se faire raser, mais comme l’affiche était encore dans la vitrine, c’était demain, toujours le lendemain que ce serait gratuit.
Le Royaume de Dieu est ainsi à la fois déjà partiellement là, en Christ, tout a été donné comme une graine de vie nouvelle dont nous voyons déjà les premières pousses. Mais l’accomplissement de son Royaume est encore à attendre et à construire. Comme le dit Jésus l’heure (du Royaume) vient encore mais elle est aussi vraiment déjà venue5, nous sommes à la fin des temps et cela a des chances de durer encore…
Le bien et le mal coexistent encore et nous attendons avec un peu d’incertitude pour savoir comment évoluent les choses. L’attente de la fin du monde (ou pour ceux qui veulent parler en franco-grec = l’eschatologie) est cette espérance qu’en définitive, le mal, la souffrance et la haine ne l’emporteront pas, mais que Dieu aura la victoire, que le bonheur et la vie auront le dessus 6.
1 1 Corinthiens 7:26…
2 Matthieu 28:20
3 1 Corinthiens 12
4 Jean 14:23
5 Jean 4:23
6 Romains 8:31…
Marc Pernot
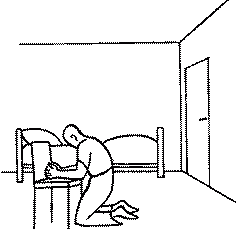
Le récit de création qui est au début de la Bible n’est évidemment pas un reportage scientifique, mais c’est un traité de théologie fondamentale. Il nous dit que Dieu est créateur et qu’il crée dans le temps, jour après jour, dans une sorte de progression qui prend au total sept jours. L’être humain est créé le 6e jour, et Dieu lui confie la mission d’agir dans le monde et de se développer. Le 7e jour, Dieu a encore fait une chose essentielle qui lui permet d’achever son œuvre de création. Qu’est-ce qu’il a fait ce 7e jour ? Dieu a créé le repos, il a béni ce jour du repos et il s’est lui-même reposé, nous montrant l’exemple.
Ce jour de repos nous rappelle que notre vie a un sens, même quand nous ne produisons rien. Nous ne sommes pas un simple outil, notre dignité dépasse notre simple utilité, c’est fondamental pour nous et pour ceux qui sont faibles. Mais l’amour, c’est cela. Il y a même de vieux objets devenus inutiles depuis longtemps qui nous sont chers.
Ce jour de repos est aussi un temps où nous laissons Dieu travailler en nous et nous donner sa bénédiction non pas seulement sur nos actes mais sur notre personne en elle-même.
Samedi veut dire » jour du sabbat « , le jour du repos des juifs. Dimanche veut dire » jour du Seigneur « , que les chrétiens ont choisi pour des raisons symboliques comme nouveau jour du repos et de la bénédiction après la venue du Christ. En effet, avec lui, nous sommes au-delà des 7 jours de la création de ce monde, dans un 8e jour qui est au delà du temps, un jour éternel, celui du Royaume de Dieu.
Le Christ n’était pas intégriste sur la question du jour du repos. L’essentiel est de garder concrètement du temps pour placer son être sous la bénédiction de Dieu. Jésus gardait du temps pour se reposer, pour prier, et pour être avec ses amis.
Marc Pernot
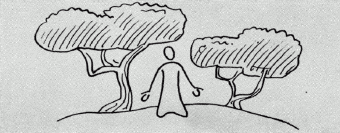
Une religion se manifeste par un culte rendu à Dieu. Dans la Bible, c’est Dieu qui prend l’initiative de bénir l’être humain, de lui parler et d’être à son écoute. Le culte est une façon d’entrer dans cette relation en bénissant Dieu, en lui parlant et en l’écoutant.
Il est utile de ne pas mettre sur le même plan la religion et la foi. La religion est un acte, la foi est un état. Il y a un rapport entre les deux, mais la foi est l’essentiel. La religion est comme une salle de musculation pour la foi, elle est un moyen d’expression de la foi, mais l’essentiel c’est la foi.
Dans la Bible, le culte évolue selon les circonstances et le temps. Il y a les grands rassemblements, sur convocation de l’assemblée. Il y a également le culte personnel qu’un homme ou une femme décide de rendre à Dieu dans un moment important de sa vie.
Parfois il prie seulement 1, ou il chante un poème2 , parfois il dresse un autel et sacrifie une part de ses biens pour remercier Dieu et signifier son désir de le servir3 . Quand un temple sera en état de servir à Jérusalem ce sera le lieu central de la religion juive4 , et l’on voit plusieurs fois Jésus y aller en pèlerinage pour la Pâque. Il y avait aussi dans la religion juive de l’époque de Jésus une multitude de commandements de choses à faire ou à ne pas faire (dans la façon de manger, de vivre). Jésus était un juif pratiquant, sans être fanatique ou intégriste. Il priait en général seul, en se mettant à l’écart. Mais il allait aussi à la synagogue pour le culte5 . La Bible était lue et commentée par les participants lettrés, des psaumes étaient chantés.
Jésus n’a pas fondé une nouvelle religion, le christianisme. D’ailleurs ses disciples vont continuer d’abord à pratiquer le judaïsme après sa disparition. Mais…
le message de Jésus contenait des notions d’ouverture à tout être humain, juif comme non juif, homme ou femme, à entrer dans l’alliance avec Dieu.
et puis, Jésus donnait plus d’importance à la foi et au service des autres qu’à la religion elle-même.
Et ainsi, progressivement, des païens de plus en plus nombreux se sont joints aux disciples juifs de Jésus, la religion a été recentrée pour laisser le maximum d’importance à la foi personnelle, plus qu’aux commandements religieux. Une nouvelle religion est née, le christianisme, fille de la religion juive.
Il y a différentes façons d’être chrétien, différentes sensibilités, différentes institutions humaines (les églises). Mais il y a une unité profonde et rien ne devrait nous empêcher de nous sentir frères et sœurs en Christ.
Un sportif » non pratiquant » n’est pas tellement sportif ! De même, un chrétien » non pratiquant » n’est en réalité pas tellement chrétien. Car, par définition, un chrétien c’est quelqu’un qui est de religion chrétienne, c’est à dire quelqu’un qui est en relation avec Dieu en faisant confiance au Christ pour cela. Être en relation avec quelqu’un cela veut dire que l’on prend du temps pour le rencontrer, pour lui parler et pour l’écouter.
Notre religion a une dimension personnelle essentielle (dans l’intimité de notre chambre), elle a aussi souvent une dimension familiale, et une dimension communautaire dans une église.
1 Jean 6:14-15
2 lire par exemple les Psaumes 8, 23, 121
3 Genèse 8:20 (Noé), Genèse 12:7 (Abraham)…
4 Les parents de Jésus au Temple de Jérusalem (Luc 2:22-24)
5 Luc 4:14…
Marc Pernot
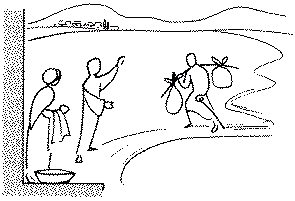
La Réforme est un événement important dans l’histoire, non seulement sur le plan religieux, mais aussi dans le domaine politique, pour la pensée, la musique et la littérature.
Mais ce n’est pas tellement cela qui compte le plus pour chacun. L’important, c’est d’être dans un esprit de réforme. Les protestants ne se sentent pas liées à ce que pensaient tel ou tel théologien comme Calvin, Luther, ou un autre. Ce qui compte pour nous c’est ce cheminement qu’est le Christ 1 . Il nous appelle à nous convertir, à nous réformer sans cesse. Cela relativise évidemment toute expression dans le domaine de la théologie, de la morale ou de la religion. Il n’y a d’absolu et de bon que Dieu seul.
Chaque église chrétienne doit se réformer sans cesse. C’est encore plus difficile pour une église que pour les personnes qui la composent. Toutes les associations humaines sont comme ça : elles ont du mal à évoluer. Il faut d’abord se mettre d’accord, changer les textes, les murs, les habitudes… Mais telles qu’elles sont, avec leurs qualités et leurs défauts, les églises nous aident à approfondir notre foi et notre théologie. Elles nous aident également à témoigner dans le monde. Alors, aidons-les à se réformer, et pour cela, commençons par nous laisser nous-mêmes réformer par Dieu.
1 Jean 14:6
Marc Pernot
S
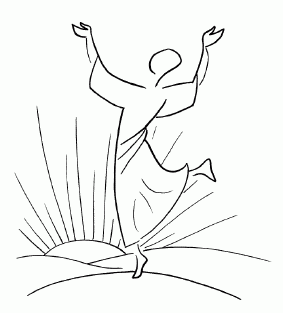
La foi n’est pas seulement le sentiment religieux, mais elle n’est pas que de la théologie non plus. L’idéal serait que notre relation à Dieu concerne chacune des différentes dimensions de notre être. Or, l’émotion est une dimension importante et noble de notre existence. Celui qui ressent la présence de Dieu, son amour puissant, celui qui a un cœur qui brûle d’enthousiasme dans la prière, celui qui ressent l’appel du Père… celui-là vit quelque chose de très beau. 1
Il est possible que vous ne soyez pas ainsi. Cela peut venir un jour, ou bien progressivement. Nous ne sommes pas des robots. Certains sont grands et d’autres sont maigrichons sur le plan physique, c’est la même chose pour le sentiment religieux. Ce qui est bon, c’est de progresser, quel que soit le niveau où l’on est à un moment donné. Pour le domaine du sentiment religieux, comme pour la force physique, le fait de n’être pas très fort n’empêche pas de faire de l’exercice et de progresser, au contraire.
Il est bon pour tout le monde de prier et de penser à Dieu, c’est même très bon pour celui qui ne ressent pas très intensément de sentiments religieux.
1 Matthieu 19:26
Marc Pernot
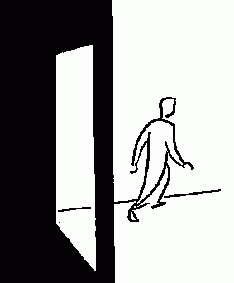
Dieu sauve les êtres humains. C’est une conviction fondamentale dans la Bible.
Comme Dieu a libéré le peuple hébreu d’Égypte, Dieu libère chaque homme (progressivement). Il le libère du néant en le créant, il le libère de la culpabilité par son pardon, il le libère de faux dieux, du péché, d’une vie mal placée, de lui-même. Et Dieu nous libère des chaînes de la mort.
Jésus-Christ a une place unique et décisive dans ce salut pour tous les êtres humains.
Par ce qu’il a dit. C’est effectivement passionnant, il y a dans l’Évangile une théologie et une philosophie de vie qui sont géniales, qui méritent que l’on bâtisse sa vie dessus, où que l’on en tienne compte pour élaborer son propre idéal de vie.
Par ce qu’il fait. Par exemple, quand il guérit un aveugle cela aide concrètement cette personne, ce qui est déjà bien. Mais plus largement, cette guérison nous concerne tous. Le salut en Christ n’est pas que de l’ordre de la pensée, mais il est une transformation de notre être, une naissance et une résurrection, une libération et une guérison.
Par ce qu’il est : le Christ. En lui, une étape décisive dans la création de l’humanité est donnée par Dieu. Il est comme un germe de vie nouvelle qui a été semé dans le monde et qui est encore en développement.
Au Moyen âge, on pensait que Jésus nous avait sauvés en achetant notre pardon auprès de Dieu par ses souffrances sur la croix. On n’est absolument pas obligé de comprendre le sens de sa mort comme cela. En effet, cette théorie suppose un Dieu terrible pour qui toute faute demanderait une expiation.
Or, l’Évangile, c’est que Dieu est amour. Le salut de Dieu offert en Jésus-Christ est résumé dans cette phrase qui est une des plus connues de la Bible : » Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu’il ait la vie éternelle. « 1 On lit dans ce passage essentiel :
- ce qu’est le salut : la vie éternelle.
- l’origine du salut : l’amour premier de Dieu, la grâce.
- la place du Christ, rendant possible la foi.
- la place de l’homme dans le salut, et sa liberté.
Nous sommes ainsi » sauvés par grâce, par le moyen de la foi « 2
Marc Pernot
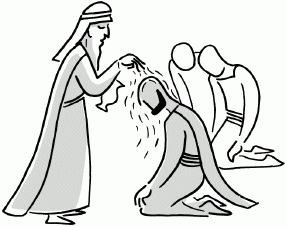
Dans la Bible, la sainteté n’est pas une qualité morale, mais elle est un regard de Dieu sur nous. C’est toujours Dieu qui sanctifie l’homme , cela veut dire qu’il considère chacun comme une personne irremplaçable et qu’il compte sur cette personne pour qu’elle devienne prophète, prêtre et créateur à sa mesure, là où elle est. Et s’il nous appelle saint, il nous donne aussi ce dont nous aurons besoin pour assumer notre vocation.
La question est de vivre de cette sainteté que Dieu nous donne. Bien des prophètes sentant l’appel de Dieu se sentent indignes de cette mission. Par exemple Moïse dit qu’il parle mal, qu’il ne connaît pas Dieu, qu’il est trop ceci et pas assez cela2 . Dieu discute, rassure, il donne aussi ce dont nous avons besoin pour assumer notre vocation. Moïse accepte de se laisser former sur certains points mais il persiste à dire qu’il ne parle pas bien, que sa langue s’embrouille. Dieu, bien sûr, aurait pu lui apprendre aussi à parler clairement, c’est quand même lui qui a créé la parole. Mais bon, Moïse se bloque un peu bêtement, Dieu en tient compte, il lui dit de faire équipe avec son frère Aaron, et c’est comme cela que le peuple hébreu sera libéré. C’est normal que Moïse ait eu un peu de mal à se sentir ainsi choisi, sanctifié, nous avons parfois trop le sentiment de nos faiblesses (nous nous sentons trop vieux, trop jeune, trop bête…), parfois nous avons au contraire des ambitions extraordinaires, nous voulons partir à l’autre bout du monde pour sauver à nous tout seul un peuple en péril. Parfois nous ne pouvons qu’une petite chose mais avec un supplément de force venu de Dieu, ou en faisant équipe avec d’autres nous pourrons effectivement accomplir la mission.
Comment savoir, comment vouloir la chose juste, comment pouvoir l’accomplir… toutes ces questions essentielles sont à creuser dans une vraie relation à Dieu. C’est la vérité de Dieu qui nous sanctifie, nous dit Jésus3 , autrement dit c’est la fidélité (voir l’article sur la vérité) qui nous sanctifie, la fidélité de Dieu, bien entendu, qui est plus solide que tout, et notre foi pour recevoir cette sanctification que Dieu nous offre.
1 Lévitique 21:8 “Je suis saint, moi, l’Eternel, et je vous sanctifie.”
2 Exode 3
3 Jean 17:17, 1 Corinthiens 6:11
Marc Pernot
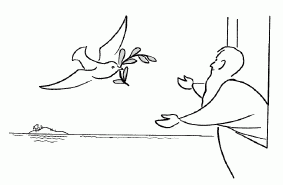
Le mot sacrement n’est pas vraiment biblique, c’est un mot d’église qui sert à désigner certains actes majeurs de la religion chrétienne. Un sacrement, c’est un signe visible de la grâce universelle de Dieu. Un signe qui a été donné par le Christ et qui s’est pratiqué d’une manière générale dans les églises depuis ce temps-là.
Nous avons deux sacrements : le baptême et la communion.
Le » signe visible » dans le baptême est l’eau, et pour la communion ce sont le pain et le vin.
Dans les deux cas, ils sont signes de la grâce universelle de Dieu, grâce qui est pour tout homme et toute femme de la terre, de toutes les générations.
Dans les évangiles, nous avons des récits où le Christ nous propose de perpétuer ces signes.
Il pourrait y avoir d’autres » sacrements « . Par exemple le Christ lave les pieds de ses disciples lors de son dernier repas avec eux, et il nous invite à être de même au service des autres. Nous pourrions célébrer ainsi un rite de lavage mutuel des pieds, c’est d’ailleurs pratiqué par certaines églises. Mais l’on a souvent trouvé que cela n’ajoute pas grand-chose à ce que la communion signifie, si on comprend ce geste comme signe du Christ donnant sa vie pour nous et nous appelant à donner notre vie pour le service des autres, en mémoire de lui.
Le mariage pourrait être appelé un sacrement, mais nous ne l’appelons pas ainsi parce que ceux qui ne sont pas mariés n’auraient pas reçu ce sacrement, ce qui ne nous semble pas bien rendre le côté universel de la grâce de Dieu en Christ.
Les sacrements sont importants. Mais il est bon de noter qu’ils ne sont que des signes, et que la réalité signifiée est de loin l’essentiel. Il faut ainsi relativiser l’importance de la forme visible de la religion. Dieu n’attend pas le sacrement pour accorder sa grâce. Il accorde sa grâce de toute façon, il bénit ses enfants et leur vie. C’est nous qui avons besoin de gestes visibles et des paroles pour manifester cette grâce invisible afin de pouvoir un peu mieux en vivre, par la foi.
Marc Pernot
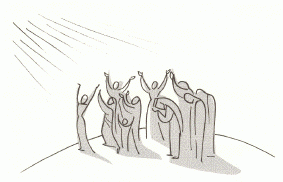
Ce qui est » sacré « , c’est Dieu. Et par conséquent, ce qui est sacré dans ce monde, c’est la vie, en particulier la vie humaine et ce qui la rend belle : la foi, l’espérance et l’amour. C’est pourquoi aucun objet ou aucun lieu, aucun rite ni fête n’est sacré.
Les bâtiments dans lesquels nous nous rassemblons pour rendre un culte à Dieu ne sont pas sacrés pour nous. Dans l’Évangile, le temple de Dieu c’est l’être humain1 . Le pain de la communion n’est pas sacré, c’est d’être en communion avec le Christ qui l’est. Mais tant mieux si le pain nous aide à l’être un peu plus et si nous nous sentons bien dans nos lieux de cultes, c’est leur fonction.
Un lieu où il s’est passé un événement capital pour l’histoire peut être un souvenir important pour quelqu’un ou même pour l’humanité, mais ils ne sont pas plus » sacrés » que n’importe quel mètre carré de terre qui porte un être humain.
Il est bien utile de nous donner un jour de rendez-vous avec les autres pour nous rassembler pour rendre un culte à Dieu, mais le dimanche n’est pas pour nous un jour sacré, pas plus que le jour de Noël ou le jour de Pâques. Ces dates sont fixées pour des questions de symbole, mais l’essentiel n’est pas la date ou le symbole, c’est ce qu’il représente. Ce n’est donc pas grave d’être parti au travail ou même à la pêche tel ou tel de ces jours, si c’est en connaissance de cause et si l’on se débrouille pour avoir quand même une bonne qualité de recherche de Dieu.
Cela dit, l’apôtre Paul nous fait remarquer très justement que ce n’est pas parce que l’Évangile du Christ nous a ainsi libérés que nous pouvons nous permettre de choquer les autres2 .
1 Jean 2:21, 1 Corinthiens 6:19
2 1 Corinthiens 8:9, Galates 5:13
Marc Pernot
T
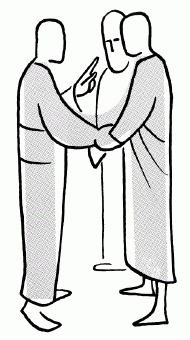
Que Dieu soit à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, trois personnes en un seul Dieu… C’est une idée subtile qui est apparue peu à peu dans l’Église, après plusieurs siècles de réflexions, de résistances et de discussions.
Le Christ n’en a jamais parlé, ni de près ni de loin. Cela relativise l’importance de cette expression théologique. Dans certains textes du Nouveau Testament, il y a dans la même phrase les notions majeures de Père, de Fils et d’Esprit, parfois on remarque un lien entre ces notions, mais on ne trouve pas explicitement dans la Bible cette idée de Dieu « 3 en 1 ». L’avantage de ce développement sophistiqué est qu’il rend bien compte de la richesse de la théologie chrétienne. L’inconvénient, c’est qu’il expose celui qui n’en saisit pas toute la finesse au risque de se retrouver avec trois dieux.
À mon avis, ce concept de trinité ne parle pas de Dieu en lui-même, il serait fou de penser pouvoir décortiquer ce qu’il est comme une machine que l’on démonte pour voir comment elle marche. Qui sommes-nous pour espérer psychanalyser Dieu et dire la manière dont il vit en lui-même ?
Il est plus prudent de considérer la trinité comme nous parlant simplement de la façon dont Dieu entre en relation avec notre monde. Dieu est unique, et les trois personnes de la trinité nous disent différents types de relations que Dieu nous semble avoir avec nous :
- En considérant Dieu comme Père nous avons la vision d’un Dieu fort qui est le chef de famille. Être chrétien c’est le reconnaître comme son Seigneur et le suivre avec respect. Être chrétien c’est en même temps quelque chose de formidablement grand, puisque nous sommes fils et filles de ce Dieu qui est notre Père, nous sommes ses héritiers, pas de simples employés.
- En considérant Dieu comme Fils, nous sommes invités à imiter le Christ en agissant dans le monde pour sauver les autres, en annonçant l’Évangile et en guérissant comme nous le pouvons celui que Dieu place sur notre route.
- Et en considérant Dieu comme Esprit, nous attendons la présence de Dieu en nous, une présence active qui nous soutient et nous console. Une présence de Dieu qui fait de nous son enfant 1.
La trinité nous dit ainsi quelque chose de fondamental sur notre relation avec Dieu et sur son unicité.
1 Jean 1:13, Jean 3: 5…
Marc Pernot
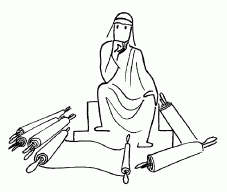
Se poser des questions est un peu fatigant, mais c’est bien utile pour avancer, pour progresser dans sa réflexion. Cela est indispensable pour être un peu plus maître de ce que l’on vit. Et, finalement, on prend facilement goût à la réflexion, c’est un sport cérébral qui peut être amusant.
L’idéal que l’on se fixe, l’idée que l’on se fait de Dieu ou de la valeur de la personne humaine… ces questions ont une influence considérable sur notre façon de vivre, et même sur notre société. Cette influence est claire quand on regarde les événements de l’histoire ou les actualités. Une théologie ou une idéologie malsaine peuvent conduire à des horreurs. Au XXe siècle, ce sont surtout des idéologies athées qui ont soutenu d’immenses atrocités, mais dans l’histoire, même le christianisme, pourtant fondé sur l’Évangile de la grâce, a été parfois récupéré pour justifier des actes qui n’auraient pas dû être possibles.
Le résultat de notre réflexion est donc important, mais finalement le plus important, c’est surtout le fait de réfléchir par soi-même, de chercher Dieu, de chercher à le connaître et à s’inspirer de lui.
C’est cette démarche que nous propose le Christ quand il parle de conversion (se convertir c’est se tourner vers Dieu, c’est chercher Dieu).
Jésus invite chaque croyant à réfléchir par lui-même, dans la confiance que nous donne l’amour de Dieu pour nous. C’est une constante des paroles et de la façon d’être de Jésus : ses paraboles nous invitent à réfléchir, mais aussi : ses commandements impossibles du genre “ soyez parfaits comme Dieu lui-même est parfait ” 1, ses paroles provocantes, ses gestes, sa liberté vis-à-vis des commandements de la Loi, sa mort même… Tout nous invite à réfléchir par nous-mêmes, et à cheminer ainsi dans l’amour de Dieu. Quand on a réfléchi par soi-même à ce qui nous semble être juste aux yeux de Dieu, on est bien plus dans la vérité (voir cet article), au sens de l’Évangile que quand on nous force par la crainte à suivre une voie toute tracée, ou que l’on reste aveuglément prisonnier de nos préjugés.
Ce n’est pas facile de construire la toiture de sa maison en pleine tempête de neige… il est également plus facile de réfléchir et de construire sa foi quand la vie n’et pas trop difficile et que notre envie de Dieu est forte. Si malheureusement une tempête arrive dans notre vie, nous serons alors plus armé pour y faire face, grâce à une capacité à réfléchir mais surtout avec une relation à Dieu assez familière pour recevoir ce qu’il nous offrira pour nous soutenir.
La diversité des théologies est une bonne chose, elle nous rappelle que Dieu est toujours au-delà de ce que l’on peut en dire. Il n’y a rien de choquant à cette diversité, si l’on demande à deux personnes de témoigner de la personnalité d’un ami commun, ils ne diront pas tout à fait la même chose. Or, Dieu est encore infiniment plus difficile à cerner encore qu’une personne humaine.
Nous sommes naturellement tentés de penser que notre propre théologie, ou notre philosophie sont les seules bonnes. C’est malsain à plusieurs titres :
- cela ne facilite pas nos rapports avec les autres,
- c’est de l’idolâtrie, au sens propre du terme, prenant pour Dieu une image fabriquée par l’homme (en l’occurrence, notre théologie qui devient comme sacrée).
- et c’est malsain pour notre propre développement, interdisant tout retour en arrière, toute reconnaissance de nos propres erreurs.
Au contraire, la Bible est pluraliste et accepte de mettre sous la même reliure des livres qui expriment des sensibilités différentes de foi en Dieu. Déjà dans la Bible hébraïque, il y a des courants théologiques très divers. Dans le Nouveau Testament, cette diversité de témoignages est encore plus centrale, avec quatre évangiles et non un seul pour transmettre l’essentiel sur le Christ. L’Église a heureusement eu la sagesse de garder cette diversité. Avec cela, il faut vraiment le vouloir pour être intégriste !
Mais cette diversité n’est quand même pas un chaos total, l’essentiel rassemble les chrétiens dans leur recherche théologique : la foi en Christ, la Bible, et l’action de l’Esprit Saint.
1 Matthieu 5:48
Marc Pernot
Oui, la tentation existe. Jésus a même été tenté d’abuser de son pouvoir pour lui-même1 , ou de laisser tomber 2. Mais il a été fortifié par l’Esprit, dans la prière, et par des passages de la Bible qui lui revenaient en tête.
La tentation est naturelle et indissociable de notre liberté, comme dans ce passage célèbre de Tintin au Tibet :

La tentation ne vient pas de Dieu, il ne cherche pas à nous piéger pour voir si nous allons faire une faute, au contraire. C’est pourquoi la traduction du » Notre Père » qui circule aujourd’hui ne me plait pas du tout. Cette traduction dit » … ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre nous du mal… « 3 Bien sûr que Dieu ne nous soumet pas à la tentation. Il est même notre plus sûr allié contre la tentation. C’est ce que dit Jésus à ses disciples quand il leur conseille » Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ; l’Esprit est bien disposé, mais la chair est faible. « 4
Nous avons bien du mal, par nos seules forces, à mettre un peu d’ordre dans notre vie, même avec la meilleure volonté du monde (la chair est faible). L’Esprit de Dieu est vraiment une force pour tenir debout, pour avancer, pour comprendre ce qu’il convient de faire et pour avoir la force de surmonter notre peur, notre paresse, notre orgueil et tous les autres ennemis intérieurs qui nous tirent vers le bas.
Pour cette fameuse phrase du » Notre Père » je préfère donc dire » … ne nous laisse pas entrer dans la tentation… » ou » ne nous abandonne pas dans la tentation… «
1 Matthieu 4
2 Matthieu 26:39 « Mon Père, si possible, que cette coupe s’éloigne de moi !«
3 Matthieu 6:13
4 Matthieu 26:41
Marc Pernot
V
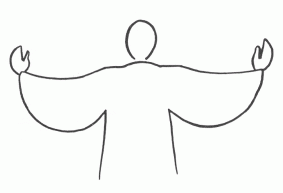
Parfois on pense que la vie éternelle dont parle l’Évangile serait une sorte de vie supplémentaire comme le héros peut en avoir une dans un jeu vidéo quand il a des mérites suffisants. Mais dans la Bible, la vie éternelle est quelque chose que l’on reçoit dans le présent :
Jésus dit : celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé a la vie éternelle (au présent : « a maintenant la vie éternelle »), il ne va pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie (au passé : « il est déjà passé de la mort à la vie »)1.
La mort passe sur nous comme un filtre, ce qui est vivant est gardé par Dieu pour l’éternité, et il laisse passer ce qui est temporaire2. Le jugement est ainsi à comprendre comme une purification de chaque personne plus que comme une sélection des personnes aptes à entrer dans le Royaume de Dieu.
Notre vie a de multiples dimensions, en particulier une dimension biologique qui est certainement temporaire (chacun de nous mourra un jour à ce point de vue). La vie humaine a également une dimension spirituelle qui, elle, ne serait pas limitée par ce genre de contraintes. Qu’est-ce qui peut nous faire penser que c’est vrai ? La vie est un miracle. Dieu est l’inventeur de la vie, par rapport au travail qu’il a déjà réalisé pour créer la vie, la suite est bien plus facile. Il veille sur ce qui est vivant.
Le corps est une excellente et bonne dimension de notre être, mais l’infinie valeur de la personne humaine n’est pas dans le domaine du matériel, mais du spirituel. Ce n’est pas qu’une belle idée, mais un fait d’expérience. Quand, par exemple, quelqu’un que nous aimons profondément perd un bras dans un accident, ou perd sa fortune, ou son travail, nous sommes tristes pour cette personne car la santé du corps et nos moyens matériels font partie de la beauté de notre vie, mais cette personne n’en a absolument pas moins de valeur à nos yeux. Car la valeur à nos yeux de notre mère, de notre enfant ou de notre ami le plus cher ne dépend pas de ce qui est matériel. L’infinie valeur de la personne humaine est de l’ordre du spirituel. Même si une personne que nous aimons meurt, nous pouvons continuer à l’aimer tout autant, elle peut continuer à nous enrichir de sa qualité d’être, nous sommes séparés seulement dans le domaine matériel.
Il peut donc y avoir de même une vie éternelle selon la dimension spirituelle (voir l’article sur la résurrection). Mais après tout, nous verrons bien. À mon avis, il ne faut pas trop se préoccuper de cela. Jésus ne nous demande absolument pas de sacrifier la vie présente pour nous assurer une vie éternelle. Jésus nous offre plutôt de vivre vraiment aujourd’hui une vie qui a une qualité, une profondeur, une élévation extraordinaires par la présence de Dieu. Il nous dit par ailleurs que cette qualité d’être est éternelle, ce serait alors un avantage supplémentaire, mais, nous dit-il, préoccupez vous plutôt aujourd’hui de cette réalité du Royaume de Dieu, et Jésus ajoute, “Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.”3
Marc Pernot

En hébreu, il y a un seul mot pour dire à la fois la vérité et la fidélité.
La vérité c’est ainsi une relation vraie et fidèle, pas une vérité au sens mathématique du terme, pas au sens d’une doctrine intellectuelle.
La vérité dans ce sens biblique ne s’oppose pas à l’erreur, mais au rejet, à l’abandon, à l’hypocrisie.
Dans l’évangile selon Jean, c’est bien cette notion-là de Vérité qui est mise en avant.
» Jésus est le chemin, la vérité, et la vie. « 1 => La vérité est une personne, une façon d’être, pas un ensemble de dogmes figés, comme le prétendent les différents intégrismes existant sur la planète.
Jésus dit : » Quiconque est de la vérité écoute ma voix. « 2 . Un philosophe pourrait dire : Quiconque écoute ma voix sera dans la vérité, mais ici, c’est l’inverse : Jésus dit que celui qui cherche à écouter sa parole est déjà dans la vérité avant même de l’entendre. En effet, une personne qui est » de la vérité » au sens de la Bible, c’est une personne qui cherche Dieu avec confiance, cette personne-là reconnaîtra en Christ la Parole de Dieu et lui fera confiance pour avancer.
Donc » la Vérité » est plus qu’un savoir, c’est une qualité d’être. Et cette qualité d’être est de l’ordre de la relation.
La Vérité, dans la Bible, c’est aussi ce qui va dans le sens de la création de Dieu, parce que c’est cela qui est » vrai » (la paix, la joie, l’amour, le pardon…) et que tout le reste est tromperie (la haine, la violence…).
C’est pourquoi la Bible dit que la Parole de Dieu est la vérité : parce que Dieu est fidèle et qu’il agit toujours dans le sens de la vie, et même de la vie bonne.
Marc Pernot
Z
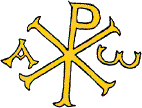
Z est la dernière lettre de notre alphabet. L’alphabet grec va d’Alpha à Oméga (A à W). Le livre de l’Apocalypse nous dit que Dieu est à la fois l’Alpha et l’Oméga 1, nous dirions en français qu’il est pour nous le A et le Z, en effet :
Dieu est le commencement de quelque chose de vraiment neuf dans l’histoire de l’humanité et dans l’histoire de la vie de chacun, en Christ.
Dieu est la fin au sens de finalité de la création. Il est le sens et l’accomplissement de notre vie.
Les chrétiens des premiers siècles résumaient leur foi dans ce signe que l’on appelle le chrisme et qui réunit quatre lettres grecques. On peut le lire ainsi : le Christ (Cr) est pour nous central, il est le commencement (A) et la finalité (W) de notre existence. Il est l’Adam tel que Dieu l’a toujours espéré.
1 Apocalypse 21:6
Marc Pernot
Œ
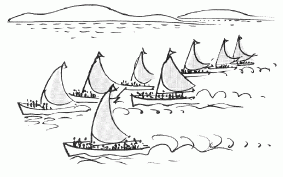
Le mot œcuménique vient du grec oikouménè, désignant l’ensemble de la terre habitée. L’œcuménisme est ainsi un mouvement de rassemblement des chrétiens de toutes sortes et de partout.
Il n’y a jamais eu d’unité parfaite de tous les croyants, évidemment, et cette unité serait une horreur, comme si l’humanité était transformée en une armée de robots tous semblables marchant au pas en une seule file immense. Dès l’origine, Pierre n’était pas Jean, ni Paul… Et chacun avait un peu sa façon d’être fidèle à ce Jésus qui avait transformé leur vie.
L’œcuménisme n’a donc pas pour but d’unifier la pensée des gens, ni de réduire les différences dans la façon de rendre un culte à Dieu ou d’organiser leur église particulière. Il s’agit plutôt de se reconnaître mutuellement comme chrétiens, de dialoguer et de faire des choses ensemble. L’œcuménisme est alors très utile :
- d’abord pour mettre de la paix entre les chrétiens et montrer ainsi aux non croyants que Dieu est source d’amitié et de respect, et que s’il y a une guerre entre croyants, ce n’est pas Dieu qui en est la cause, mais la folie des hommes qui cherchent à donner une certaine noblesse à leur violence en lui donnant un prétexte religieux.
- L’œcuménisme aide à mieux témoigner de Jésus-Christ. Aujourd’hui, tous les lecteurs de musique fonctionnent en stéréo, avec plusieurs sources de son. La voix du Christ aussi est mieux entendue avec une diversité de points de vue, et une diversité de façon d’en témoigner.
- La diversité des chrétiens et des églises est un bon vaccin contre l’intégrisme. Nous avons tous la tentation de prendre notre petit point de vue pour l’unique vérité. En écoutant avec respect ce que les autres chrétiens pensent, nous pourrons nous rendre compte qu’en réalité nous pourrions progresser un peu en nous réformant sans cesse un peu plus.
Marc Pernot
